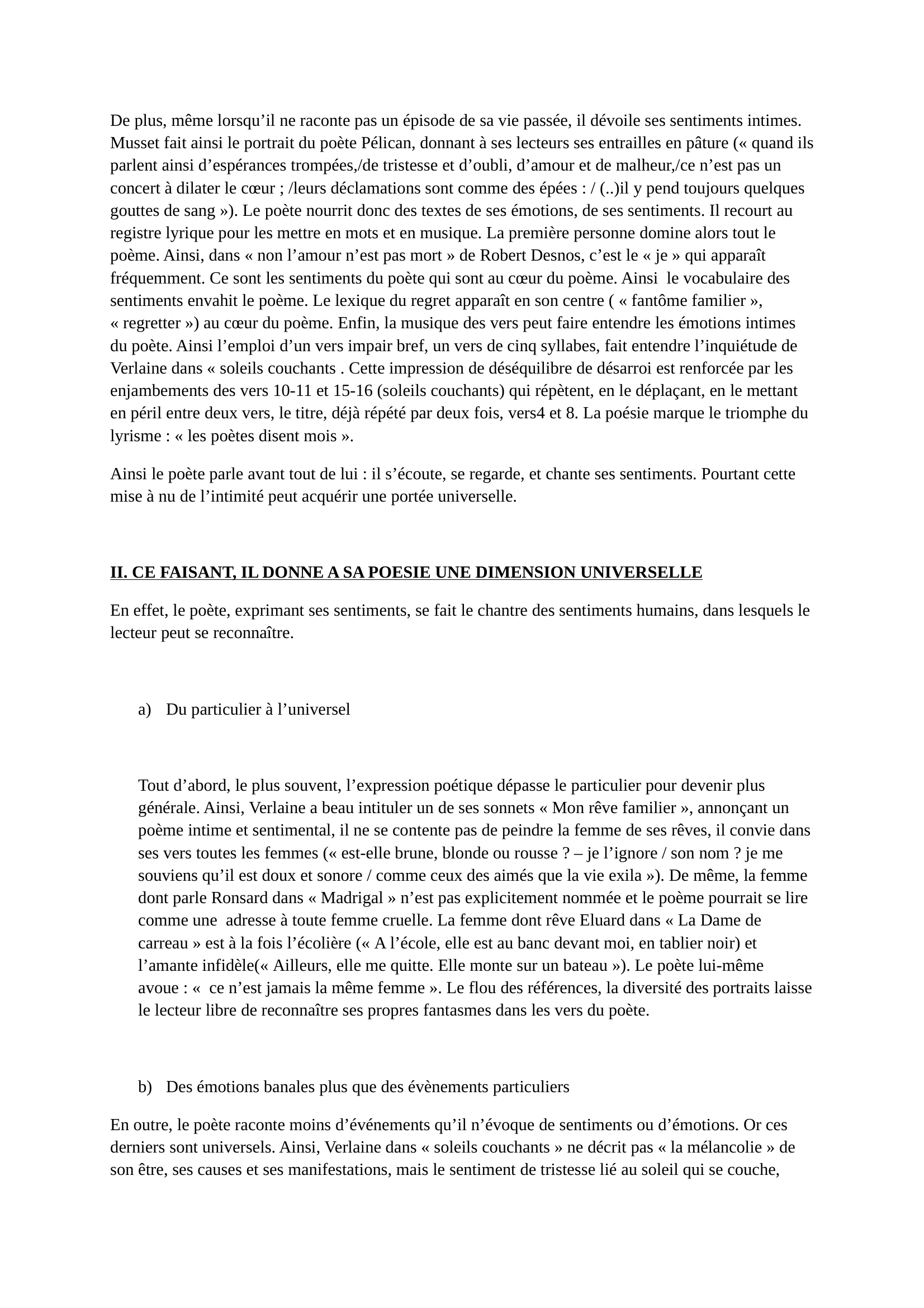« Ah insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! » a écrit Victor Hugo dans la préface des Contemplations. Dans quelle mesure l’expérience personnelle des poètes peut-elle concerner le lecteur ?
Publié le 05/05/2013

Extrait du document
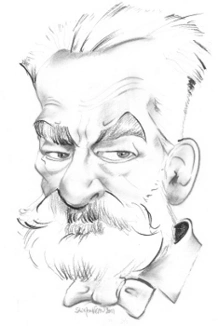
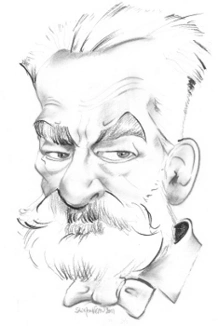
«
De plus, même lorsqu’il ne raconte pas un épisode de sa vie passée, il dévoile ses sentiments intimes.
Musset fait ainsi le portrait du poète Pélican, donnant à ses lecteurs ses entrailles en pâture (« quand ils
parlent ainsi d’espérances trompées,/de tristesse et d’oubli, d’amour et de malheur,/ce n’est pas un
concert à dilater le cœur ; /leurs déclamations sont comme des épées : / (..)il y pend toujours quelques
gouttes de sang »).
Le poète nourrit donc des textes de ses émotions, de ses sentiments.
Il recourt au
registre lyrique pour les mettre en mots et en musique.
La première personne domine alors tout le
poème.
Ainsi, dans « non l’amour n’est pas mort » de Robert Desnos, c’est le « je » qui apparaît
fréquemment.
Ce sont les sentiments du poète qui sont au cœur du poème.
Ainsi le vocabulaire des
sentiments envahit le poème.
Le lexique du regret apparaît en son centre ( « fantôme familier »,
« regretter ») au cœur du poème.
Enfin, la musique des vers peut faire entendre les émotions intimes
du poète.
Ainsi l’emploi d’un vers impair bref, un vers de cinq syllabes, fait entendre l’inquiétude de
Verlaine dans « soleils couchants .
Cette impression de déséquilibre de désarroi est renforcée par les
enjambements des vers 10-11 et 15-16 (soleils couchants) qui répètent, en le déplaçant, en le mettant
en péril entre deux vers, le titre, déjà répété par deux fois, vers4 et 8.
La poésie marque le triomphe du
lyrisme : « les poètes disent mois ».
Ainsi le poète parle avant tout de lui : il s’écoute, se regarde, et chante ses sentiments.
Pourtant cette
mise à nu de l’intimité peut acquérir une portée universelle.
II.
CE FAISANT, IL DONNE A SA POESIE UNE DIMENSION UNIVERSELLE
En effet, le poète, exprimant ses sentiments, se fait le chantre des sentiments humains, dans lesquels le
lecteur peut se reconnaître.
a) Du particulier à l’universel
Tout d’abord, le plus souvent, l’expression poétique dépasse le particulier pour devenir plus
générale.
Ainsi, Verlaine a beau intituler un de ses sonnets « Mon rêve familier », annonçant un
poème intime et sentimental, il ne se contente pas de peindre la femme de ses rêves, il convie dans
ses vers toutes les femmes (« est-elle brune, blonde ou rousse ? – je l’ignore / son nom ? je me
souviens qu’il est doux et sonore / comme ceux des aimés que la vie exila »).
De même, la femme
dont parle Ronsard dans « Madrigal » n’est pas explicitement nommée et le poème pourrait se lire
comme une adresse à toute femme cruelle.
La femme dont rêve Eluard dans « La Dame de
carreau » est à la fois l’écolière (« A l’école, elle est au banc devant moi, en tablier noir) et
l’amante infidèle(« Ailleurs, elle me quitte.
Elle monte sur un bateau »).
Le poète lui-même
avoue : « ce n’est jamais la même femme ».
Le flou des références, la diversité des portraits laisse
le lecteur libre de reconnaître ses propres fantasmes dans les vers du poète.
b) Des émotions banales plus que des évènements particuliers
En outre, le poète raconte moins d’événements qu’il n’évoque de sentiments ou d’émotions.
Or ces
derniers sont universels.
Ainsi, Verlaine dans « soleils couchants » ne décrit pas « la mélancolie » de
son être, ses causes et ses manifestations, mais le sentiment de tristesse lié au soleil qui se couche,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor Hugo a écrit dans la préface des Contemplations (1856) : On se plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi. Vous discuterez cette affirmation en prenant pour exemples un ou plusieurs des poèmes romantiques que vous connaissez le mieux.
- Hugo écrit dans la préface des Contemplations : « On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Ah ! Insensé qui crois que je ne suis pas toi ! » Vous discuterez cette affirmation.
- On connaît l'exclamation de Hugo dans la Préface des Contemplations, en réponse à ceux qui reprochaient aux Romantiques leur « égocentrisme » : Ah! insensé qui crois que je ne suis pas toi ! Commenter ce mot en faisant ressortir la portée générale des « confidences » romantiques.
- BAUDELAIRE écrit dans son grand article sur Victor Hugo : Quand on se figure ce qu'était la poésie française avant qu'il apparût, et quel rajeunissement elle a subi depuis qu'il est venu, quand on imagine le peu qu'elle eût été s'il n'était pas venu, combien de sentiments mystérieux et profonds, qui ont été exprimés, seraient restés muets; combien d'intelligences il a accouchées, il est impossible de ne pas le considérer comme un de ces esprits rares et providentiels qui opèrent, dans
- Jean-Claude Grumbach, scénariste et dramaturge contemporain, confie à un journaliste qu'il observe le monde « avec un oeil sur le sordide, un oeil sur le sublime ». En vous appuyant sur les oeuvres que vous connaissez, sans vous limiter nécessairement au théâtre ou au cinéma, vous préciserez dans quelle mesure cette affirmation d'un créateur peut rendre compte aussi de votre expérience personnelle de lecteur et de spectateur. ?