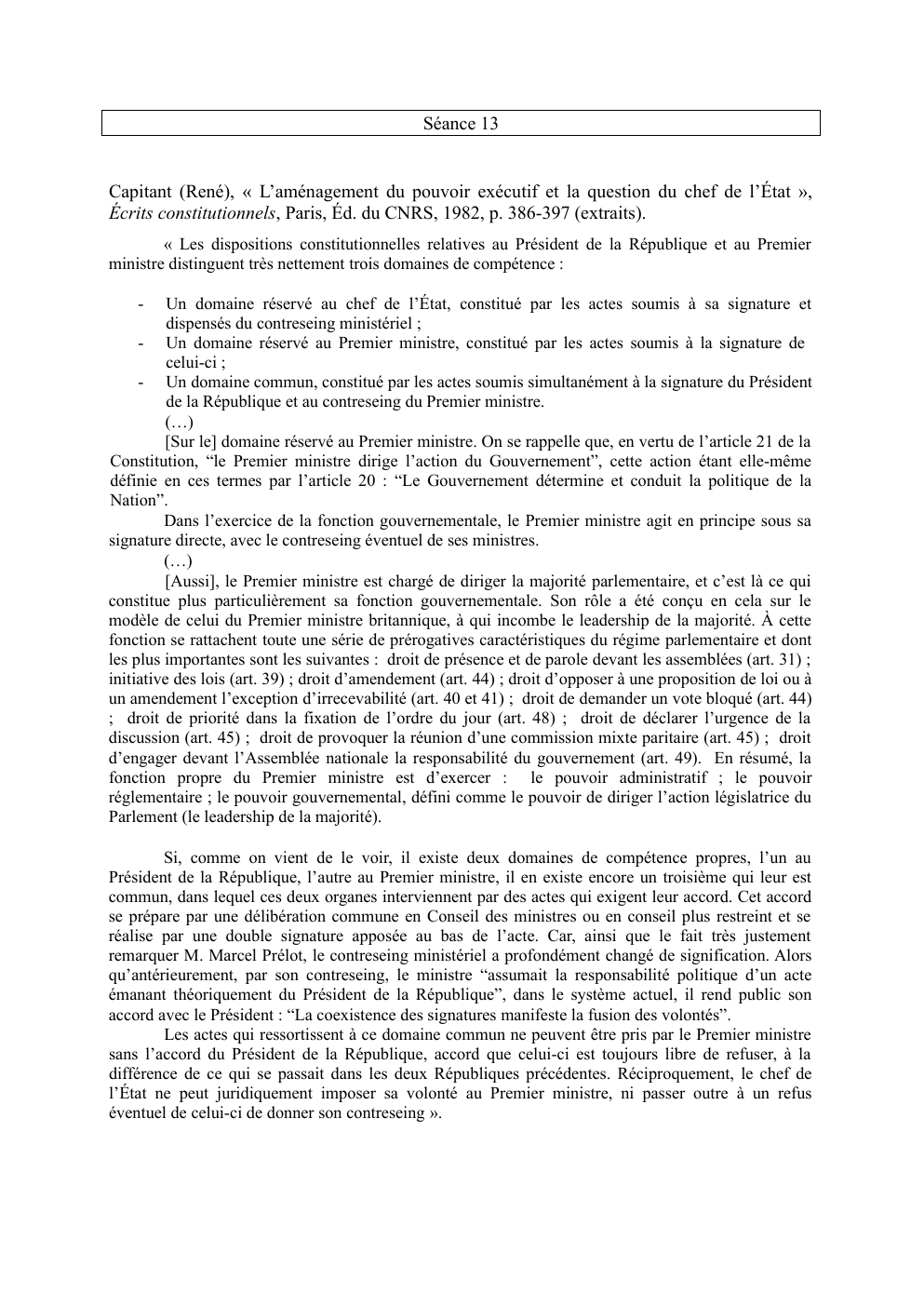séance 13 premier ministre Capitant (René), « L’aménagement du pouvoir exécutif et la question du chef de l’État »
Publié le 18/02/2025
Extrait du document
«
Séance 13
Capitant (René), « L’aménagement du pouvoir exécutif et la question du chef de l’État »,
Écrits constitutionnels, Paris, Éd.
du CNRS, 1982, p.
386-397 (extraits).
« Les dispositions constitutionnelles relatives au Président de la République et au Premier
ministre distinguent très nettement trois domaines de compétence :
-
Un domaine réservé au chef de l’État, constitué par les actes soumis à sa signature et
dispensés du contreseing ministériel ;
- Un domaine réservé au Premier ministre, constitué par les actes soumis à la signature de
celui-ci ;
- Un domaine commun, constitué par les actes soumis simultanément à la signature du Président
de la République et au contreseing du Premier ministre.
(…)
[Sur le] domaine réservé au Premier ministre.
On se rappelle que, en vertu de l’article 21 de la
Constitution, “le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement”, cette action étant elle-même
définie en ces termes par l’article 20 : “Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
Nation”.
Dans l’exercice de la fonction gouvernementale, le Premier ministre agit en principe sous sa
signature directe, avec le contreseing éventuel de ses ministres.
(…)
[Aussi], le Premier ministre est chargé de diriger la majorité parlementaire, et c’est là ce qui
constitue plus particulièrement sa fonction gouvernementale.
Son rôle a été conçu en cela sur le
modèle de celui du Premier ministre britannique, à qui incombe le leadership de la majorité.
À cette
fonction se rattachent toute une série de prérogatives caractéristiques du régime parlementaire et dont
les plus importantes sont les suivantes : droit de présence et de parole devant les assemblées (art.
31) ;
initiative des lois (art.
39) ; droit d’amendement (art.
44) ; droit d’opposer à une proposition de loi ou à
un amendement l’exception d’irrecevabilité (art.
40 et 41) ; droit de demander un vote bloqué (art.
44)
; droit de priorité dans la fixation de l’ordre du jour (art.
48) ; droit de déclarer l’urgence de la
discussion (art.
45) ; droit de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire (art.
45) ; droit
d’engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement (art.
49).
En résumé, la
fonction propre du Premier ministre est d’exercer : le pouvoir administratif ; le pouvoir
réglementaire ; le pouvoir gouvernemental, défini comme le pouvoir de diriger l’action législatrice du
Parlement (le leadership de la majorité).
Si, comme on vient de le voir, il existe deux domaines de compétence propres, l’un au
Président de la République, l’autre au Premier ministre, il en existe encore un troisième qui leur est
commun, dans lequel ces deux organes interviennent par des actes qui exigent leur accord.
Cet accord
se prépare par une délibération commune en Conseil des ministres ou en conseil plus restreint et se
réalise par une double signature apposée au bas de l’acte.
Car, ainsi que le fait très justement
remarquer M.
Marcel Prélot, le contreseing ministériel a profondément changé de signification.
Alors
qu’antérieurement, par son contreseing, le ministre “assumait la responsabilité politique d’un acte
émanant théoriquement du Président de la République”, dans le système actuel, il rend public son
accord avec le Président : “La coexistence des signatures manifeste la fusion des volontés”.
Les actes qui ressortissent à ce domaine commun ne peuvent être pris par le Premier ministre
sans l’accord du Président de la République, accord que celui-ci est toujours libre de refuser, à la
différence de ce qui se passait dans les deux Républiques précédentes.
Réciproquement, le chef de
l’État ne peut juridiquement imposer sa volonté au Premier ministre, ni passer outre à un refus
éventuel de celui-ci de donner son contreseing ».
Quel sont les relations entre le Premier Ministre et le chef de l’Etat au sein du pouvoir exécutif ?
I-Un accord au sein du pouvoir exécutif
A-Une coexistence des deux organes de l’exécutif
1- Une relation conventionnelle égalitaire
PM-PR : Travaillent à deux=> Les actes qui ressortissent à ce domaine commun ne peuvent
être pris par le Premier ministre sans l’accord du Président de la République, accord que celui-ci est
toujours libre de refuser, à la différence de ce qui se passait dans les deux Républiques précédentes.
Réciproquement, le chef de l’État ne peut juridiquement imposer sa volonté au Premier ministre, ni
passer outre à un refus éventuel de celui-ci de donner son contreseing ».
B-Une légitimation de la relation au sein de l’exécutif
Si, comme on vient de le voir, il existe deux domaines de compétence propres, l’un au
Président de la République, l’autre au Premier ministre, il en existe encore un troisième qui leur est
commun, dans lequel ces deux organes interviennent par des actes qui exigent leur accord.
Cet accord
se prépare par une délibération commune en Conseil des ministres ou en conseil plus restreint et se
réalise par une double signature apposée au bas de l’acte.
Car, ainsi que le fait très justement
remarquer M.
Marcel Prélot, le contreseing ministériel a profondément changé de signification.
Alors
qu’antérieurement, par son contreseing,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Question 198: Ministre de la Culture du gouvernement Chirac, François LÉOTARD (Cannes, 1942) tente, après le retour de la gauche au pouvoir, de dynamiser l'opposition.
- Leur seule récompense est de pouvoir parfois porter assistance à certains des meilleurs pilotes de la planète. René Fagnan, la Formule 1 en question, Québec Amérique
- Quel est le rôle d'un premier ministre en période de cohabitation ? Qui est le véritable chef de l'exécutif sous le régime de la 5ème république ?
- Commentaire de l'allocution prononcée par François Mitterrand le 29 mars 1993 « C'est donc au chef de l'Etat … que doit procéder le pouvoir exécutif … à lui la mission de nommer les ministres et d'abord le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. »
- C.E. 5 mai 1976, SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER. ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE ET MINISTRE DE L'AGRICULTURE C. BERNETTE, Rec. 232