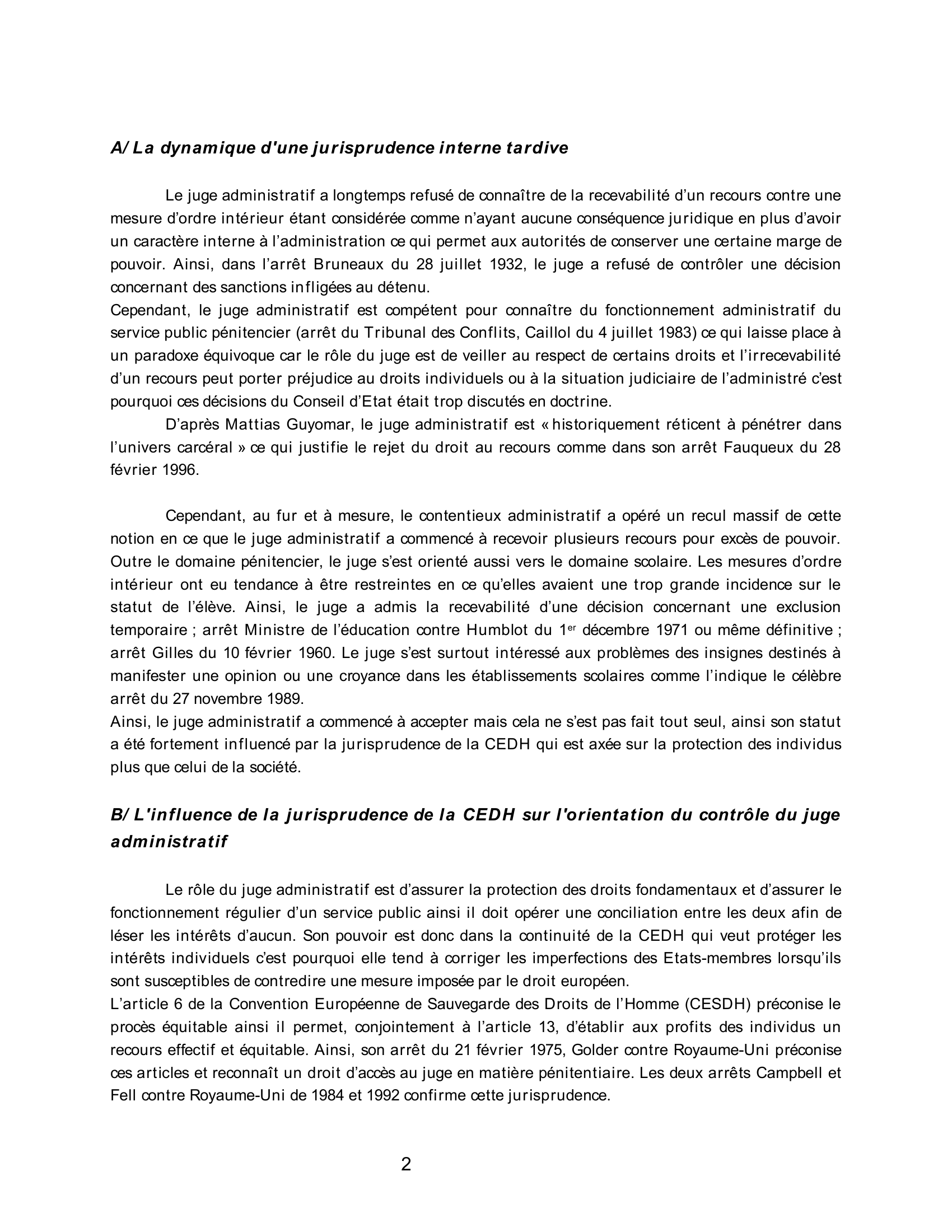Les mesures d'ordre intérieur
Publié le 03/04/2014
Extrait du document
«
A/ L a dyn am ique d' u ne j u r isp r u dence i n te r ne t a r d ive
Le juge admin is t ra t i f a long temps refusé de connaî t re de la recevabi l i té d’un recou rs cont re une
mesu re d’ord re i n té r ieu r étan t considérée comme n’ayan t aucune conséquence ju r id ique en plus d’avoi r
un caractère i n te r ne à l’admin is t ra t ion ce qui permet aux au to r i tés de conserver une cer ta ine ma rge de
pouvoir.
A insi, dans l’a r rê t B r u neaux du 28 j u i l le t 1932, le j uge a refusé de cont rô ler une décision
concernan t des sanct ions i n f l igées au détenu.
Cependan t, le j uge adm in ist ra t i f est compéten t pou r connaî t re du fonct ionnemen t adm in is t ra t i f du
serv ice publ ic péni tencier (a r rê t du T r ibuna l des Con f l i ts, Cai l lol du 4 ju i l le t 1983) ce qu i la isse place à
un paradoxe équivoque car le rô le du juge est de vei l le r au respect de cer ta ins d roi ts et l’ i r recevabi l i té
d’un recou rs peu t por te r p réjud ice au d roi ts i nd iv iduels ou à la si t ua t ion jud icia i re de l’adm in ist ré c’est
pou rquoi ces décisions du Consei l d’E ta t étai t t rop discu tés en doct r i ne.
D’ap rès Ma t t ias Guyomar, le j uge adm in ist ra t i f est « h is to r iquemen t ré t icen t à pénét rer dans
l’un ivers carcéral » ce qu i j ust i f ie le rejet du d roi t au recou rs comme dans son a r rê t Fauqueux du 28
fév r ie r 1996.
Cependan t, au f u r et à mesu re, le con ten t ieux adm in ist ra t i f a opéré un recul massif de cet te
not ion en ce que le j uge adm in ist ra t i f a commencé à recevoi r plusieu rs recours pou r excès de pouvoir.
Ou t re le domaine pén i tencier, le juge s’est or ien té aussi vers le domaine scola i re.
Les mesu res d’ord re
i n té r ieu r ont eu tendance à êt re rest rein tes en ce qu’elles avaien t une t rop grande i ncidence sur le
sta t u t de l’élève.
A insi, le j uge a adm is la recevabi l i té d’une décision concernan t une exclusion
tempora i re ; a r rê t M i n ist re de l’éducat ion cont re H u mb lot du 1 er
décemb re 1971 ou même déf in i t ive ;
a r rê t Gil les du 10 fév r ie r 1960.
Le j uge s’est su r tou t i n té ressé aux p roblèmes des i nsignes dest inés à
man ifeste r une opin ion ou une croyance dans les établ issemen ts scolai res comme l’ ind ique le célèbre
a r rê t du 27 novembre 1989.
A insi, le j uge adm in ist ra t i f a commencé à accepter mais cela ne s’est pas fai t tou t seul, ainsi son sta tu t
a été for temen t i n f l uencé par la j u r isp r udence de la CED H qui est axée sur la protect ion des i nd iv idus
plus que celu i de la société.
B/ L ' i n f l uence de l a j u r isp r u dence de l a CE D H su r l 'o r ient a t ion d u cont rô le d u j uge
a dm i n ist r a t i f
Le rô le du j uge admin is t ra t i f est d’assurer la p rotect ion des d roi ts fondamen taux et d’assu rer le
fonct ionnemen t régul ie r d’un service publ ic ainsi i l doi t opérer une conci l ia t ion ent re les deux af in de
léser les i n té rê ts d’aucun.
Son pouvoi r est donc dans la cont in u i té de la CED H qu i veu t p rotéger les
i n té rê ts i nd iv iduels c’est pou rquoi elle tend à cor r iger les impe rfect ions des E ta ts-memb res lo rsqu’i ls
sont suscept ib les de cont redi re une mesu re imposée par le d roi t européen.
L’a r t icle 6 de la Convent ion Eu ropéenne de Sauvegarde des D roi ts de l’ Homme (CESD H) p réconise le
p rocès équi tab le ainsi i l permet, conjoin temen t à l’a r t icle 13, d’établ i r aux prof i ts des i nd iv idus un
recou rs effect i f et équi tab le.
A i nsi, son a r rê t du 21 fév r ie r 1975, Golder cont re Royaume-Un i p réconise
ces a r t icles et reconnaî t un d roi t d’accès au j uge en ma t ière péni ten t ia i re.
Les deux a r rê ts Campbel l et
Fell cont re Royaume-Un i de 1984 et 1992 conf i r me cet te j u r isp r udence.
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vous commenterez ce jugement d'un critique contemporain : « Le théâtre de Racine est le diamant de notre littérature. Car il n'est pas de théâtre, je pense, qui contienne à la fois plus d'ordre et de mouvement intérieur, plus de vérité psychologique et plus de poésie. »
- La science donne à l'homme un pouvoir grandissant sur le monde extérieur ; la littérature l'aide à mettre de l'ordre dans son monde intérieur. Les deux fonctions sont indispensables. André Maurois
- Un écrivain contemporain affirme: « La science donne à l'homme un pouvoir grandissant sur le monde extérieur, la littérature l'aide à mettre de l'ordre dans son monde intérieur ». Pensez-vous que la littérature ait effectivement ce pouvoir et que ce soit sa seule fonction ?
- Article 9 du règlement intérieur de l'ordre des avocats du barreau de Paris : commentaire
- « L'oeuvre d'art classique raconte le triomphe de l'ordre et de la mesure sur le romantisme intérieur. L'oeuvre est d'autant plus belle que la chose soumise était d'abord plus révoltée. » (GIDE, incidences.). Commentez cette citation.