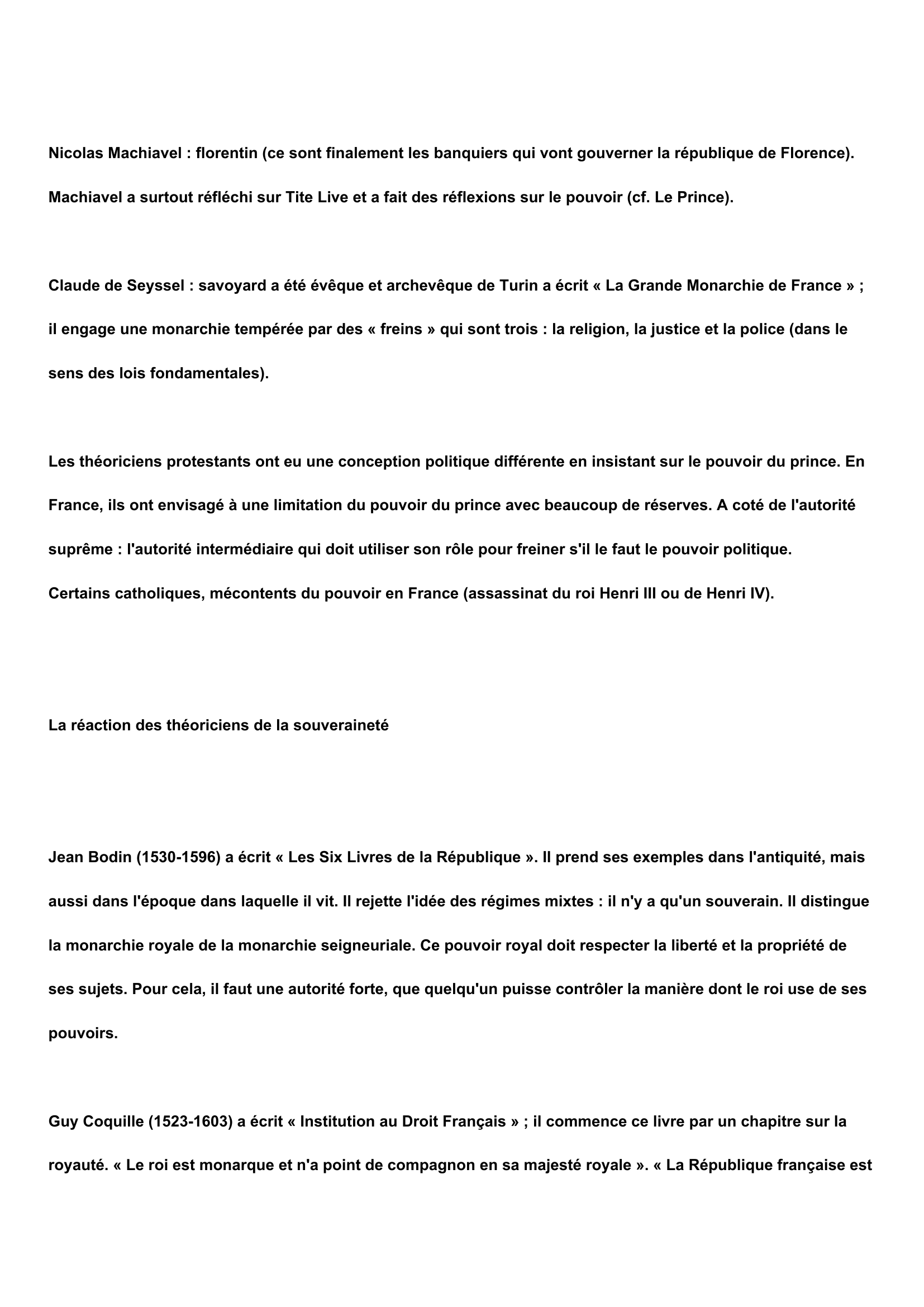Histoire du Droit – CM – S2 Troisième partie : vers l’Etat de Droit moderne. Titre 1 : les sources du droit, la naissance du droit français. Cf. Semestre 1 Titre 2 : l’affirmation du pouvoir monarchique. Pouvoir royal, pouvoir monarchique sont synonymes à l’époque. Monarque -> réflexion sur le pouvoir politique. Chapitre 1 : la conception du pouvoir royal. Section 1 : le pouvoir monarchique, un pouvoir souverain. I. Théorie du pouvoir souverain et la monarchie Les idées politiques du XVIème et la monarchie Nicolas Machiavel : florentin (ce sont finalement les banquiers qui vont gouverner la république de Florence). Machiavel a surtout réfléchi sur Tite Live et a fait des réflexions sur le pouvoir (cf. Le Prince). Claude de Seyssel : savoyard a été évêque et archevêque de Turin a écrit « La Grande Monarchie de France » ; il engage une monarchie tempérée par des « freins » qui sont trois : la religion, la justice et la police (dans le sens des lois fondamentales). Les théoriciens protestants ont eu une conception politique différente en insistant sur le pouvoir du prince. En France, ils ont envisagé à une limitation du pouvoir du prince avec beaucoup de réserves. A coté de l’autorité suprême : l’autorité intermédiaire qui doit utiliser son rôle pour freiner s’il le faut le pouvoir politique. Certains catholiques, mécontents du pouvoir en France (assassinat du roi Henri III ou de Henri IV). La réaction des théoriciens de la souveraineté Jean Bodin (1530-1596) a écrit « Les Six Livres de la République ». Il prend ses exemples dans l’antiquité, mais aussi dans l’époque dans laquelle il vit. Il rejette l’idée des régimes mixtes : il n’y a qu’un souverain. Il distingue la monarchie royale de la monarchie seigneuriale. Ce pouvoir royal doit respecter la liberté et la propriété de ses sujets. Pour cela, il faut une autorité forte, que quelqu’un puisse contrôler la manière dont le roi use de ses pouvoirs. Guy Coquille (1523-1603) a écrit « Institution au Droit Français » ; il commence ce livre par un chapitre sur la royauté. « Le roi est monarque et n’a point de compagnon en sa majesté royale ». « La République française est une vraie monarchie ». II. La notion de monarchie absolue A la Révolution on a qualifié l’ancienne monarchie de tyrannie. Les confusions faites à propos de ce pouvoir absolu D’abord on a considéré cette monarchie comme un régime despotique, sans limite et sans frein. On trouvait déjà cela chez certains avant la révolution. Ce qui est curieux, c’est que le terme de monarchie absolue était totalement accepté par les français à l’époque. Ensuite, certains ont considéré cette monarchie comme une dérive de la royauté. C’est confondre l’autorité effective et la conception de l’autorité du roi. L’autorité royale est absolue depuis longtemps (au moins Saint Louis). Le vrai sens de la monarchie absolue Le pouvoir royal est un pouvoir indépendant. Cela a été exprimé par Merlin de Douait à la fin de l’Ancien Régime qui a écrit le « Traité des Offices ». « Ainsi, un seul roi indépendant, absolu ». Le roi qui tient son pouvoir que de Dieu et qu’il doit transmettre intact à son successeur. Pour lui le terme absolu n’a rien d’abominable. On peut dire que c’est un pouvoir suprême qui ne se partage pas : ni la reine, ni le Dauphin, ni les autres membres de la famille royale, ni les princes du sang, ni les pairs de France, ni la noblesse… Le pouvoir du roi peut être ralenti ; il peut être conseillé. Le pouvoir peut aussi être délégué. III. La conception française du droit divin des rois Le principe de l’origine divine du pouvoir Position de la religion chrétienne : relativement ancienne, c’est par voie de Dieu que les rois règnent. On trouve dans l’évangile quand Jésus n’aurait aucun pouvoir sans Dieu. Cela ne veut pas dire que le titulaire de l’autorité sera un personnage admirable. Saint Thomas d’Aquin préférait la monarchie pour des raisons humaines ; le pouvoir royal venait du peuple. Ses idées ont été reprises aux XVIème siècle. C’est à réaction contre cela que l’on a eu la conception française du droit divin direct. Bossuet l’a repris : aucun intermédiaire entre Dieu et le roi. Le sacre Tradition carolingienne. Le roi devient successeur tout de même à partir du XIVème avant même d’être sacré. Le roi prend un certain nombre d’engagements envers sont peuple et l’Eglise. Il y a ensuite des acclamations qui sont un vestige des élections. Il reçoit ensuite l’onction du saint chrême. On lui remet ensuite les insignes de son pouvoir. Enfin il est couronné et intronisé. Les conséquences Le roi n’est pas roi pour lui même, mais dans l’intérêt de son peuple. On attribue au roi un pouvoir de guérison (toucher des écrouelles). L’autorité du roi est accrue car le sacre renforce sont pouvoir. L’obéissance au roi est due par des motifs humains, mais aussi religieux. Mais le roi est responsable devant Dieu. Section 2 : le pouvoir monarchique encadré par les lois fondamentales du royaume. I. Les nouveaux développements des lois fondamentales L’indisponibilité du domaine, du royaume et de la couronne L’indisponibilité du domaine Cette règle vient du moyen-âge et a été consolidée depuis Charles V. Cela a été confirmé par l’édit de Moulin en 1556 qui autorise le roi à léguer un bien de la couronne temporairement pour rembourser une dette. Il y a certains aménagements : l’apanage (affectation au cadet de la famille royale de certains biens de la couronnes, mais sans pouvoir politique ou judiciaire) et en cas de dette ou de gestion trop couteuse d’un patrimoine. Un patrimoine personnel d’un roi avant son intronisation devient un bien de la couronne. L’impossibilité du roi de céder un territoire du royaume La question s’est posée avec François Ier lorsqu’il devait donner au Saint Empire la Bourgogne pour être libéré. Cela ne s’est pas fait. Le roi ne pouvait pas non plus se démettre de ses fonctions Impossible de renoncer à ses successeurs Sous Louis XIV, son petit-fils est devenu roi d’Espagne. Philippe V d’Espagne et ses descendants renonceront au trône (mais le Parlement n’a pas accepté et c’est donc purement honorifique). Le roi ne peut pas limiter le pouvoir de ses successeurs C’est le cas de la régence (si le roi a moins de treize ans). Le régent était encadré par un conseil de régence. Cela a été considéré sans valeur car le pouvoir du régent est celui du roi et ne peut être limité. Le roi ne peut pas désigner de nouveaux successeurs à la couronne C’est ce qu’a fait Louis XIV. En 1662 par le traité de Montmartre : le roi de France et le duc de Lorraine se reconnaissant un droit de succession réciproque en cas d’absence d’héritiers ; il n’a jamais été appliqué. En 1714 Louis XIV a donné un droit de succession à ses fils illégitimes légitimés (à défaut de tout descendant légitime). La règle de catholicité du roi La question se pose en 1589 quand Henri de Bourbon roi de Navarre et protestant devient roi de France. En 1577, les Etats Généraux de Blois instaure cette règle catholicité. Elle est rappelée en 1588. A la mort d’Henri III il y a une véritable guerre civile. Les partisans de la Ligue vont proclamer roi de France l’oncle du roi. Certains ont même proposé la fille du roi Philippe II. Le Parlement de Paris dans l’arrêt Lemaître en 1593 rappelle les lois de succession du trône en ajoutant la règle de catholicité (qui ne remplace pas les autres). Henri IV va abjurer et sera sacré à Chartres en 1593. II. Le caractère intangible des lois fondamentales Ni le roi, ni les Etats Généraux ne peuvent modifier ces lois : ni pour les violer, ni pour en ajouter des nouvelles ; seule la coutume pourrait le faire. Ce caractère a été proclamé en 1717 où le roi Louis XV abroge l’édit de Marly par lequel Louis XIV avait donné un droit de succession à ses enfants légitimé. On reproche à cette décision d’avoir donné une nouvelle règle. On envisage le cas où la famille royale venait à s’éteindre auquel cas ce serait à la nation de choisir une nouvelle famille. A partir de 1729, on utilise le mot de Constitution pour désigner les règles fondamentales, mais on va tendre à ajouter la distinction des trois ordres de la société, rôle des cours souveraines dans l’enregistrement des décisions royales. III. Les règles que doit respecter le roi Les maximes du royaume Il faut que le roi assure la justice par des juges capables et accessibles à ses sujets. Egalement, en ce qui concerne la législation, cette dernière doit être utile ; il faut une délibération ; des conditions de forme. Le roi peut légiférer par d’autres formes (les corps intermédiaires). Le roi et le respect des privilèges Les privilèges sont là pour un intérêt particulier. Toutefois, les privilèges sont les droits des sujets. En principe le roi les respecte, mais peut aller contre eux dans l’intérêt général. Ces privilèges sont rarement gratuits. Le roi et le respect des lois Il s’agit des lois du roi (il peut faire et casser les lois). Le roi peut adopter des dispenses dans des cas particuliers (ex : un âge minimum pour exercer certaines fonctions). Le roi doit respecter les lois qu’il a faites pour montrer l’exemple. On insiste sur le caractère paternel de l’autorité ; sur le caractère pragmatique aussi ; caractère modéré (lettres de cachet) ; esprit de conseil de justice. Chapitre 2 : l’exercice du pouvoir royal. Le roi n’exerce pas son pouvoir de manière solitaire. Il a plusieurs organes qui l’assistent de manière permanente. Section 1 : la monarchie et son gouvernement Le roi doit gouverner avec un Conseil du Roi et il est entouré d’une cour au sein de laquelle se sont peu à peu spécialisés certains organes : le parlement, la chambre des comptes, le Grand Conseil (cour supérieure de justice qui sert au roi afin de faire juger les procès qu’il souhaite). En cas de procès qui concerne l’Eglise, le roi ne donne pas l’affaire au Parlement. Il reste autour du roi la maison du roi (entourage) ; le conseil du roi va prendre une importance plus grande et surtout à partir de 1661 où Louis XIV commence sont règne personnel ; à côté du Conseil du Roi se trouvent les ministres qui sont des gens qui ont le privilège d’avoir des entrevues auprès du roi. Sous-section 1 : le roi et son conseil I. Les membres du Conseil Tout d’abord, personne n’est membre de droit au Conseil, mais il y a un certain nombre de personnages qui sont des professionnels (la Robe). On peut y ajouter les avocats au Conseil. Aucun membre de droit C’est un principe qui connaît des exceptions. En effet le titre de conseiller du roi est très répandu. Guy Coquille distingue deux types de conseillers : les nés et les faits. Les premiers sont par leur naissance ont le droit de siéger et les faits sont ceux que le roi a appelés à lui. Il y a aussi les conseillers à brevet. Les exceptions ne sont pas gênantes car ces membres de droit ont accès aux fonctions les moins prestigieuses du Conseil. Aussi le titre de ministre d’Etat qui est surtout honorifique qui va siéger dans la formation la plus élevée du Conseil (le Conseil d’en Haut et l’on y assiste que sur invitation du roi) ; titre qui se garde à vie. Les magistrats du Conseil Ce sont des professionnels parfois appelés La Robe. Il y a les conseillers d’Etat. Des gens très importants et peu nombreux (trente) ; parmi eux la plupart étaient juristes ; c’est une dignité. On a d’abord été maître des requêtes. Il y a parmi eux un doyen. Leur rôle est de faire un rapport et élaborer la décision collectivement. Ils peuvent avoir des fonctions extérieures au Conseil : quand les membres du Parlement font grève. Les maîtres des requêtes sont plus nombreux (70). Ce sont des officiers inamovibles. C’est une fonction devenue vénale. Pour le devenir il faut avoir été avocat ou magistrat dans une cour souveraine. Le roi n’a aucun pouvoir pour nommer les offices habituellement sauf ici où il faut son aval pour vendre un office. Ils assurent les requêtes de l’hôtel du roi ; ils participent à l’activité du Conseil en faisant des rapports ; ils sont collaborateurs du chancelier ; ils sont intendants de province. Les avocats au Conseil sont des avocats spécialisés propriétaire d’un office. En cas de procès au Conseil du roi il était obligatoire de se munir d’un de ces avocats (resté aujourd’hui avec les avocats à la Cour de cassation et du Conseil Constitutionnel). II. Les séances du Conseil Un seul roi, un seul Conseil, mais il y a plusieurs réunions ; quand le roi se déplace, le Conseil est censé le suivre. Le roi n’est réellement présent qu’à certaines formations. On a distingué un Conseil retreint et un Conseil plénier. Aux XIVème siècle apparaît la notion de Conseil secret, des affaires. Deux types de conseil : le conseil de gouvernement et le conseil de justice et d’administration (où le roi ne vient qu’exceptionnellement). Le conseil de gouvernement C’est devenu le conseil secret, des affaires. A partir de 1661 deux conseils : - Le conseil d’en haut (présence du roi) qui se réuni dans un salon à côté de la chambre du roi (alors que les autres c’est au Rez-de-chaussée). Le roi invite personnellement les membres qui y participent (une demi-douzaine de personnes). On va y trouver le roi, parfois le dauphin, un membre de la noblesse d’épée, le contrôleur général des finances et le principal ministre s’il y en a un. On s’occupe principalement de politique étrangère (paix, guerre, alliance). - Le conseil des dépêches qui lit les rapports des provinces. C’est une sorte de ministre de l’intérieur collectif. On y trouve le chancelier ou le garde des sceaux (ou les deux), le secrétaire général des finances et les quatre secrétaires d’Etat. Son rôle est de s’occuper des affaires intérieurs : relations des autorités locales, rapports des provinces, jugement de certaines affaires. Deux autres conseils : conseil royal des finances et conseil royal du commerce (royal car le roi est toujours présent). Le conseil royal des finances est composé du roi, chancelier, du secrétaire général des finances, un chef du conseil royal des finances (honorifique) et certains conseillers d’Etat. Son rôle est d’ordonner les dépenses, répartir l’impôt, la taille, préparer le budget et peut juger certains procès. Le conseil royal du commerce composé du roi, du chancelier et du secrétaire général au commerce et de certains fermiers généraux ; on y trouve également une dizaine de députés des villes du commerce. Il élabore les règlements. Les conseils de justice et d’administration Ce sont les conseils d’Etat privés, de finance et de direction. Ils fonctionnent souvent sans présence du roi et en l’absence de celui-ci, c’est le chancelier qui préside. Ce conseil siège dans la salle du conseil. Il y a le conseil d’Etat privé ; c’est là que les membres de droit siègent, mais ce sont les maîtres des requêtes. Les affaires judiciaires sont les évocations ; la cassation (le conseil du roi peut casser une décision judiciaire en dernier ressort) ; la révision (criminelle). Le 9 août ???? les conseils sont regroupés. Le conseil d’Etat et des finances est divisé en petite et grande direction. La petite s’occupe de ce qui est administratif. Le comité des finances prépare les affaires (il y avait les commission ordinaires et extraordinaires). Ainsi qu’un comité contentieux des départements (ministériels). III. Les décisions prises par le Conseil : les arrêts du Conseil Le Conseil est le roi entouré de son conseil et il n’y a aucune délégation au conseil. Toutefois, comme le roi n’est pas effectivement présent à toutes les séances, on distingue deux type de formulation d’arrêts : simple (sans présence) et en commandement (avec roi). Les arrêts simples « Par le roi en son conseil ». Ils sont signés par le chancelier. Le contreseing est une façon d’authentifier la décision ; c’est un secrétaire du roi. Ces décisions sont rendues à la majorité des voix. Les arrêts en commandement « Par le roi en son conseil, le roi y étant ». Le contreseing est différent : l’authentification se fait par la signature d’un des secrétaires d’Etat. Il y a eu un problème de faux arrêts en commandement. Ces décisions servent à juger les procès, à prendre des décision individuelles, règlementaires, législatives, etc. Sous-section 2 : le roi et ses ministres Le ministre est celui qui travaille directement avec le roi. Le principal ministre n’a jamais eu d’existence permanente. Un principal ministre domine les autres et est présent au travail du roi et d’un ministre, mais cela n’a pas toujours existé (il y a eu Richelieu, Mazarin). Il n’y avait pas de conseil des ministres. I. Les différents ministres Le chancelier Il a connu depuis la fin du XVI des changements. C’est un grand officier de la couronne (un des derniers avec l’amiral). Il est titulaire d’une fonction inamovible et n’a jamais été vendue. C’est le second personnage du royaume après le roi. Il connaît un déclin relatif car d’autres personnages ont des rôles majeurs. Le roi ne peut pas révoquer le chancelier. En cas de désaccord, le roi peut priver le chancelier de certaines de ses attributions sans lui retirer son titre (comme les sceaux qui sont confiés à un garde des sceaux révocable – exemple : Maupoux sous Louis XVI). On peut avoir un vice chancelier. Ses fonctions sont fondamentalement de garder les sceaux. Il y a l’audience du sceau où on présente les lettres royales au chancelier pour qu’il appose le sceau. Le chancelier garde la clé du coffre qui contient les sceaux. Le roi peut imposer au chancelier de sceller car s’il ne le fait pas, c’est pour problème privé. Il est également le surintendant de la justice. Il a autorité sur tous les tribunaux et les magistrats du siège et du parquet ; il peut gérer les conflits de juridiction. Il a également la surveillance des collèges et des universités ; il a aussi la surveillance de l’imprimerie avec la censure. Le chancelier est le chef du conseil en l’absence du roi. Lors des réunions du conseil dans présence du roi, le trône royal est vide à côté du chancelier. Il est la « bouche du roi » car il prend la parole en son nom. Les secrétaires d’Etat Ils ont un rôle clef. A l’origine, les secrétaires d’Etat sont simplement des notaires du roi, mais certains d’entre eux ont reçu le titre de secrétaire (connaît les secrets). Au milieu du XVIème siècle, une conférence internationale pour conclure un traité entre la France et l’Espagne où les secrétaires ont vu que les espagnols portaient le nom de secrétaires d’Etat et ont voulu pareil. Ils n’ont pas le statut d’officier. Ils ont une commission toujours révocable. C’est une noblesse d’origine administrative (moins prestigieux que la guerre). Il faut avoir été maître des requêtes. Leur rôle est le contreseing pour les décisions effectives du roi. Ils sont chargés de mettre en forme les décisions. La répartition du travail entre les secrétaires s’appelle le département. Il y a habituellement quarte secrétaires d’Etat. Ces départements ont un aspect géographique (les provinces du royaume sont divisées) et fonctionnel (d’après la nature des affaires : la marine, affaires étrangères, affaires intérieures, maison du roi). Le contrôleur général des finances Son origine et son statut On a d’abord eu un surintendant général des finances qui avait le pouvoir d’autoriser les finances. Le dernier est Nicolas Fouquet. On a créé à côté de lui un contrôleur. Il tient un contre-registre. Colbert a réussi à se débarrasser de Fouquet. Il n’y avait alors plus de surintendant des finances. C’est désormais le roi qui doit signer les mandats de paiement. C’est un personnage toujours révocable. Ses fonctions Depuis qu’il n’y a plus de surintendant, c’est le roi qui rempli cette fonction. Pour être sûr de ne pas faire signer n’importe quoi au roi, le contrôleur doit donner son visa. II. Les pouvoirs des ministres Les relations des ministres avec le roi C’est le travail des ministres avec le roi. Comme c’est privé, le problème est que l’on se demande si c’est le ministre ou le roi qui décide. Le ministre a un portefeuille dans lequel il transporte ses documents. Pour la question de la direction, tout dépend des cas. Les ministres et leurs collaborateurs Le chancelier a sous son autorité les maîtres de requêtes et les secrétaires du roi. Les ministres sont très bien payés, mais ils doivent payer se leur poche leur coché, leur carrosse. Le contrôleur général des finances a à côté de lui des intendants des finances et des intendants du commerce qui sont des collaborateurs. Il y a les commis (employés de bureau). Ce sont des employés du ministre et non du roi, mais en réalité ce sont des gens très stables qui sont spécialisés. Le ministre change, mais le commis reste. Il y a une hiérarchie (copiste, rédacteur et à la tête, un premier commis qui est un chef). Les ministres et les sujets du roi Les ministres ne sont pas de pouvoir propre ; ce sont des intermédiaires obligés entre le roi et l’ensemble des sujets. Ils envoient des décisions royales. Le ministre a une lettre d’envoi « l’intention de sa majesté est que »). Eventuellement, le chancelier avait un pouvoir autonome. Sous Louis XV on ca essayer de remplacer certains ministres par plusieurs conseils (polysynodie) : un conseil de la guerre, de la marine, etc. Mais cela n’a pas tenu quand il a fallu mettre en place des décisions et progressivement les secrétaires d’Etat sont revenus. On dit que les ministres sont responsables pénalement des décisions qu’ils contresignent. Le roi et l’Etat Louis XIV n’a jamais dit « l’Etat c’est moi ». Au contraire, Louis XIV a dit au moment de mourir exactement l’inverse : « je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours ». A l’échelon régional avec l’officier du roi, on peut dire que la personne physique du roi devient un élément relativement secondaire. Section 2 : les différents domaines d’action du pouvoir royal Deux classifications : La première est due par François Ier. A chaque fois qu’il partait en guerre, il confiait la régence à sa mère : - La défense du royaume - Le devoir de justice - La conduite et police de la chose publique - La législation - Les impositions et les finances - Les grâces Une autre classification est donnée par Guy Coquille (1523-1603) : dans « Institution au droit français » : - La législation : il la compare à la justice : la première partie avec les bonnes lois - La deuxième avec les jugements. - La guerre : - Le domaine de la couronne - Les interventions du roi dans la vie de l’Eglise - La monnaie - Les grâces et les dispenses - Les impôts I. La législation La législation royale et ses formes La forme habituelle est ce que l’on appelle les lettres patentes (= ouvertes). Cela implique des formalités : l’imposition du sceau par le chancelier puis l’enregistrement par les tribunaux royaux : le Parlement soit procéder à la vérification via un enregistrement pur et simple ; aussi les magistrats peuvent aussi refuser d’enregistrer, ce sont les remontrances où le roi peut modifier sa décision, mais le roi peut aussi ordonner l’enregistrement (lettre de jussion) et le Parlement peut refuser à nouveau par de nouvelles remontrances auquel cas le roi peut s’y plier ou le roi peut faire un « lit de justice ». L’utilisation de la forme des lettres patentes est une maxime du royaume. Il peut utiliser les arrêts du conseil. Parfois, l’arrêt du conseil était revêtu de lettre patente et à ce moment là, il était enregistré par les Parlements. Le contreseing suffit à la authentifier. Il y a aussi les ordonnances « sans adresse ni sceau ». Elles sont rédigées à la troisième personne du singulier. A l’inverse les lettres patentes sont rédigées à la deuxième personne du pluriel. La législation royale et sa classification Trois catégories de lois du roi : les ordonnances, les édits et les déclarations royales. L’ordonnance Elle est toujours datée du moi et de l’année. Les ordonnances traitent d’une matière assez vaste (comme les réunions des Etats généraux : la dernière de ce types est celle de Michaud). Puis, de véritables ordonnances de codification (comme sur les eaux et les forêts, la procédure civile, etc.). Les édits Plus limités que les ordonnances et sont datés du moi et de l’année Les déclarations royales Sont datées du jour, moi, année et servent à compléter ou interpréter un édit ; plus ponctuelles. Les arrêts du conseil, les ordonnances sans adresse ni sceau. La législation royale et sont domaine Droit public, organisation de la justice (procédure), impôts, droit pénal (mais limité). Le juge doit se donner en matière pénale à appliquer une loi. Au contraire, dans l’ancienne France, le juge avait la liberté pour adapter la peine et choisir les comportements serait répréhensible ou non. La législation royale est rare dans le droit privé ; quelques ordonnances, mais laisse faire la police civile. II. La justice Il y a la justice déléguée et la justice retenue La justice déléguée Rendue au nom du roi. Cette justice est exercée par des juges royaux, mais depuis la fin du XVIème, on a reconnu que ces officiers sont propriétaires de leur fonction (la nomination par le roi n’est que pure formalité). Ces juges sont indépendants. La décision est le plus souvent rendue par plusieurs juges. Le roi est représenté auprès des tribunaux par les « gens du roi » qui ont le même statut (officiers inamovibles propriétaires) à la différence qu’ils reçoivent des ordres. La justice retenue Le roi peut retenir la délégation : soit pour juger lui même (sur requête), soit faire juger par son conseil en cas d’évocation ou de cassation. Le roi peut exceptionnellement modifier les compétences des tribunaux. Le roi peut créer une commission spéciale pour juger tel ou tel procès (ex : Nicolas Fouquet). Il y a des cas où le roi des lettres de légitimus pour que certains voient leur procès jugé par un tribunal en particulier. III. Les grâces royales et les ordres du roi C'est un droit particulier. On peut dispenser dans un cas particulier de l'application d'un droit commun. Celui qui a le pw de faire la loi a le pw de dispenser dans les cas particulier. ( idée remonte de l'antiquité) Ex : Officiers royaux , conditions d'age. Avoir 25 ans. Dispenses du roi. Légitimation des batards. Ils peuvent être légitimés si leur parents qui n'étaient pas mariés se marient ou par décision royale. En voici une typologie - Lettres de committimus. Lettre qui pour la cause d'une personne, permettait au justiciable de faire juger son procès par une autre instance ou au roi de choisir une autre juridiction. - Lettres de justice permettent la resicion pour lésion. - Les lettres de bénéfices d'inventaire. L'heritier hérite des dettes et des biens du défunt. Cette lettre assure à l'héritier de pouvoir faire un inventaire pour accepter ou non l'héritage. Dans l'ancien régime, il faut adresser cette demande au roi. - Les lettres de graces :fondée sur la pure bienveillance,concédait des avantages sans références à un droit précis en matières pénale ou civile. : un débiteur qui obtient du roi un délai pour payer ses créanciers. - Lettres de cachets ( lettres closes) pour inviter qqun, pour faire appliquer des mesures d'exil ou d'emprisonnement. IV. Les relations internationales et la guerre La diplomatie Les consulats sont rattachés à la marine. Les ambassadeurs sont des représentants aurpès d'un souverain étranger de manière ponctuelle. Depuis le 16eme, ils tendent à devenir permanants. Les premiers sont trouvés à Rome. Selon les postes diplomatiques, l'ambassadeur peuvent être plus ou moins importants. Ministre Plénipotentiaire, qui a tout les pouvoirs. Leur rôle ; Ils représentent en permanance en délégations, assistés de conseilliers. Il présentent notamment les lettres de créances. Les traités. On envoit des plénipotentiaires, qui ont les pleins pouvoirs pour négocier. Les accords sont signés par le minsitre plenipotentiaire et ensuite ratifiés par le roi. L’armée de terre Une armée permanante est apparue à la fin de la guerre de cent ans ( infantrie, cavalerie, artillerie) avec l'impot permanant. Cavelerie : Ex gent d'arme, cavalerie légère ( organisés en régiments ) Les effectifs de l'armée varient entre 10 000 et 400 000 ( sous louis 14). Le capitaine fournit au roi un certains nombre de soldat, on dit qu'il est propriétaire de sa companie et les rémunère. Son successeur lui rachetait (= vénalité) ( idem pour le colonel et le régiment) A coté des grades militaires vénaux, il en existe d'autres comme le major et le lieutenant colonel qui eux ne possède pas d'offices. En 1688 est crée la milice. C'est un Service obligatoire avec un tirage au sort. Le milicien fait un service de garde dans les forteresses pendant que les soldats de métiers sont en opérations. En 1771, réforme du nom contre la méfiance des populations, on les appelles les « troupes provinciales ». L'artillerie apparaît à la fin du MA, « le Génie » construit des fortifications et connait les techniques pour détruire celles des opposants. Ce dernier a besoin d'officiers avec des compétences spécifiques donc création de l'école des Génies. Il existe une adminsitration militaire. Depuis henri II, elle est composée des intendants d'armée qui doivent s'occuper des provisions , du ravitaillement .. Les comissaires des guerres , sous le comissaire ordonnateur, sont des civils qui ont été propriétaires de leur office en premier lieu. Ensuite, ils ont été considérés comme des militaires. La marine Il existe les galères avec un personnel appelé l'équipage. A partir du 16eme ce sont des condamnés,( avant c'était des volontaires). L'arsenal se trouve à Marseilles. En 1748, on supprime les galères. On utilise alors les galériens pour effectuer les travaux dans les ports de marine de guerre. La marine comprend des vaisseaux de guerre lourdement armés, des frégates plus légères et toute sorte de petis batiments. L'idéal pour composer l'équipage ce sont les marins de métier. Pour cela a été établi un un service obligatoire des marins de métiers en fonction des classes. Ils doivent des navigations à la marine royal en fonction de critères comme la famille, l'age .. Ils ont alors un systeme de sécurité social , avantages sociaux et privilège à la fois, c'est le seul corps de métier à posséder cela à l'époque Les intendants de la marine organisent les ports de guerre, ce sont des administrateurs dirigeants. Les consulats sont rattachés à la marine. Ce sont les représentants des français à l'étranger. Au 16eme, ils deviennent des agents du roi avec une juridiction qui permettait aux français établis d'échapper aux juridictions lcoales. La juridiction des consuls de france peut s'appliquer aux français mais aussi pour des indigènes protégés. V. Les finances Ce sont les recettes et dépenses. La notion de budget n'existe pas sous l'ancien régime, il n'existera qu'à partir de 1815. Cependant, on établit l'Etat général des finances. On estime pour l'année à venir les recettes et les dépenses. Il est estimatif. Chaque comptable a un Etat particulier. A la fin de l'année, on a ce qu'on appel l'Etat au vrai. Chaque comptable rendait son Etat à la chambre des comptables pour centraliser et comptabiliser le tout. Les dépenses Militaires – plus de la moitié des dépenses de l'Etat . Même en temps de paix, on dépense pour assurer une guerre ou une défense eventuelle. Batiment - 15 %. Entourage du roi – 9% Ex : Dépense de 3 fois le budget général pour la guerre d'amérique contre l'angleterre sous louis XVI. Il existe des postes de dépenses pour les routes, les pauvres et même la dette. Les finances ordinaires 72 % provenait des impots. Les dettes étaient couvertes par l'emprunt. Traditionnellement les finances sont divisées en deux par une distinction du MA. Ils comprennent les revenus du domaines. Ils sont extrement diverses. On distingue le domaine coporel ( les chateaux , forets ), du domaine incoporel ( le droit des revenus). Les droits dominiaux anciens sont des droits seigneuriaux et féodaux,( passé par la suite dans le domaine royal avec la reconstruction de l'Etat) ( Ex :sur les terres concédées) 1779, supression du servage sur le seigneuries du domaine royal, invitant ainsi les autres à faire de même. - Les droits royaux , ex le droit du roi dans la succession d'un étranger qui n'a pas d'heritier français. - Les droits d'amortissement : quand un bien est donné à l'Eglise, c'est une perte ( car bien de l'E = inalinable) donc paiement d'un droit d'amortissement. - Le droit de franc fief : les roturiers peuvent posséder un fief en payant au roi ce droit qui équivaut à un an de revenu du fief. ( tous ça = ancien ) Les droits dominiaux nouveaux . Ex : actes notariaux obligatoirement enregistrés, droits de timbre Les finances extraordinaires : les impôts royaux Les impôts directs On peut distinguer l’impôt direct traditionnel (la taille) et les nouveaux. a) Le traditionnel : la taille Permanente depuis le XVème siècle. En Bretagne on paye à la place le fouage. La taille a été assortie de suppléments : la crue sous François Ier et Henri II a ajouté le taillon. Sous Henri IV 15 millions ; sous Louis XII 50 millions puis a diminué sous Colbert avec 35 millions et en 1780, 65 millions. Il y a la taille personnelle et la taille réelle : - La taille personnelle est un impôt global sur les revenus estimés de la personne contribuable et doit être payé au premier octobre là où l’on domicile et ce pour tous les biens que l’on possède. Les imposables sont les roturiers. Les roturiers ne payent pas tous la taille ; certains sont privilégiés comme des officiers royaux, les habitants d’un certain nombre de villes (Bourges, Orléans) - La taille réelle. Elle porte sur les biens fonciers. Cela suppose qu’il existe un cadastre nommé « compoix » ; On distingue des terres roturières (taille obligatoire) et les fiefs (pas de taille). On doit payer cette taille là où est la terre. Cette taille est souvent le statut de pays de droit écrit. La taille est un impôt de répartition et non un impôt de quotité. Le gouvernement décide à l’avance combien il faut et va répartir cette somme entre les provinces. C’est le conseiller royal des finances qui la fixe. Ensuite on procède au département de la taille en trois étapes : on répartit ce montant entre les généralités, puis dans chaque on va la répartir entre les élections et enfin on va répartir dans chaque entre les villes/paroisses qui seront répartis entre les foyers (fait par les asséeurs-collecteurs qui sont des habitants élus). Pour lutter contre les abus, on a pris des mesures comme limiter l’exemption des gens qui ont des privilèges pour les terres ; il y a des recherches de non-nobles ; taxations d’offices. b) Les impôts nouveaux Le maréchal de Vauban avait le projet de la dime royale pour remplacer les anciens impôts. Cette idée a été reprise pour créer des impôts en plus des anciennes : - La capitation. Par tête personnelle sur tous les sujets du roi lesquels sont répartis en 22 classes (le premier est le Dauphin et le dernier est le manouvrier). Ca va de 2000 livres à 1 livre. Cet impôt a été supprimé puis rétablis en 1701. - Le dixième. Sur la dixième partie du revenu créé en 1710. Il a été supprimé, mais rétabli en 1715 avec un taux moins élevé : le cinquantième. Il disparaît, mais un nouvel impôt apparaît. - Le vingtième qui est un impôt sur les revenus : sur les revenus mobiliers, sur les offices, d’industrie et des bien-fonds (sur les terres) qui est contrôlé. Les impôts en nature : - La corvée royale des routes. Les habitants proches des routes devaient construire des routes et les entretenir. - Le logement des gens de guerre. Les habitants doivent loger chez eux les soldats de passage. Les impôts indirects - Les aides : certains impôts directs et indirects (sur la viande, les poissons, les métaux, le savon) - Les traites : ce sont des droits de douane. Il y a des douanes intérieures et extérieures. Si l’on sort ou fait entrer des marchandises dans d’autres provinces, on doit payer. Elles sont traitées avec les aides par la ferme générale (entreprise privée importante). - La gabelle : c’est l’impôt sur le sel impopulaire. On distingue plusieurs provinces : les pays de grande gabelle (minimum de consommation obligatoire, on distingue le grenier à sel), les pays de petite gabelle, les pays saline, les pays rédimés, les pays de carbouillon et les pays exempts (Bretagne, Pays de Gex). En 1788 les impôts directs représentaient un peu plus de 48% et les indirects de 51%. VI. Les politiques économiques Dans l’agriculture on peut mentionner la politique traditionnelle de surveillance du commerce des grains (commence dès Saint Louis), la faveur pour les défrichements. Des efforts ont été faits pour favoriser l’élevage avec entre autre des avancées vétérinaires. Les corporations de métier continuent à se développer. A côté de l’artisanat traditionnel il y a les manufactures. Elles reçoivent des privilèges pour avoir des produits de qualité. Il y a également les mines, la protection douanière avec des traités de commerce. Il y a un développement des commerces maritimes. VII. Les affaires religieuses Le roi et l’Eglise catholique D’abord le concorda de Bologne de 1516 entre François Ier et le Pape qui aboli solennellement la pragmatique sanction. Plusieurs dispositions : limitent les interventions du Pape en matière bénéficiaire, réorganise certaines fonctions dans l’Eglise. Les élections des évêques et moines vont changer. Le concordat donne au roi des pouvoirs accrût : quand un siège épiscopale ou d’une abbaye est vacant, le roi propose au pape un nom et s’il accepte il fait l’institution canonique ; si le premier candidat ne convient pas, second candidat et si celui-ci ne convient pas non plus, c’est le pape qui choisi directement. Le ministre de la feuille était un ecclésiastique qui inscrivait les candidats qui se proposaient eu roi. Pour les abbés des monastères, on a vu la pratique des abbés « commende-dataire ». Ce peut être un membre du clergé séculier. Il a un vague pouvoir de commande. La vie des moines va végéter pour les couvents masculins. Lors de la réforme protestante, les souverains se sont emparés des biens de l’Eglise et surtout des monastères. Le roi est resté catholique et a demandé le « don gratuit » conclu au XVIème siècle entre le roi et des membres du clergé français qui s’engage à verser une somme tous les cinq ans. Le Clergé a dût se doter d’une assemblée pour décider du don gratuit. Cette assemblée ne se réuni pas longtemps. Le gallicanisme est une tendance nationaliste de l’Eglise de France à l’intérieur de l’Eglise catholique pour préserver les droits de l’Eglise. Il y en a trois variantes dans la fin de l’ancien régime : le gallicanisme ecclésiastique (prudent qui ne veut pas rompre avec le Pape), le gallicanisme royal (du roi et de son gouvernement qui est fluctuent : ou bien on est conciliant ou bien on accepte le gallicanisme radical) et le gallicanisme parlementaire (ne reconnaissent pas le Concordat de Bologne). En 1682, l’assemblée générale du Clergé de France a affirmé les principes gallicans : l’indépendance du roi en matière temporelle (le Pape ne peut excommunier le roi), le concile général est supérieur au Pape. Louis XIV réaffirme l’autorité des évêques. Il y a une lutte contre le jansénisme, hérésie apparue vers 1640. Louis XIV a fait détuire l’abbaye de Port-Royal et a obtenu du Pape la bulle « unigenitus » de 1713. Le roi et les protestants Luther (allemand) et Calvin (français) vont lancer ce mouvement. Le calvinisme va s’imposer en France. Les guerres de religion commencent en 1562. Les protestants vont construire des églises locales. La communauté locale est administrée par un consistoire. Les églises se réunissent en colloques. Quinze colloques vont former un synode provincial et un synode national se réuni tous les trois ans. Pour se débarrasser des protestant, le massacre de la saint Barthélémy le 24 août 1572. Charles IX avait autorisé le culte protestant à l’extérieur des villes. Il y a eu successivement huit guerres de religions. 1576 : nouvelles mesures, mais n’a pas plu aux catholiques et ont créé la Ligue. L’édit de Nantes en 1598 qui était à l’époque un compromis entre les deux factions : les protestant reçoivent la liberté de culte privé et public (dans certains lieux) et d’enseignement, les pasteurs protestants reçoivent un statut et des privilèges ; autre garantie, les chambre de l’édit. Sous Louis XIII il y a eu une guerre pour lutter contre l’influence des protestants, ce qui a découlé sur l’édit de Grâce d’Alès en 1629 qui, tout en maintenant la liberté de culte supprime les privilèges. Sous Louis XIV certains le persuadent d’éditer l’édit de Fontainebleau en 1685 qui révoque l’édit de Nantes. Désormais les pasteurs protestants sont expulsés et il est interdit d’immigrer. Louis XVI en 1787 a reconnu au protestant l’Etat-civil. On leur reconnaît une liberté religieuse, mais ne peuvent être magistrats. En Alsace, en vertu du traité de Westphalie de 1648, on maintient le statut luthérien et les juifs. Le roi et les communautés juives A partir du milieu du XIIème siècle, il y a eu un certain nombre de mesures d’expulsion de juifs. Une générale en 1394. Aussi le cas de la Provence. Il y avait tout de même une tolérance de fait. Les juifs sont divisés en deux groupes : les Ashkénazes et les Sépharades. La langue des premiers est le yiddish (langue germanique) plutôt que l’hébreu. En 1784 les juifs d’Alsace ont reçu un statut d’ensemble. Ceux du Sud sont d’origine portugaise. A Avignon les juifs étaient protégés par le Pape Chapitre 3 : la justice et l’administration Royales. Section 1 : l’évolution du statut des agents du roi Sous-section 1 : les officiers et les commissaires Le roi délègue son pouvoir de deux manière : soit sous forme d’office ou sous forme de commission I. La distinction de l’office et de la commission L’office est une délégation permanente de l’autorité royale qui permet à son titulaire d’exercer une fonction stable au service du roi. C’est une charte ordinaire fixée par un édit. Loyseau est un juriste de droit public définit l’office comme une dignité ordinaire avec « fonction publique ». L’officier reçoit son titre par une lettre patente qui n’a pas besoin de fixer ses pouvoirs lesquels le sont par la loi et la coutume. La commission est une délégation exceptionnelle pour remplir une fonction ponctuelle. Ex : pour la rédaction officielle des coutumes. La différence de ces fonctions se fait sur leur statut : l’officier est stable ; au contraire le commissaire est librement révocable. Le roi a donc recouru tantôt à l’un, tantôt à l’autre. II. La patrimonialité (ou vénalité) des offices et ses conséquences L’officier, une fois qu’il a reçu ses lettres de provision, il doit être reçu et installer dans ses fonctions. Il est reçu au Parlement et on vérifie si l’on doit accepter son enregistrement. La reconnaissance officielle de la patrimonialité Cela signifie que l’officier est propriétaire de sa charge. Elle n’est pas une nouveauté (depuis le XIVème). Mais la nouveauté est que le roi le reconnaît officiellement au XVIème siècle avec deux aspects : la vente et la reconnaissance de l’hérédité des offices. La vénalité officiellement pratiquée Une mesure de François Ier en 1522 a créé un trésorier « parties casuelles » qui encaissait le prix des offices du roi. Le roi a créé de nombreux offices pour les vendre (ex : les « offices semestre » où chaque officier exerçait pendant six mois). Cela s’est fait non sans réticence puisque l’on a admis la vénalité des offices financiers. En revanche pour les fonctions de justice, c’était choquant car c’était comparé aux fonctions ecclésiastiques. Celui qui achète l’office n’achète pas la fonction, mais prête de l’argent au roi. On fait une distinction entre la finance (somme dépensée pour la fonction) et le titre. La vente entre les particulier : si un officier vend à son successeur. On a appliqué le même système que pour les bénéfices ecclésiastiques : l’officier démissionne en faveur de quelqu’un. Pour éviter l’hérédité, l’officier qui a démissionné doit vivre pendant quarante jours après sa démission, sinon c’est sans valeur. L’hérédité consacrée en 1604 Trois moyens d’admission : - Démission en faveur de quelqu’un. - La survivance. Imite le droit des bénéfices ecclésiastiques où ici le roi nomme le successeur. - La Paulette (1604). Charles PAULET a suggéré à Henri IV une mesure, un impôt qui, si les officiers le payent, pourront transmettre leur office à leur fils au prix d’un soixantième du prix de l’office tous les ans. Si les héritiers ont les capacités, pas de souci. Si les héritiers n’ont pas la capacité, ils vont vendre l’office. Les conséquences de la patrimonialité L’office est une valeur dans le patrimoine de l’officier et c’est aussi une garantie en cas de faute. Un particulier lésé peut forcer l’officier à vendre son office pour payer des indemnités. La patrimonialité a renforcé l’inamovibilité en conduisant à l’indépendance des officiers royaux ; le seul moyen est de supprimer un office. « Chaque fois que le roi crée un office, Dieu crée un sceau pour l’acheter ». Les offices ont été multipliés pour des raisons financières. Si bien que l’on s’est retrouvé avec une collégialité. Si cela a été plutôt utile pour l’indépendance de la justice, en matière administrative, de n’est pas un facteur d’efficacité. Dans les familles s’est formée une véritable dynastie d’officiers. Mais l’inconvénient est que si l’enfant n’a pas beaucoup de qualité, on sera indulgent pour ses faiblesses. Dans ce système il n’y a pas de promotion : pour se faire, il faut acheter un office supérieur. Sur l’économie, cela a amené les officiers à faire des placements stériles. Pour certains offices, il y avait la possibilité d’être anobli. Les officiers étaient peu payés (gages modestes). D’autres profits étaient liés à leur activité. Pour ceux qui travaillent dans la justice il y avait les épices qui sont une rémunération payée par celui qui a perdu son procès. Les officiers sont responsables personnellement de leur caisse. Il y a eu une croissance continue jusqu’au début du XVIIème. C’est possible que ce soit dû par la création de nombreux office par Louis XIV à la fin de son règne. En France, la patrimonialité des offices est très généralisé ; en Espagne, seuls quelques offices de rang inférieur son devenus vénaux. L’indépendance a amené le roi à recourir à la commission. III. Le recours au système de la commission Délégation de pouvoir exceptionnelle par le roi. Exemple : commission destinée à la rédaction des coutumes. La plupart sont ponctuelles, mais d’autres sont permanentes. Un commissaire peut être déplacé. D’abord les ambassadeurs. Depuis le XVIème ils sont permanents, mais restent des commissaires révocables à tout moment. Aussi les intendants des provinces. Le roi peut les déplacer. Toutefois, bien souvent, les commissaires sont recrutés parmi les officiers. Exemple : pour la rédaction des coutumes, ce sont des magistrats du parlement. Les intendants de province sont nommés parmi les maîtres de requêtes du roi. Sous-section 2 : autres catégories de personnel au service du roi I. D’autres types d’agents de l’administration royale Des fonctionnaires de type moderne Ce sont surtout des ingénieurs. Parmi eux « des ponts et chaussées », « de fortification », « constructeur de la marine ». Ils n’achètent pas leur office, mais sont recrutés par concours. Une fois sélectionnés, ils vont dans une école de formation. Une fois la formation terminée, ils ont une affectation avec une hiérarchie : de sous-ingénieur jusqu’à directeur. Il y a un avancement des rémunérations en fonctions du rang. Ils ont un devoir de résidence, d’assiduité. Ils ont un devoir de réserve. Ils ont des avantages annexes : à la fin de leur carrière, on peut leur accorder une pension de retraite. Les subdélégués de l’intendant Représentent indirectement le roi (commis du ministre ou de l’intendant). C’est une fonction peu rémunérée (souvent sont nommés des qui ont déjà un travail). Il y a une hiérarchie : premier commis, sous-chef de bureau, etc. Les entreprises privées au service du roi La ferme générale pour assurer la perception d’impôts indirects. A leur tête, des fermiers généraux. Il y a les correspondants et les tourneurs. Dans chaque circonscription on trouve des directeurs et un personnel de commis de garde. Les fermiers ont le droit à une retraite avec une cotisation sur leur salaire. Les munitionnaires pour fournir les munitions et vivres pour les armées. Ce sont des entrepreneurs privés qui ravitaillent les armées. Le munitionnaire nommait des commis pour être sur les navires. II. Le personnel des armées et sa diversité L’armée de terre Pour l’armée de terre : des officiers nommés par un brevet du roi. Il existe une certaine vénalité : c’est le capitaine qui est propriétaire de sa compagnie. Lorsqu’un officier est malade il peut avoir une grâce du roi (pension). Il y a une exigence de noblesse au début, mais cela change au XVIIIème où il faut en plus des connaissances scientifiques (sont créées des écoles). Il y a les sous-officiers : on commence par le grade de caporal. Il y avait une justice militaire. On y a ajouté les milices. Il y avait des milices garde-côtes qui surveillaient les côtes, ils ont l’avantage de rester sur place. La marine Il y a le personnel des ports des arsenaux de la marine. Il y a un personnel administratif (intendant, commissaire) et un personnel technique (ouvrier maître). Depuis la suppression des galères, les bagnards font les travaux difficiles. Il existe « l’ordre de Malte ». A côté des officiers de carrière il y a les bleus. Ils n’ont pas de carrière (à la fin de la campagne ils sont remerciés). Section 2 : la justice et l’administration traditionnelles assurées par des officiers Ces institutions sont souvent apparues au Moyen-Age. Elles ont connu un développement important avec l’affirmation du pouvoir royal et la multiplication des offices. Dans la plupart des cas ce sont des juridictions et des administrations. I. Les cours souveraine de droit commun : Parlements et Conseils souverains Il s’agit de représenter le roi. Au delà, ces cours souveraines ont prétendu avoir un rôle politique. Louis XIV n’était pas de cet avis en leur don...