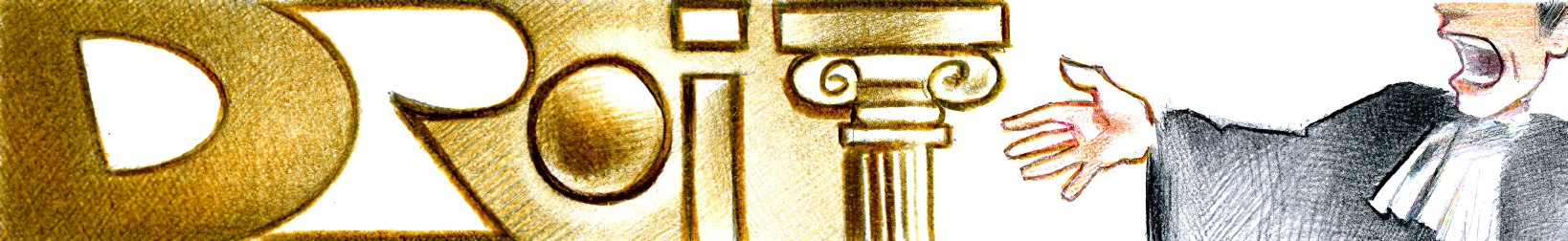[pic] Introduction : Essai de définition : La notion de famille fait entrer en jeu des personnes et des liens entre elles. Mais quel lien ? De plus, doit-on parler de la famille ou des familles ? Le modèle traditionnel de famille a disparu aujourd'hui au profit d'une pluralité de modèles. La famille traditionnelle était fondée sur le mariage, famille appelée anciennement « légitime «, enfants « légitimes. « Hors mariage on parlait de famille « naturelle «, dont les enfants étaient « naturels. « D'autres figures ont été consacrées par la loi : concubinage, PACS en 1999 ; de plus la famille n'est plus nécessairement hétérosexuelle, une famille homosexuelle semblant aujourd'hui pouvoir naître. Si l'on part d'une définition biologique, la famille serait un groupe de personnes unies par le sang. Les limites d'une telle définition apparaissent dès lors, car, seraient exclues d'emblée les familles se créant par l'effet de l'adoption. Elle exclut la définition « volontariste « de la famille. Ce terme signifie que certains actes de volonté peuvent faire naître des liens familiaux, comme le mariage. D'un point de vue psychosociologique, la famille serait un groupe de personnes unies par un vécu commun, voire une affection commune. Les limites apparaissent encore dans la mesure où une famille peut survivre à une absence de vécu commun, en absence de communauté de vie. De plus, en définitive on ne parle souvent de famille qu'à partir du moment où il existe des enfants, ce qui limite une telle tentative de définition. On pourrait donc dire que juridiquement la famille se définit comme un groupe de personnes reliées entre elles par des liens qui seraient fondés sur le mariage et/ou la filiation, c'est-à-dire le fait que le couple ait des enfants : dès lors un couple non marié avec des enfants serait considéré comme une famille. La notion de famille peut néanmoins recevoir une définition différente selon la situation qu'il s'agit de régir : nom, successions etc. Le lien familial : La famille entend nécessairement un ensemble de liens. Ce lien peut donc être issu du mariage, lien d'alliance ou de la filiation, c'est-à-dire un lien de sang, ou de parenté. Mais on n'a pas pu ici définir le lien entre deux personnes non mariées, qui seraient en concubinage ou pacsées, on ne dispose pas de mot pour qualifier ces liens. Le lien de parenté existe quel que soit le lien d'alliance entre les parents. Cette parenté pouvait être de deux natures. Lorsque le lien de parenté était créé dans le cadre du mariage on parlait de lien de filiation légitime ; au contraire, lorsqu'il était hors mariage, on disait qu'il existait un lien de filiation naturelle. À cela il faut ajouter le lien de filiation adoptive, né d'une fiction législative, indépendamment d'un quelconque lien d'alliance. Il faut signifier ici qu'une ordonnance du 4 juillet 2005 venue réformer le droit de la filiation est venue supprimer les termes de filiation légitime et naturelle. En revanche, il faut dire que la distinction sur le fond entre ces deux types principaux de filiation avait déjà disparu, les inégalités de fait n'existaient plus. La parenté peut être divisée en parenté en ligne directe et en ligne collatérale. La ligne directe indique un lien direct entre personnes liées par le sang, c'est le lien qui unit les ascendants avec leurs descendants : parents/enfants par exemple. La parenté en ligne collatérale unit les personnes ayant un auteur commun. L'exemple le plus simple est celui des frères et s?urs qui ont entre eux ce lien, il en va de même pour les cousins, les oncles etc. Le lien d'alliance est fondé sur le mariage, il crée un lien entre les époux, mais aussi chaque époux avec la parenté de l'autre, c'est-à-dire avec la parenté de sang de l'autre. Aspect historique : On a pu distinguer deux conceptions différentes de la famille, selon la priorité donnée aux liens du sang ou à l'alliance. Si l'on privilégie la parenté, on va se trouver en présence de la conception lignage de la famille. Cela peut donc être une conception assez étendue de la famille. Si la préférence est donnée au lien d'alliance, on se trouve en présence de la famille foyer. On tend généralement à passer d'une conception de la famille lignage à la famille foyer. À Rome le cadre de la famille lignage était un cadre où même les enfants majeurs et leurs conjoints restaient sous la puissance de ce qu'on appelait le Pater Familias. Au fur et à mesure de l'évolution du droit romain on a pu assister à un phénomène de rétrécissement de la famille pour arriver à une famille foyer. La même évolution s'est produite en droit français ; l'ancien droit faisant la part belle au lignage, qu'on retrouvait surtout en droit des successions où l'on permettait aux enfants d'hériter et non au conjoint. Le Code civil en 1804 a repris cette conception du droit de la famille, mais la tendance s'est renversée de façon marquée au 19ème siècle. Le lignage a aujourd'hui beaucoup moins d'importance - les frères et s?urs n'ont par exemple aucune obligation d'aide matérielle au sein de la fratrie-, cela est la traduction du fait que la famille est aussi fondée sur d'autres liens que le lien de parenté. Cela se traduit aussi par le fait qu'on ait renforcé en matière de succession le droit des conjoints. On a pu aussi assister au relâchement du lien familial au profit d'une certaine liberté individuelle dans la mesure où le Pater Familias n'existe plus depuis longtemps. La notion de chef de famille a ainsi disparu en 1970. On est arrivé à une égalité entre les divers membres de la famille : entre enfants, entre enfants adultérins aussi, entre hommes et femmes et donc égalité au sein du couple (dans le mariage, en concubinage, etc.), et égalité entre les parents et leurs enfants en ce qui concerne les droits. Toute idée de hiérarchie disparaît donc dans le cadre familial. Les enfants restent bien entendu sous l'autorité des parents jusqu'à leur majorité, notamment du fait d'un devoir de protection. Cette liberté individuelle va servir pour permettre aux membres de la famille de passer des accords, des conventions entre eux, on parle ainsi d'une certaine contractualisation de la famille. On peut par exemple citer le fait que l'on permette aux couples de se mettre d'accord en ce qui concerne la garde de l'enfant dans le cas d'un divorce. La place du droit de la famille dans notre société : On a pu souvent parler de la crise de la famille. Pourtant, dans le même temps, le législateur contemporain s'est beaucoup impliqué dans la question familiale. Ainsi, une loi de juillet 1994 dispose en son article premier que « la famille est une des valeurs essentielles sur laquelle est fondée notre société. « La famille intéresse donc la société. C'est pour cela qu'elle intéresse le droit. Hegel a dit que « si la société est le règne du droit, la famille est le règne de l'amour. « Cela renferme deux idées : les rapports dans la famille ne doivent pas être réglés par des règles juridiques, mais plutôt par des règles autres (morales, religieuses, coutumières etc.) ; et finalement le droit de la famille ne doit imposer de modèles car ce qui cimente la famille sont les rapports humains, les modèles de famille naissent dans les faits et le droit doit venir s'adapter. L'idée d'exclusion du droit des rapports dans la famille n'est pas envisageable. Quand les rapports humains sont paisibles le droit est en réalité presque inutile, mais dès lors que ces rapports sont conflictuels le droit intervenir : partage des biens, garde des enfants etc. Les règles du droit de la famille vont établir les liens entre les personnes, dire qui est membre de la famille etc. La question est aussi de savoir si le droit guide l'évolution des m?urs ou est tenté de s'y adapter. Dans certains cas le droit fixe des modèles, mais cela n'empêche pas que le droit doive parfois s'adapter à l'évolution des m?urs. Les deux idées ne sont donc pas incompatibles. Le droit de la famille est nécessaire et son objet est de réglementer les relations de famille, d'une part en réglementant les relations d'ordre extrapatrimonial (relations personnelles dans la famille : obligation de fidélité entre les époux, de communauté de vie etc.), et les relations d'ordre patrimonial, c'est-à-dire pécuniaires (pécuniaire : masculin et féminin, adjectif neutre !), comme les questions successorales. On s'intéresse ici au droit civil de la famille. Il existe du droit public de la famille : prestations familiales, droit social de la famille etc., qui ne sera pas traité ce semestre. Les sources du droit de la famille : La source principale est le code civil de 1804, qui a subi, en droit de la famille, d'importantes réformes législatives qui, à leur tour, ont donné lieu à énormément de jurisprudence et d'interprétation doctrinale. Un texte ne peut être appréhendé tel quel, il faut toujours chercher à savoir s'il a été interprété. On a pu voir deux séries de grandes réformes du droit de la famille : deuxième moitié du 20ème siècle, puis années 2000. Il faut de plus compter désormais avec les sources internationales : traités internationaux, conventions internationales. Elles prennent une importance considérable : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) - il ne s'agit pas d'un cadre communautaire, elle a été rédigée dans le cadre du Conseil de l'Europe, organisme international indépendant des institutions communautaires-, de 1950. Elle n'a été ratifiée par la France qu'en 1974. Aujourd'hui le Conseil de l'Europe compte quarante-sept membres, étant tous parties de cette CEDH. Cette convention est accompagnée d'une juridiction, la Cour européenne des droits de l'Homme. Notons ici que CEDH est l'abréviation pour les deux derniers termes cités. Cette juridiction supranationale a pour objet d'appliquer les dispositions issues de la CEDH. La CEDH est d'applicabilité directe dans les juridictions nationales, ses dispositions sont donc invocables par tout justiciable d'un pays signataire devant ses juridictions nationales. Si le justiciable n'obtient pas satisfaction devant sa juridiction nationale, lorsque la procédure n'offre plus de solution, il est possible de saisir la CEDH afin de faire condamner le pays pour non-respect des dispositions contenues par le texte de la CEDH. Lorsque le maire de Bègles a célébré un mariage homosexuel, il a été invalidé par l'ensemble des juridictions françaises. Les deux époux ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'Homme pour que la France soit condamnée, ce à quoi elle a répondu que le droit français n'était pas contraire à la CEDH. Autre texte international important : la Convention internationale des droits de l'Enfant (CIDE) ou convention de New York, qui est une convention onusienne. Elle n'est pas accompagnée d'une juridiction spécifiquement créée pour assurer l'application de ses dispositions. Jusqu'en 2005 la Cour de Cassation a refusé l'applicabilité directe de la Convention de New York. Cela était déstabilisant dans la mesure où le Conseil d'État en avait reconnu l'applicabilité directe. En 2005 la Cour de Cassation par deux arrêts est venue dire que les justiciables pouvaient invoquer certaines dispositions de la CIDE devant les juridictions nationales. Le droit a donc subi deux vagues de réformes. Depuis 1964 le droit de la famille a fait l'objet d'un certain nombre de réformes successives : 1965 sur les régimes matrimoniaux, 1970 sur l'autorité parentale (ce n'est qu'en 1970 que disparaît définitivement l'institution de chef de famille : Loi du 4 juin 1970 - Suppression de la notion de chef de famille au profit de l'autorité parentale conjointe), 1975 sur le divorce, avec l'autorisation du divorce par consentement mutuel, ainsi que la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Une deuxième vague de réforme a eu lieu durant les années 2000. Mariage : Deux réformes récentes. Loi du 4 avril 2006 relative aux violences au sein du couple et une loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, loi s'accompagnant d'un décret d'application de mai 2007. La seconde lutte contre les formes de mariages fictifs ou simulés, ainsi que les mariages forcés. Divorce : Loi du 30 juin 2000 pour réformer la prestation compensatoire en matière de divorce, destinée à compenser la disparité de niveau de vie entre les époux après le divorce (il ne s'agit pas d'une pension.) « Capital destiné à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux divorcés et dont le paiement a lieu soit sous la forme du versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. « Loi du 26 mai 2004 venue réformer le divorce : apparition du divorce unilatéral, dont l'établissement a été facilité. Cette loi a refusé l'idée de divorcer par consentement mutuel sans juge. Filiation : Loi de 1970 qui a réformé en profondeur le droit de la filiation. Dès 1972 on avait déjà voulu réduire les inégalités entre enfants nés dans et hors mariage. Ordonnance du 4 juillet 2005 qui a réformé tout le droit de la filiation en profondeur : suppression des différences entre types de filiation, modification du droit de la preuve de la filiation etc. On peut enfin citer un décret d'application du 1er juin 2006. Adoption : Réformée une première fois en 1966. Réforme par une loi du 4 mars 2002. Autorité parentale : Réformée par la loi du 4 juin 1970, qui a supprimé l'institution du chef de famille pour la remplacer par l'institution de l'autorité parentale. Loi du 22 juillet 1983, du 8 janvier 1993 pour instaurer plus d'égalité entre les parents mariés et les parents non mariés (qui à l'origine voyaient leur statut régi de façon différente. Ainsi, le père non marié n'avait pas l'autorité parentale en cas de séparation). Loi du 4 mars 2002 qui a consacré l'égalité entre parents mariés et non mariés. PACS : Consacré par la loi du 15 novembre 1999. L'idée est que le PACS est une figure parallèle au mariage afin de reconnaître l'existence juridique d'un couple hors mariage, y compris dans le cadre d'une relation homosexuelle. Les débats ont été assez compliqués avec des errements quant à la création d'un tel partenariat entre personnes qui n'ont pas l'apparence d'un couple classique. Réforme par une loi du 23 juin 2006 sur la réforme des successions et qui est venue modifier le PACS en améliorant le statut patrimonial des pacsés. Les questions patrimoniales en cas de rupture n'étaient pas totalement résolues par la loi de novembre 1999. Droit patrimonial de la famille : Le droit des successions a été réformé par la loi du 23 juin 2006. A été modifiée, une question de droit des régimes matrimoniaux (relations pécuniaires entres les époux pendant la durée du mariage.) Ces réformes avaient et ont pour but de répondre à des aspirations essentielles de notre société actuelle : on ne pouvait continuer à ignorer les situations de concubinage, d'inégalités entre enfants etc. Les trois grands pôles de ces réformes sont l'égalité (homme/femme, entre enfants, homosexuels/hétérosexuels etc.), la liberté - car on a permis aux époux de divorcer par consentement mutuel, on peut donc décider des conséquences patrimoniales et personnelles du divorce : enfants, résidence, garde alternée etc. On parle de pacte de famille, de convention familiale-, et la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant : consacré par le droit interne depuis de nombreuses années (« le juge décidera en fonction de l'intérêt de l'enfant « etc.), mais aussi au niveau international avec l'article 3-1 de la CIDE qui pose le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces réformes ont aussi cherché à tenir compte de la pluralité des conceptions familiales. Le droit de la famille utilise des notions-cadres : le droit vise parfois des concepts sans les définir car leur contenu est variable, c'est au juge de l'adapter en fonction des circonstances, comme par exemple en vertu de l'intérêt de l'enfant. On peut ainsi prendre l'exemple d'une mère dont l'enfant est né sous X, mais dont le père avait reconnu l'existence avant la naissance (reconnaissance de l'enfant à naître.) Or la naissance sous X a pour effet de faire disparaître l'identité de la mère, identité nécessaire pour reconnaître un enfant. Le temps que le père puisse identifier et retrouver l'enfant une procédure d'adoption avait été lancée. Conflit entre famille adoptive et le père. La Cour de Cassation s'est impliquée dans l'affaire. On a fait produire l'effet à la reconnaissance du père. Le père a néanmoins accepté que l'enfant soit adopté par la famille adoptive, tout en conservant un droit de visite (mais seulement car le père a accepté.) Comment déterminer l'intérêt de l'enfant dans un tel cas ? Ces questions sont difficiles à résoudre. L'application du droit de la famille : Les juridictions de droit commun sont en réalité plutôt inadaptées en ce qui concerne le droit de la famille. Une réforme du 8 janvier 1993 a institué le juge aux affaires familiales (JAF), membre spécialisé du TGI (intervient en première instance), qui regroupe entre ses mains plusieurs compétences autrefois éparpillées entre plusieurs juges. Première partie : Le couple. Titre premier : Le couple marié. Portalis en 1804 définissait le mariage comme « la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. « Idée du mariage in extremis: on admet le mariage de vieillards, de mourants, dans lequel le but de procréation est évidemment absent. Il est difficile en définitive de définir le mariage. C'est à la fois une situation juridique qui va avoir des effets juridiques, c'est un statut juridique, avec des conséquences fiscales et juridiques, mais c'est aussi une dimension affective, morale qui caractérise le droit de la famille. Il est habituel de le définir comme un « acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets, et la dissolution. « Le mariage présente donc trois caractères : un caractère personnel (1), en ce sens qu'il s'agit d'une union personnelle entre deux personnes et non d'une union familiale (les familles n'interviennent pas, en principe, dans la décision du mariage), il revêt aussi un caractère d'interdiction du principe de la représentation : permettre à quelqu'un de nous représenter dans la conclusion d'une convention (on ne peut pas se marier pour quelqu'un d'autre), et c'est un mariage civil, se distinguant du caractère religieux. C'est un acte civil (2) et laïc dans la mesure où la loi ne considère pas valide un mariage simplement religieux. De plus, un ministre du culte quelconque ne peut célébrer un mariage s'il ne reçoit pas confirmation d'un mariage civil préalable (article 433-31 C. pénal.) Le mariage religieux n'est donc pas imposé. Se pose la question dans certains cas de divorce : absence de mariage religieux peut éventuellement être invoquée comme moyen lors d'une demande de divorce pour faute. Le mariage revêt enfin un caractère solennel (3.) Il doit nécessairement être célébré par un officier public en revêtant quelques solennités : notamment intervention de l'officier d'état civil. Un acte consensuel est l'acte qui va produire des effets par le simple échange des consentements, indépendamment de toutes solennités, on parle donc du mariage comme d'un acte solennel, acte produisant des effets que dans le cas où les parties rempliraient certaines solennités particulières énoncées par la loi. Se pose alors la question de savoir si le mariage est un simple contrat ou s'il s'agit d'une institution. Dans la tradition du droit canonique c'est un contrat, né de l'échange des consentements. La notion de volonté était juridiquement au c?ur de la question du mariage. L'article 146 du code civil semble aller dans cette direction, en mettant l'accent sur le consentement des époux : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. « À partir du moment où les époux ont décidé de se marier, ils ne peuvent aller librement, c'est la loi qui va diriger leur action. Tandis que dans le cas d'un contrat classique les termes du contrat sont relativement libres. On ne peut donc considérer le mariage comme un simple contrat civil. Il a un aspect contractuel, mais aussi institutionnel car la loi impose tout un régime à l'encontre duquel la volonté des époux ne peut aller. On pourrait donc dire que le mariage est un acte de volonté par lequel les parties adhèrent à une institution dont le statut a été préétabli par l'autorité publique. Chapitre premier : L'avant mariage. On va donc étudier la valeur juridique des fiançailles. Dès lors qu'il y a rupture des fiançailles se poseront certaines questions de droit. Section une : la liberté du mariage : On parle aussi de liberté matrimoniale, il s'agit d'une liberté publique, garantie par l'État. On parle de liberté publique car l'État va garantir à chacun cette liberté de se marier. On ne parle pas de droit au mariage, car cela reviendrait à dire qu'on peut exiger de l'État qu'il nous permette le mariage. Cette liberté est consacrée en droit positif, mais aussi au niveau international. La Déclaration Universelle des droits de l'Homme en son article 16-1 dispose qu' « à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. « De la même manière, l'article 12 de la CEDH dispose là encore qu'il est possible de se marier, selon les lois nationales concernant le droit de la famille. La liberté de se marier sous-entend donc aussi la liberté de ne pas se marier. §1 - La liberté de se marier. Cela signifie deux choses. C'est une liberté de principe puisqu'en dehors de rares exceptions chacun est libre de se marier ou de se remarier. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne peut priver une personne de se marier, seule la loi peut venir entraver cette liberté. Il n'existe pas, de la même manière, une peine en droit pénal qui viendrait empêcher le condamné de se marier. C'est une liberté d'ordre public, ce qui signifie qu'il s'agit d'une liberté placée au-dessus des volontés individuelles. C'est donc... une liberté impérative. On ne peut donc pas, par principe, renoncer à cette liberté de mariage. Il existe ce qu'on appelle les clauses de célibat qui pourraient être insérées dans un contrat ou dans un testament, qui en principe sont nulles. On peut trouver dans des testaments des clauses de célibat, ce qui veut dire que l'auteur du testament subordonne le legs à la condition que le bénéficiaire ne se marie pas. La jurisprudence fait une distinction selon que la clause affecte une libéralité (acte à titre gratuit : prestation offerte sans contrepartie, idée de donation) ou au contraire un contrat « à titre onéreux « (contrat synallagmatique, ou les parties sont toutes obligées), comme le contrat de travail. L'idée de la jurisprudence est que lorsque la clause de célibat affecte une donation, cela renverse le principe de la liberté patrimoniale, et elle considère que ces clauses sont tolérées, sauf exceptions. Ces clauses peuvent devenir illicites si ses justifications sont mauvaises : race, jalousie etc. En termes de contrats, la clause est toujours en principe illicite. En 1963 il avait été décidé que les clauses de célibat dans un contrat d'hôtesses de l'air étaient illicites. Autre illustration : Clause de célibat (clause de viduité) validée dans un contrat de travail. Cour de Cassation du 19 mai 1978. Une femme travaillait dans un établissement scolaire religieux, licenciée car divorcée puis remariée. La Cour a considéré que des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier la validité d'une clause de célibat, ici le caractère confessionnel de l'établissement semblait pouvoir justifier cette validité. « Il faut que l'on soit dans des hypothèses où les nécessités des fonctions l'exigent impérieusement. « §2 - La liberté de ne pas se marier. Cette liberté est contenue dans le fait que le mariage forcé est prohibé. Tant qu'on n'est pas marié on peut choisir de ne pas se marier : les fiançailles n'ont donc potentiellement aucune force obligatoire quant au fait de se marier. La rupture des fiançailles ne peut donc pas en elle- même être condamnée. Cependant, la jurisprudence autorise des restrictions indirectes au fait de ne pas se marier. Il peut exister des clauses contractuelles qui vont restreindre cette liberté de ne pas se marier, qui subordonnent l'attribution d'un avantage à la condition que le bénéficiaire se marie. On est donc dans la position inverse de la clause de célibat. A priori la jurisprudence ne considère pas ces clauses nulles, sauf dans certaines circonstances, notamment quand elles sont motivées par un motif répréhensible : racial etc. Il existe aussi ce qu'on appelle les conventions de courtage matrimonial. Cette convention de courtage matrimonial permet, moyennant finances, à un courtier de s'entremettre afin de favoriser une rencontre entre deux personnes en vue d'un mariage. On s'interroge afin de savoir si par le biais de ces conventions il n'y aurait pas une atteinte à la liberté de ne pas se marier. La jurisprudence a eu le réflexe jusqu'en 1944 de considérer que ces conventions avaient une cause illicite pour cette raison. Dans un arrêt de 1944 la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a considéré que le courtage n'est pas nul en soi, puisqu'en réalité son objet n'est pas le mariage mais la rencontre, qui, le cas échéant, peut déboucher sur le mariage. Si en revanche cette convention devait donner lieu à des pressions ou à un dol afin de forcer le mariage, ce courtage serait considéré illicite, dans la mesure où cela porterait nettement atteinte à la liberté de ne pas se marier. De même, si le mode de rémunération peut exercer une pression sur les personnes, que cela pourrait être utilisé afin de démontrer le caractère illicite de la convention. Une loi de 1989 est venue réglementer le courtage, une loi relevant du droit de la consommation et non de mariage : droit de rétractation, clauses illicites etc. Les personnes qui adhèrent à cette convention bénéficient donc du régime de protection des consommateurs. Section deux : Les effets des fiançailles. « Les fiançailles sont faites pour être rompues. « En 1838, la Cour de Cassation a décidé que « toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans le mariage. « Il n'y a pas d'engagement juridique qui découlerait des fiançailles. Les fiançailles sont donc un simple fait juridique (rappelons ici qu'un fait juridique se prouve par tout moyen), l'idée étant que cette situation va produire certains effets juridiques, sans pour autant qu'au départ il y ait nécessairement un accord de volonté (quoi qu'en ce qui concerne les fiançailles il y ait un accord, mais pas de contrat en définitive.) Le régime de ce fait juridique va donc entraîner un certain nombre de conséquences. La preuve est libre, et pourra être apportée par tout moyen. §1 - Rupture et responsabilité. A priori, le fait même de la rupture ne devrait pas entraîner de conséquences juridiques. La rupture n'est donc en elle-même pas une faute, puisqu'elle constitue l'exercice de la liberté matrimoniale déclinée en liberté de ne pas se marier. Cependant, ce principe connaît une limite qui est l'abus du droit de rompre. Cela signifie que quand cet abus est caractérisé, la responsabilité civile de l'auteur de la rupture pourra être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil posant le principe de la responsabilité civile délictuelle. « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. « Il va donc falloir la réunion de plusieurs éléments : faute, préjudice et lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Ce qui peut conduire à une telle constatation : D'après la jurisprudence cette faute réside dans la manière de rompre et dans les motifs de la rupture. - Manière de rompre : Il y aura faute si la rupture est jugée incorrecte, injurieuse, ou si elle est tardive. S'agissant de la tardiveté, on se rend compte que plus la rupture est proche de la date prévue du mariage, plus les tribunaux ont tendance à reconnaître la faute. - Motifs de la rupture : Ils peuvent être constitutifs d'une faute lorsqu'on considère qu'ils sont illégitimes. C'est-à-dire que quand la rupture est inspirée par des considérations de fortune, de milieu social, de race, alors on pourra considérer que la rupture est fautive. De la même manière, rompre les fiançailles en prétextant une réprobation familiale générale, pourra être considéré comme constitutif d'une faute. Enfin, rompre des fiançailles à l'annonce de la grossesse ne pourra pas être considéré comme un motif légitime de rupture. On peut donc voir que cette jurisprudence pose un problème de preuve évident. Il faut ainsi être apte à distinguer entre la rupture pour manque d'amour, et la rupture illégitime qui pourrait éventuellement être considérée comme fautive. De plus, est-ce que finalement cette jurisprudence ne constitue pas elle-même une atteinte trop importante à la liberté matrimoniale... ? En droit commun, lorsqu'on demande l'exécution d'une action, on doit prouver ce qui fonde cette allégation (cf. Article 1315 C.civ.) Certains arrêts ont inversé la charge de la preuve, en demandant à l'auteur supposé de la faute de prouver que la rupture n'est pas fautive. En renversant cette charge de la preuve, c'est comme si l'on renversait le principe, et que l'on disait que la rupture est fautive... Dans un arrêt du 4 janvier 1995, on a pu constater une tendance au recul en la matière, dans la mesure où la Cour de Cassation a cassé un arrêt d'appel qui avait déduit cette responsabilité de la seule absence de dialogue préalable. La Cour de Cassation a considéré qu'il appartient bien au demandeur qui allègue une prétention d'en prouver le fondement. De surcroît : période de libéralisation du divorce, retenir comme fautif quelque motif que ce soit dans la justification d'une rupture semblerait assez incohérent. Notons qu'il faut encore pouvoir établir un préjudice : - Moral. Blessure morale, désarroi. - Matériel. Être indemnisé pour les pertes occasionnées par l'annulation du mariage (action de in rem verso peut être engagée en matière de quasi contrat : enrichissement sans cause.) Ce préjudice sera accru en cas de grossesse, si la fiancée délaissée est enceinte ou si elle vient d'avoir un enfant (mère célibataire.) La nature du préjudice influe sur le montant de la réparation. Ici, plus le préjudice est important, plus cela pourra aussi influer sur la caractérisation de la faute (inversion des principes régissant la responsabilité civile en quelque sorte.) Pour autant, l'existence de cette seule circonstance ne suffit pas pour justifier pleinement la condamnation en paiement de dommages et intérêts. è Arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1993 : Rejet d'un pourvoi contre un arrêt qui avait refusé la demande de dommages et intérêts d'une femme qui avait eu une liaison avec un homme marié et qui avait été terminée de la part de cet homme, peu avant la naissance d'un enfant issu de cette union. Cela n'avait donc pas justifié la demande de dommages et intérêts, les juges ayant retenus les motifs selon lesquels l'homme marié n'avait jamais caché sa volonté de rester avec sa femme. §2 - La restitution éventuelle des cadeaux. Il arrive que des ex fiancés souhaitent remettre en cause les cadeaux qu'ils ont pu s'offrir durant la période de fiançailles, la question de leur restitution peut donc se poser juridiquement. Elle s'est surtout posée lorsque le cadeau offert est un bijou de famille. On distingue alors plusieurs catégories. - Présents d'usage : Ce sont des présents d'une valeur pécuniaire insignifiante au regard du train de vie et des habitudes du donateur. Ces présents sont considérés comme définitivement acquis à la personne à qui on les a offerts, et ne peuvent donc pas être restitués après la rupture, quels qu'en soient les motifs. - Les donations faites en faveur du mariage. Elles sont considérées comme étant restituées dans le cas où le mariage ne s'en suivrait pas. Il faut bien sur considérer que ces présents aient une valeur supérieure à celle des simples présents d'usage. Article 1088 C. civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. « Parfois, d'après certaines interprétations jurisprudentielles, ces cadeaux peuvent être conservés, à l'inverse de ce que dit l'article 1088, comme une sorte de compensation lorsque la rupture provient d'une faute du donateur. - La bague de fiançailles. Elle obéit à un sort particulier. Traditionnellement on a considéré qu'elle devait être régie par l'article 1088, on a donc imposé sa restitution lorsque le mariage ne s'en suivait pas. La jurisprudence récente a néanmoins souvent assimilé cette bague à un présent d'usage, dont le principe est donc la non-restitution. - Les bijoux de famille. Qu'il se fut agit d'une bague ou de tout autre bijou, ils doivent être restitués quelles que soient les circonstances de la rupture, quand bien même serait-elle fautive. Chapitre deux : La formation du mariage. En droit civil, l'évolution qui peut être constatée est marquée par le désir de favoriser le mariage, c'est-à-dire en en assouplissant les exigences légales. Les conditions de formation du mariage ne sont pas excessivement contraignantes. Section une : Les conditions de fond du mariage. Toutes ces conditions ne seront pas sanctionnées de la même manière, dans certains cas il y aura nullité relative du mariage, dans d'autres une nullité absolue. §1 - Les conditions d'ordre physiologique : aptitude physique des futurs époux à se marier. L'un des buts concrets du mariage est la procréation. Cependant, on admet le mariage in extremis, ce qui démontre que ce but n'est pas le seul. Un certain nombre de conditions relatives à l'aptitude physique doivent être envisagées : sexe, âge, santé des époux. A - Le sexe des époux. En 1804 le Code civil ne prévoyait pas explicitement la condition de différence de sexes car cela allait de soi. Cette condition se déduit très clairement de l'article 144 du code civil qui réglemente l'âge des époux en faisant référence à l'homme et à la femme. Article 144 : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix- huit ans révolus. « 1 - Le mariage homosexuel. Ce mariage n'est pas admis en France. Cependant, une tendance se dessine aujourd'hui à la libéralisation du mariage homosexuel : Pays-Bas (par deux lois du 21 décembre 2000, entrées en vigueur le 1er avril 2001), la Belgique (2003) et l'Espagne (2005.) Il ne faut bien entendu pas confondre ces législations avec celles permettant le partenariat entre deux personnes du même sexe (PACS depuis le 15 novembre 1999 en France, partenariat enregistré en Grande-Bretagne etc.) Puisqu'en 1804 il n'a pas été jugé utile d'insérer une règle spécifiant le sexe des mariés. En 2003, le maire de Bègles a souhaité célébrer un tel mariage, annulé par le TGI de Bègles, la Cour d'appel de Bordeaux et enfin, la Cour de Cassation qui a rejeté ce pourvoi le 13 mars 2007. Il faut donc attendre soit une modification de la législation, soit une condamnation de la France par la cour européenne des droits de l'homme. Cependant, la CEDH a déjà été évoqué par ces époux homosexuels, mais devant les juridictions nationales cela n'a pas été reçu. Les voies de recours internes n'ont pas répondu favorablement à leur demande, l'affaire est maintenant portée devant la CEDH. 2 - Le mariage des transsexuels. Sur le plan des principes ce problème est important. Le transsexualisme est un symptôme médicalement reconnu. La notion de sexe est complexe. Sur le plan scientifique il est le produit d'éléments anatomiques, génétiques et psychologiques. Il arrive que ces éléments ne coïncident pas ou plus, et que l'élément psychologique du sexe ne corresponde pas avec les éléments anatomiques et génétiques. C'est ici le problème du transsexualisme. Le transsexualisme peut être défini comme « le sentiment irrésistible est inéluctable d'appartenir à un sexe opposé à celui qui est génétiquement, anatomiquement, et juridiquement le sien avec le besoin prépondérant ou obsédant de changer d'anatomie et d'état « (civil.) Sur le terrain juridique : les revendications des transsexuels se sont orientées vers une demande de changement d'état civil : changement de nom et de sexe. La position de la jurisprudence française : Pendant dix-sept ans la Cour de Cassation a répondu par la négative à ces questions. Quatre arrêts du 21 mai 1990 : affirmation du fait que le transsexualisme ne peut être considéré juridiquement comme un véritable changement de sexe, même lorsqu'il est médicalement reconnu. Malgré cette formulation, avait été autorisé le changement de prénom, mais pas le changement de sexe. Textes invoqués : CEDH : article 8 invoqué (garantit le droit à la vie privée), article 12 (vise le droit de se marier, et à une vie familiale normale.) La cour européenne des droits de l'Homme avait d'abord été saisie par des ressortissants britanniques, et avait rendu un arrêt du 17 octobre 1986 relative à l'affaire Mark Rees, et avait refusé de condamner le droit positif du Royaume-Uni, avait donc considéré que le refus d'admettre le changement d'état civil d'un transsexuel n'était pas contraire à l'article 8 parce que les autorités britanniques refusaient le changement, mais admettaient la délivrance de documents officiels avec l'indication du sexe de leur choix. Dans la vie de tous les jours, l'atteinte à la vie privée était donc considérée comme non-réalisée. Dans le même arrêt elle a considéré que l'article 12 ne concernait que le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent. Dans un arrêt du 25 mars 1992, la CEDH a condamné la France après les arrêts de la Cour de Cassation du 21 mai 1990, en estimant que cette jurisprudence violait l'article 8. Pourquoi cette évolution entre 1986 et 1992 ? Cela s'est fait car en France la fréquence de révélation du sexe par les documents officiels était très importante (carte de sécurité sociale etc.), ce qui, comme le changement du sexe sur les documents officiels autres qu'état civil n'était pas permis, constituait à l'égard des transsexuels une violation de l'article 8. Cela a donc entraîné une modification de la jurisprudence française. La Cour de Cassation a donc modifié sa position, par un arrêt du 11 décembre 1992. En se fondant sur l'article 9 du code civil et sur l'article 8 de la CEDH, elle est venue admettre clairement le changement d'état civil des transsexuels, de manière à ce qu'il indique le sexe dont on a l'apparence. Il faut bien évidemment être en présence d'un transsexualisme médicalement constaté. Enfin, dans l'arrêt Christine Goodwin du 11 juillet 2002 de la CEDH à l'encontre du Royaume-Uni, et a changé sa position de principe et impose désormais aux États parties à la CEDH de reconnaître juridiquement l'identité sexuelle des personnes, et plus particulièrement des transsexuels. A partir du moment où l'on accepte le changement de sexe à l'état civil, il va falloir envisager les questions de mariage et de filiation. On se pose d'autant plus la question que quand la CEDH a tranché la question du changement d'état civil en 1992 et en 2002, elle n'a pas étudié les problèmes de mariage et de la filiation. S'agissant du mariage, on va étudier la question du mariage, et celle du mariage préexistant. En ce qui concerne le « nouveau mariage «, conclu après changement d'état civil, rien ne s'oppose à ce qu'une personne qui a obtenu ce changement de la mention du sexe sur l'acte d'état civil se marie avec une personne dont l'apparence et le sexe juridique seraient différents, mais dont le sexe anatomique serait éventuellement identique. En revanche, il faut imaginer que cela peut poser des problèmes relatifs au consentement : celui qui aurait épousé un transsexuel sans être au courant de son état. Cela pourrait être considéré comme une erreur : un vice de consentement. S'agissant d'un mariage préexistant la question est différente. Les personnes mariées étaient de sexe différent, mais après changement de sexe on se retrouve avec un mariage homosexuel. Il n'y alors pas de nullité automatique du mariage dans la mesure où au moment où le mariage a été formé il n'y avait aucun défaut dans les conditions de sa formation. Un divorce sera en définitive tout à fait envisageable, notamment aujourd'hui avec la libéralisation du mariage. Aujourd'hui, on ne peut donc vraisemblablement plus invoquer comme empêchement au mariage l'incapacité de procréation. En revanche, ces mêmes questions pourront être portées sur le terrain du consentement, s'il y a eu dissimulation en vue de produire le mariage. B - L'âge des époux. Durant très longtemps cet âge était différent selon que la personne était un homme ou une femme : 15 ans pour les femmes, 18 ans pour les hommes. Cet âge a été ramené à 18 ans par une loi du 4 avril 2006. Dorénavant, l'article 144 dispose que « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. « Cela avait notamment pour but d'éviter les mariages forcés. Cette condition d'âge n'est pas liée à la majorité civile, mais à l'aptitude physiologique à se marier. Avant 2006, 15 ans pour les filles, avec consentement des parents avant la majorité. Il faut savoir qu'un système de dispense est prévu à l'article 145, le mariage pouvant être autorisé avant 18 ans pour « motifs graves «, le procureur de la République pouvant autoriser cette dispense d'âge. Il existe aujourd'hui près de 400 dispenses d'âge en France par an, notamment en cas de grossesse. C - La santé des époux. Faut-il être en bonne santé pour se marier ? Le droit français répond par la négative. Une réponse affirmative aurait pu être synonyme de dérives et d'atteintes portées à la vie privée. Aucune affection physique, aucune maladie, aussi grave soit elle, ne peut s'opposer au mariage de celui qui en souffre, à condition que cette personne puisse exprimer son consentement clairement et que le consentement de son conjoint ait été donné en connaissance de cause. Il faut néanmoins savoir qu'une position préventive est adoptée. On tente d'appeler l'attention des époux sur les conditions de santé souhaitables avant de se marier. On exige ainsi un certificat médical avant le mariage : le certificat prénuptial (datant de moins de deux mois avant le mariage). Le contenu est bien entendu protégé par le secret médical, l'époux n'étant lié que par une pression morale quant à la divulgation des informations le concernant à son futur époux. Ce certificat prénuptial est nécessaire car l'officier d'état civil doit être en sa possession avant de procéder aux solennités nécessaires (publication des bans etc.), avant de procéder au mariage. On admet en droit positif le droit des mourants, mariage in extremis. Peut importe en définitive la santé et l'aptitude à procréation des futurs époux. On admet aussi le mariage posthume. - Mariage in extremis. La seule condition est que le mourant soit en état de donner son consentement. Ce consentement doit être lucide et les formalités du mariage peuvent être adaptées puisque l'officier d'état civil peut se déplacer au domicile des mourants. - Mariage posthume. Cette figure a été admise par une loi du 31 décembre 1959, et qui concerne le cas où l'un des époux avait déjà effectué les formalités nécessaires antérieures au mariage, mais décède avant la célébration du mariage. L'accomplissement de ces formalités marquait sans équivoque la volonté du défunt de se marier. Cela est visé à l'article 171 du Code civil, et c'est au Président de la République de décider d'autoriser ce mariage, pour motifs graves là encore. Le Président va apprécier discrétionnairement la situation, aucun recours n'est donc envisageable après sa décision. Pour éviter que cela se transforme en une chasse aux successions, ce mariage n'entraîne aucun effet patrimonial : aucun droit dans la succession du défunt dans un mariage posthume. En 1959 un intérêt juridique justifiait cela dans la mesure où cela permettait aux enfants légitimes d'exercer leurs droits relatifs à la succession. Aujourd'hui la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels n'existe plus, cela semble donc être superflu en matière de succession de l'enfant. §2 - Les conditions d'ordre psychologique : les conditions liées à la volonté des époux. La volonté des époux est une condition primordiale dans le déroulement du mariage. Il faut donc consentement personnel, libre et éclairé, afin de permettre le mariage ; cependant, ce seul consentement n'est pas toujours suffisant. A - Le consentement. L'exigence de ce consentement est posée à l'article 146 du Code civil qui dispose «qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. « Il faut que le consentement existe et qu'il soit exempt de vices. Le consentement doit donc être intègre. 1 - L'existence du consentement. Les époux doivent échanger leurs consentements devant l'officier d'état civil. Les témoins doivent pouvoir témoigner du bon échange des consentements. Il peut y avoir un défaut dans le consentement : il faut donc chercher à savoir si la volonté exprimée par les époux correspond à leur volonté réelle. Ce consentement est-il conscient et sérieux ? a) La question du consentement conscient. Celui qui a donné son consentement était-il en pleine possession de ses moyens ? Cela recouvre des cas extrêmes : démence, etc. Mais on peut aussi imaginer une privation temporaire de l'usage de la raison : emprise de la drogue ou de l'alcool. La question des troubles mentaux est intéressante. Est-ce que l'incapacité de consentir signifie l'interdiction du mariage aux aliénés mentaux ? Il faut distinguer selon la situation. - Personne malade. La personne atteinte de troubles mentaux et n'étant pas représentée ne peut être autorisée par un tiers. Dès lors les règles de droit civil devraient être appliquées. La jurisprudence a dit que l'incapacité à consentir dans ce cas ne pouvait être déclinée en incapacité à mariage. Elle a dit qu'il fallait exiger la preuve de l'inconscience de la personne atteinte de troubles mentaux au moment du consentement. On a parlé de jurisprudence des intervalles lucides. Le mariage ne peut être annulé si le consentement a été donné dans un intervalle lucide. Sur le plan de la preuve cela peut être difficile à prouver. Se pose la question de la charge de la preuve en matière de lucidité au moment du consentement. Sur ce point la réponse de la jurisprudence n'est pas claire, elle a traditionnellement admis que l'intervalle lucide devait être présumé. Exemple : Arrêt de la 1re chambre civile du 2 décembre 1992 : Les membres de la famille d'une personne demandaient la nullité de son mariage pour absence de consentement, et qui soutenaient à l'appui de leurs prétentions que l'intéressé souffrait depuis sa naissance d'un certain infantilisme cérébral. Ils produirent un certificat médical pour cela, mais le chef de service d'un hôpital qui connaissait le patient établit que l'intéressé était lucide au moment du mariage. La Cour avait donc rejeté cette demande d'annulation car la famille ne prouvait pas qu'au moment du mariage, l'état de l'intéressé l'empêchait d'exprimer sa volonté. - Personne soumise à un statut protecteur particulier. La personne est déclarée comme juridiquement incapable. Cela implique qu'elle sera parfois assistée ou représentée pour les actes de sa vie quotidienne. La personne qui est censée représenter la personne incapable pourra donner son autorisation. Notons qu'on trouve bien entendu des arrêts contraires. Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 1980 une position contraire était admise, le mariage fut annulé pour insanité d'esprit constatée par observation de l'état habituel du vieillard. On a donc renversé la charge de la preuve. Il faut néanmoins privilégier la première solution dans la mesure où la liberté du mariage est une liberté fondamentale et qu'elle doit être protégée. La loi du 5 mars 2007, nouvel article 414 al. 1 C. civil (entrera en vigueur en 2009) avait réformé le droit des incapacités et consacre cette solution de l'intervalle lucide. Le majeur incapable ne fait bien sur ici l'objet d'aucune mesure particulière. On fait peser la charge de la preuve du trouble mental, et de l'absence de consentement, sur celui qui demande l'annulation du mariage. b) Le consentement doit être sérieux. Problème des mariages fictifs, simulés, blancs. On entend par « consentement sérieux «, que ce consentement est l'affirmation des époux de vivre une vraie vie conjugale, mais aussi d'assumer toutes les conséquences personnelles ou matrimoniales que ce consentement engendre. Il arrive que certaines personnes n'aient pas de véritable volonté de se marier, mais entrent dans les liens du mariage dans le but d'obtenir l'un ou tous les avantages liés au mariage (obtention d'un permis de séjour etc.) La loi du 24 juillet 2006, loi « Sarkozy II « relative à l'immigration et l'intégration, tente de rendre moins attractif le mariage d'un étranger et d'un français. Dorénavant l'article 21-2 du Code civil dispose que l'étranger ou l'apatride qui contracte un mariage avec un conjoint de nationalité française pourra, à l'expiration de quatre ans à compter du mariage, obtenir la nationalité française. On doit pouvoir constater de l'effectivité d'une communauté de vie matérielle. La délivrance d'un titre de séjour pour le conjoint d'un français n'est plus octroyée de plein droit. Les mariages sans intention matrimoniale doivent-ils être considérés comme nuls ? La Cour de Cassation s'est prononcée là-dessus dans un arrêt « Appietto « du 20 novembre 1963 et a donné un critère pour étudier cela : lorsque les époux, quand ils se sont mariés, n'ont eu en vue que des avantages étrangers à l'union matrimoniale on considérera que le mariage est nul faute de véritable consentement sur la base de l'article 146 du code civil. A l'inverse, lorsque au moins un des effets du mariage a bien été recherché, on considérera que ce mariage est valable, même s'il s'agit d'un mariage à effets conventionnellement limités. Mise en ?uvre difficile. On a fini par considérer que tout mariage fictif était nul dès lors que l'intention matrimoniale faisait défaut. Sont très souvent annulés des mariages, soit sur demande d'un des époux, soit du ministère public, lorsqu'il y a défaut de cohabitation ou défaut de consommation. La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 septembre 1999 relatif à un défaut de cohabitation, a annulé le mariage d'une française locataire avec le neveu des bailleurs organisés en contrepartie du paiement d'un arriéré de loyer. L'épouse vivait en concubinage avec un tiers. Il y a tout de même eu une autre manière d'interpréter la loi, la Cour de Cassation ayant parfois refusé d'annuler le mariage, mais d'en annuler les effets frauduleux recherchés (affaire de mariage, remariage en but d'obtenir la nationalité française.) Pour qu'il y ait consentement valablement donné il faut qu'il soit réel et sérieux, mais il doit aussi être intègre. 2 - L'intégrité du consentement. Il s'agit ici d'examiner la théorie des vices du consentement (ici : erreur et violences, le dol étant exclu.) Le consentement ne doit pas être affecté d'un vice, il doit donc être exprimé en toute liberté et en connaissance de cause. Si ce consentement a été donné suite à une erreur ou à des pressions, on considérera que le consentement n'est pas éclairé (erreur), ou libre (pressions.) On a donc adapté la théorie des vices tirée du droit des contrats, qui comporte en plus de cela le dol. Seules l'erreur et la violence sont admises en droit du mariage. Le dol ne l'est pas : « En matière de mariage, trompe qui peut « (Loysel.) Le dol concerne toutes les man?uvres par lequel le cocontractant va provoquer une erreur chez son cocontractant. On s'est rendu compte qu'il était difficile de distinguer cela du fait de la séduction qui peut mener au mariage. La distinction entre la man?uvre dolosive et la séduction classique n'était pas aisée. a) L'erreur. C'est une fausse représentation de la réalité qui consiste à croire vrai ce qui est faux, et inversement. L'erreur est ici régie par l'article 180 du code civil. Historiquement seule l'erreur dans la personne permettait d'annuler le mariage. Cela avait été interprét&eacu...