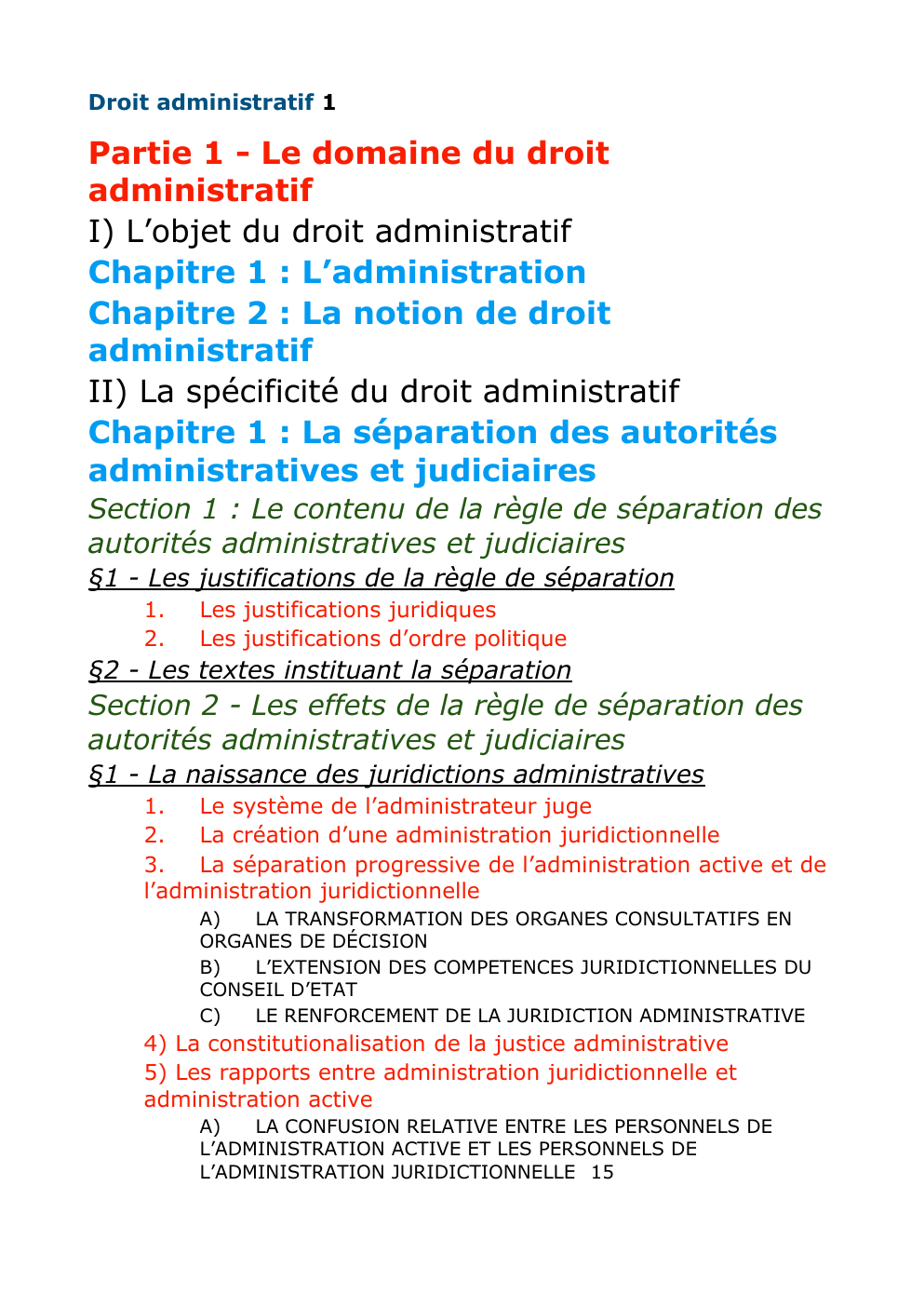Cours de droit administratif L1
Publié le 17/04/2025
Extrait du document
«
Droit administratif 1
Partie 1 - Le domaine du droit
administratif
I) L’objet du droit administratif
Chapitre 1 : L’administration
Chapitre 2 : La notion de droit
administratif
II) La spécificité du droit administratif
Chapitre 1 : La séparation des autorités
administratives et judiciaires
Section 1 : Le contenu de la règle de séparation des
autorités administratives et judiciaires
§1 - Les justifications de la règle de séparation
1.
2.
Les justifications juridiques
Les justifications d’ordre politique
§2 - Les textes instituant la séparation
Section 2 - Les effets de la règle de séparation des
autorités administratives et judiciaires
§1 - La naissance des juridictions administratives
1.
Le système de l’administrateur juge
2.
La création d’une administration juridictionnelle
3.
La séparation progressive de l’administration active et de
l’administration juridictionnelle
A)
LA TRANSFORMATION DES ORGANES CONSULTATIFS EN
ORGANES DE DÉCISION
B)
L’EXTENSION DES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES DU
CONSEIL D’ETAT
C)
LE RENFORCEMENT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
4) La constitutionalisation de la justice administrative
5) Les rapports entre administration juridictionnelle et
administration active
A)
LA CONFUSION RELATIVE ENTRE LES PERSONNELS DE
L’ADMINISTRATION ACTIVE ET LES PERSONNELS DE
L’ADMINISTRATION JURIDICTIONNELLE 15
B)
L’INTERVENTION CROISSANTE DU JUGE DANS LE
FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION ACTIVE
§2 - La naissance et l’essor du droit administratif
Section 3 - Les difficultés soulevées par la
séparation entre les autorités administratives et
judiciaires
§1 - Les conflits d’attributions
1) L’apparition des procédures de conflit d’attribution et du
tribunal des conflits
A.
B.
L’ANTÉRIORITÉ DES PROCÉDURES
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
2) Les règles applicables à la procédure de conflit positive
A.
LES CONDITIONS CONSTITUTIFS D’UN CONFLIT POSITIF
1.
L’objet de la procédure de conflit positif
2.
Les tribunaux pouvant être saisi d’une procédure de
conflit positif d’attribution
3.
Les matières dans lesquelles le conflit positif peut être
élevé
B.
LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 3) Les règles applicables à la procédure de conflit négatif A. LE REGLEMENT DES CONFLITS NÉGATIFS B. LA PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS ET LES AUTRES MECANISMES DE RESOLUTION DES DIFFICULTES DE COMPETENCES. §2 : Le tribunal des conflits : le juge du fond §3 - Les critères de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 1) 2) 3) L’ère des “conflits de prestige” L’arrêt Blanco et l’avènement du critère de service public Les crises du service public A. LA REMISE EN CAUSE DE L’ELEMENT FORMEL 1. L’identification des services publics industriels et commerciaux 2. Les règles de compétences juridictionnelles appliquées aux SPIC B; LA REMISE EN CAUSE DE L’ELEMENT ORGANIQUE 1. L’existence de services publics gérés par des personnes privées 2. Les règles de compétences appliquées au service public gérées par les personnes privées §4: Le domaine de compétence exclusif du juge administratif §5 : Les exceptions aux règles de répartition des compétences de droit commu 34 1) Les hypothèses de concurrence entre les deux ordres de juridictions A. B. C. Les données du problème LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL LA COMPÉTENCE DU JUGE PÉNAL 34 35 2) Les hypothèses de compétences exclusives du juge judiciaire 35 A. LES LITIGES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE JUDICIAIRE B. LE JUGE JUDICIAIRE GARDIEN TRADITIONNEL DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DU DROIT DE PROPRIETE 1. Les hypothèses visées par les textes 2. La théorie jurisprudentielle de voie de faits 3. L'emprise Chapitre 2 : Les juridictions administratives I) L’identification des juridictions administratives §1 : La notion de juridiction A) B) La qualification opérée par un texte La qualification opérée par la jurisprudence 1. 2. 3. L’EXISTENCE D’UN POUVOIR DE DÉCISION L’EXIGENCE DU CARACTERE COLLEGIAL DE L’ORGANISME L’EXIGENCE TENANT A LA NATURE DE LA MISSION EXERCEE §2 : La notion de juridiction administrative II) Les juridictions administratives de droit commun III) Section 1: Les tribunaux administratifs §1 : L'organisation des tribunaux administratifs §2: Les attributions des tribunaux administratifs Section 2: Les cours administratives d'appel §1: L'organisation des cours administratives d'Appel §2: La compétence des cours administratives d'appel §3: La fonction du juge d'appel Section 3 : Le conseil d’État §1 : L'organisation du conseil d'Etat §2 : La compétence du Conseil d’Etat en tant que juge de cassation : 1) Les cas d’ouvertures du recours en cassation 2) Les moyens de cassation A. B. C. LE CONTROLE DE LA REGULARITE EXTERNE DES JUGES LE CONTROLE DE LA REGULARITE INTERNE DES JUGEMENTS 1. Le contrôle de l’erreur de droit 2. Le contrôle de l’erreur de fait 3. Le contrôle de la qualification juridique des faits LA DECISION DU JUGE DE CASSATION Partie II : Les Actes Administratif 51 I) L’acte administratif unilatéral 51 Chapitre 1 : La notion d’acte administratif unilatéral Section 1 : Les actes administratifs émanant d’organes non administratifs §1 : Les actes administratifs adoptés par des organes juridictionnels §2 : Les actes administratifs adoptés par les organes participant aux pouvoirs législatifs §3 : Les actes administratifs adoptés par les personnes privées Section 2 : Les actes non administratifs émanant d’organes administratifs §1 : Les actes législatifs §2 : Les actes de gouvernement 1) La conception originelle de la notion d’acte de gouvernement 2) La conception actuelle de l’acte de gouvernement A. LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ACTES DE GOUVERNEMENT 1. Les actes de l’exécutif se rattachant aux relations internationales 2. Les actes de l’exécutif en relation avec l’organisation des pouvoirs publics B. LE RECUL CONSTANT DE LA CATEGORIE DES ACTES DE GOUVERNEMENT Chapitre 2 : L’élaboration des actes administratifs unilatéraux Section I : L’autorité compétente §1 : La compétence ratione materiae 1) Le principe 2) Les hypothèses les plus courantes d’incompétence ratione materiae A. L’EMPIÈTEMENT D’UNE AUTORITÉ SUPÉRIEURE SUR LES COMPÉTENCES D’UN SUBORDONNÉ B) L’EMPIÈTEMENT D’UNE AUTORITÉ SUBORDONNÉE SUR LES COMPÉTENCES D’UNE AUTORITÉ HIÉRARCHIQUEMENT SUPÉRIEURE 3) Les exceptions aux règles de compétences ratione materiae 1. 2. 4) Les conditions de la délégation Les effets de la délégation la suppléance et l’intérim §2 - Les règles ratione loci §3 - Les règles ratione temporis 1) Les décisions prises par les autorités non encore investies ou qui ont cessé d’être investies 2) Les décisions anticipées et les décisions tardives 3) Les décisions rétroactives §4 - Les dérogations exceptionnelles aux règles de compétence : la jurisprudence sur les fonctionnaires de fait Section II - La procédure d’adoption et la forme des actes administratifs §1 - La procédure d’adoption de l’acte 1) Les consultations préalables A. LES CONSULTATIONS FACULTATIVES B. 2) 3) LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES 1. L’avis rendu est facultatif 2. L’avis rendu a une portée obligatoire 3. Les consultations ouvertes 63 Les enquêtes préalables 63 Le principe du contradictoire 62 63 A. DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS AVANT L’INTERVENTION DE CERTAINES DECISIONS 64 1. Champ d’application du principe du contradictoire 2. Mise en oeuvre du principe B. REGLES APPLICABLES A CERTAINES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 66 §2 - Les formes de l’acte administratif 67 1) Les actes à caractère explicite et les actes à caractère implicite 67 2) La motivation des actes administratifs 67 A. DOMAINE DE L’OBLIGATION DE MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS 67 1. Les hypothèses visées par la loi du 11 Juillet 1979 67 2. Les autres hypothèses de motivation obligatoire des actes administratifs 68 3. Exceptions à l’obligation de motivation 68 B. CONTENU ET SANCTION DE L’OBLIGATION A MOTIVER 68 3) Les principales formes et les effets des actes administratifs unilatéraux 69 A. LES DONNEES DU PROBLEME : LA DISTINCTION ENTRE LES ACTES DECISOIRES ET LES ACTES NON DECISOIRES69 B. LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX A CARACTERE NON DECISOIRE : LES MESURES PREPARATOIRES, LES CIRCULAIRES ET LES DIRECTIVES 69 1. Les mesures préparatoires 69 2. Les circulaires 70 3. Les directives 72 C. LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX DECISOIRES NE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR : LES MESURES D’ORDRE INTERIEUR 73 1. La notion originelle de mesures d’ordre intérieur 73 2. Le recul de la notion de mesures d’ordre intérieur dans le cadre des décisions touchant à l’aménagement intérieur des services 74 3. Le recul de la notion de mesures d’ordre intérieur dans mesures prises à l’encontre des militaires et détenus 74 Chapitre 3 : L’application des actes administratifs 76 Section 1 : L’acte administratif unilatéral et l’information des administrés 77 §1 - La publicité des actes administratifs 1) 2) 77 L’objet des règles de publicité 77 Modalités de publicité des actes administratifs 78 §2 L’accès des administrés aux documents administratifs 78 1) Champ d’application du droit accès 78 A. B. C. 2) DOCUMENTS CONCERNÉS 78 HYPOTHÈSES D’EXCLUSION DU DROIT D’ACCÈS 79 HYPOTHESES DE RESTRICTION DU DROIT D’ACCES 79 Les modalités de communication 79 Section II : L’exécution de l’acte administratif 80 §1 - Le privilège du préalable et ses limites 80 1) Sanctions pénales et administratives 80 2) Recours à l’exécution forcée 81 3) Les hypothèses dans lesquelles l’exécution forcée est exclue 81 §2 - La suspension de l’exécution des décisions administratives 82 1) 2) Le domaine du référé suspension 83 Les conditions du référé suspension83 A. L’URGENCE 83 Section 3 : La sortie de vigueur de l’acte administratif unilatéral 85 §1 - Prise en compte de la nature des droits en cause 85 §2 -.... »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- administratif, droit (cours de droit public).
- acte administratif (cours de droit public).
- administratif, droit (cours de droit).
- Cours de droit administratif des biens