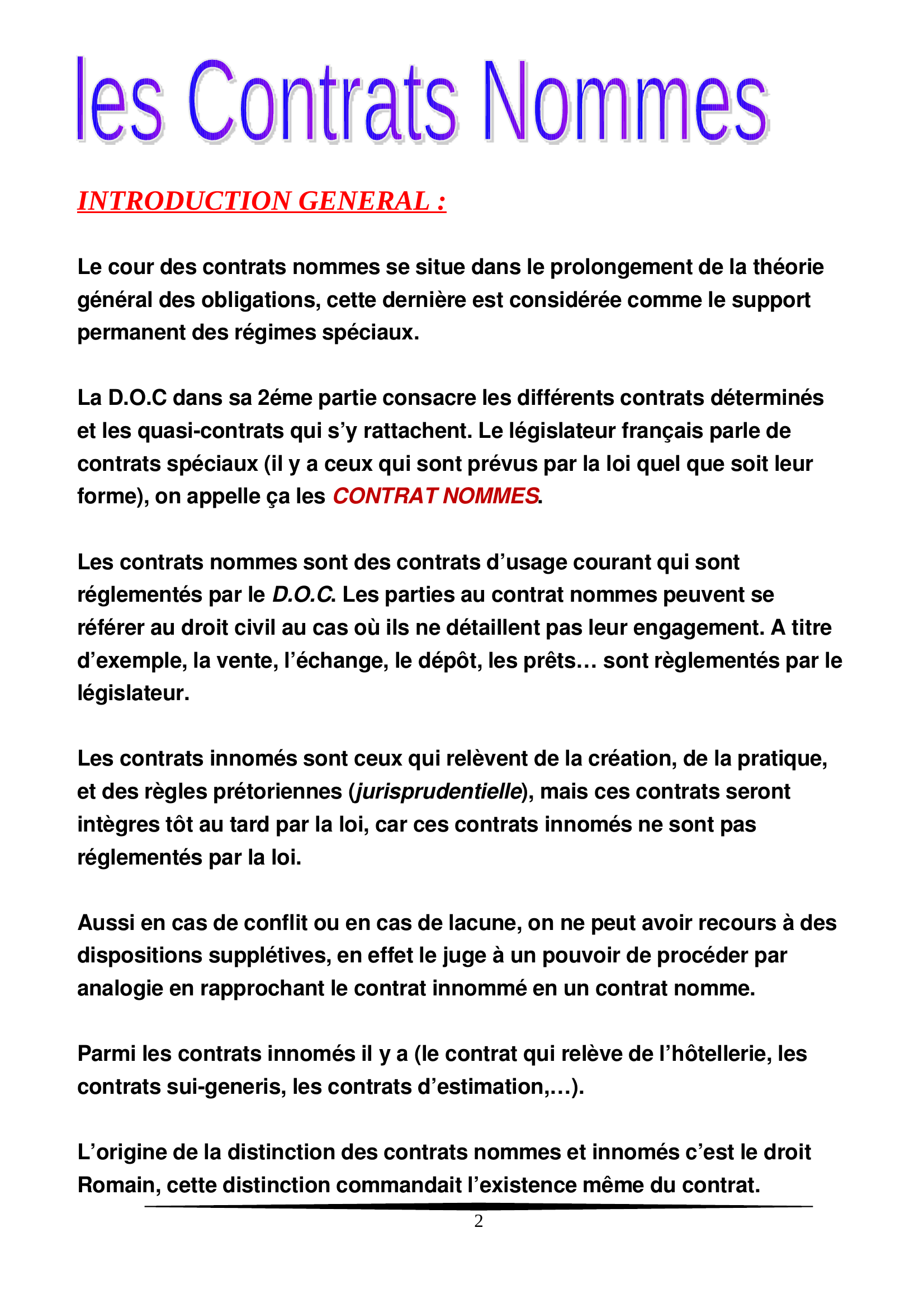INTRODUCTION GENERAL : Le cour des contrats nommes se situe dans le prolongement de la théorie général des obligations, cette dernière est considérée comme le support permanent des régimes spéciaux. La D.O.C dans sa 2éme partie consacre les différents contrats déterminés et les quasi-contrats qui s'y rattachent. Le législateur français parle de contrats spéciaux (il y a ceux qui sont prévus par la loi quel que soit leur forme), on appelle ça les CONTRAT NOMMES. Les contrats nommes sont des contrats d'usage courant qui sont réglementés par le D.O.C. Les parties au contrat nommes peuvent se référer au droit civil au cas où ils ne détaillent pas leur engagement. A titre d'exemple, la vente, l'échange, le dépôt, les prêts? sont règlementés par le législateur. Les contrats innomés sont ceux qui relèvent de la création, de la pratique, et des règles prétoriennes (jurisprudentielle), mais ces contrats seront intègres tôt au tard par la loi, car ces contrats innomés ne sont pas réglementés par la loi. Aussi en cas de conflit ou en cas de lacune, on ne peut avoir recours à des dispositions supplétives, en effet le juge à un pouvoir de procéder par analogie en rapprochant le contrat innommé en un contrat nomme. Parmi les contrats innomés il y a (le contrat qui relève de l'hôtellerie, les contrats sui-generis, les contrats d'estimation,?). L'origine de la distinction des contrats nommes et innomés c'est le droit Romain, cette distinction commandait l'existence même du contrat. Pour les contrats nommes, le Droit Romain ne raisonnait pas en terme de droit ou acte, il raisonnait à partir des actions en justice, et seules certaines situations précises et attribuées sont nécessaires pour agir en justice. Le titre permettait d'agir en justice, mais tout contrat ne constituait pas un titre protégé. Ce qui intéresse les Romains ce n'est pas l'existence d'un accord de volante, mais c'est beaucoup plus la situation précise d'un vendeur qui n'a pas obtenu le paiement de sa livraison, ou la situation d'un acheteur qui n'a pas obtenu la livraison de sa marchandise. En matière de contrat innommés, ce sont ceux qui n'ont pas d'action en justice, mais que des pratiques qui ne répondaient pas à la définition des contrats nommes. Le législateur français consacre la distinction entre les contrats nommes et les contrats innommés dans son article 1107 du code civil « que les contrats soit qu'ils aient une dénomination propre soit qu'ils n'en aient pas, ils sont soumis aux règles générales qui font l'objet du présent titre 2 » L'identification de chacun de ces contrats est difficile car certains contrats empreintes les règles de un ou plusieurs régimes juridiques. Le classement de ces contrats est impossible. Nous allons voir les contrats qui portent sur une CHOSE : -Le transfert de la propriété de la chose : *La Vente (article 478 du D.O.C) *L'échange (article 619 du D.O.C) -Le transfert de la jouissance de la chose : *le Bail *Le Prêt (article 829 du D.O.C) -les contrats aléatoires : *Les Jeux, le pari, la loterie. *la Rente viagère. *les Contrats portant sur des litiges. -LE TRANSFERT DE LA PRORIETE DE LA CHOSE : (LA VENTE) INTRODUCTION : Les contrats portant le transfert de propriété de la chose peut résulter des modalités juridiques très diverses. En fait on peut transférer à la suite d'une mort par effet de loi. *LA CHOSE : suppose à celui de personne, ce sont des biens (corporelle, incorporelle, mobilier, immobilier), tous susceptible de propriété. Le transfert qui nous intéresses, c'est le transfert par la vente de la chose, le D.O.C consacre plusieurs article de 478 à 620, il définit la vente comme un contrat « la vente est un contrat par laquelle le propriétaire d'une chose transfert la propriété a une autre personne s'appelle l'acheteur moyennant le paiement d'un prix » Article 478 du D.O.C. *Le transfert : peut faire la différence entre la vente et le prêt ainsi que le bail. Le D.O.C parle de la vente en général avec ses éléments constitutifs, et parle également de quelque espèces particulières de la vente {La Vente à Rémérer}, c'est une restitution de la chose contre remboursement. Les contrats de vente en l'état futur d'achèvement (V.E.F.A), introduite au Maroc par la loi de 2002, Dahir 1-02-309, c'est-à-dire acheté sur le plan. *L'ECHANGE : fait la différence entre la vente et l'échange, dans ce dernier il n'y a pas de prix, et prévu par les articles (619-625) du D.O.C. L'échange n'est pas la novation, qui est prévu par l'article 347 du D.O.C, c'est-à-dire il y a une extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle, c'est une substitution, elle ne se présume pas, il faut qu'elle soit précise dans le contrat. L'échange se n'est la dation de paiement, qui le fait de se libérer d'une dette par une prestation. La datation en paiement c'est le fait de se libéré d'une dette par une prestation, en France, cette technique permet de s'acquitter des obligations fiscales (les droits de mutation) par des objets de ha...