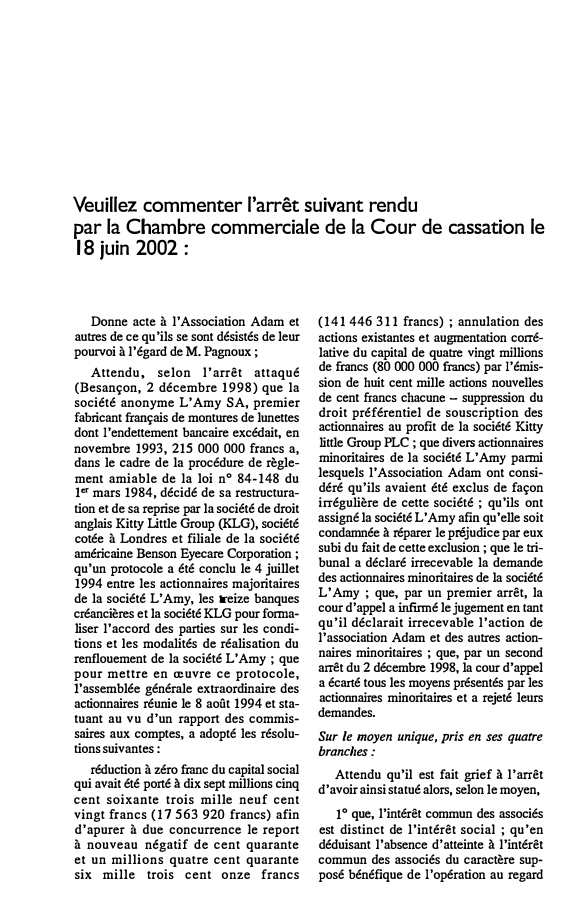Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002 : Donne...
Extrait du document
«
Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu
par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le
18 juin 2002 :
Donne acte à l'Association Adam et
autres de ce qu'ils se sont désistés de leur
pourvoi à l'égard de M.
Pagnoux;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Besançon, 2 décembre 1998) que la
société anonyme L'Amy SA, premier
fabricant français de montures de lunettes
dont 1'endettement bancaire excédait, en
novembre 1993, 215 000 000 francs a,
dans le cadre de la procédure de règle
ment amiable de la loi n ° 84-148 du
1°' mars 1984, décidé de sa restructura
tion et de sa reprise par la société de droit
anglais Kitty Little Group (KLG), société
cotée à Londres et filiale de la société
américaine Benson Eyecare Corporation;
qu'un protocole a été conclu le 4 juillet
1994 entre les actionnaires majoritaires
de la société L'Amy, les treize banques
créancières et la société KLG pour forma
liser l'accord des parties sur les condi
tions et les modalités de réalisation du
renflouement de la société L'Amy ; que
pour mettre en œuvre ce protocole,
1'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires réunie le 8 août 1994 et sta
tuant au vu d'un rapport des commis
saires aux comptes, a adopté les résolu
tions suivantes :
réduction à zéro franc du capital social
qui avait été porté à dix sept millions cinq
cent soixante trois mille neuf cent
vingt francs (17 563 920 francs) afin
d'apurer à due concurrence le report
à nouveau négatif de cent quarante
et un millions quatre cent quarante
six mille trois cent onze francs
(141 446 311 francs) ; annulation des
actions existantes et augmentation corré
lative du capital de quatre vingt millions
de francs (80 000 000 francs) par 1'émis
sion de huit cent mille actions nouvelles
de cent francs chacune - suppression du
droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de la société Kitty
little Group PLC ; que divers actionnaires
minoritaires de la société L'Amy parmi
lesquels l'Association Adam ont consi
déré qu'ils avaient été exclus de façon
irrégulière de cette société ; qu'ils ont
assigné la société L'Amy afin qu'elle soit
condamnée à réparer le préjudice par eux
subi du fait de cette exclusion; que le tri
bunal a déclaré irrecevable la demande
des actionnaires minoritaires de la société
L' Amy ; que, par un premier arrêt, la
cour d'appel a infirmé le jugement en tant
qu'il déclarait irrecevable l'action de
l'association Adam et des autres action
naires minoritaires ; que, par un second
arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel
a écarté tous les moyens présentés par les
actionnaires minoritaires et a rejeté leurs
demandes.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre
branches:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt
d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,
1° que, l'intérêt commun des associés
est distinct de l'intérêt social ; qu'en
déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt
commun des associés du caractère sup
posé bénéfique de I• opération au regard
Corrigé
La société L'Amy SA, cotée au second marché de la Bourse de Lyon, a
connu des difficultés financières qui ont rendu nécessaire l'ouverture d'une
procédure de règlement amiable.
Un protocole a été conclu entre la société,
les banques créancières et une société tiers.
Pour faire face à ces difficultés, l'assemblée générale extraordinaire a
décidé la réduction à zéro franc du capital social afin d'apurer le report à
nouveau négatif, et l'annulation des actions existantes.
Elle a décidé une aug
mentation corrélative du capital de 80 000 000 francs par l'émission de huit
cent mille actions nouvelles de cent francs chacune, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'un tiers.
Le
nouvel actionnaire a ainsi pris le contrôle de la société.
Des actionnaires minoritaires se sont déclarés insatisfaits de l'opération.
Ils ont demandé en justice la réparation du préjudice subi en raison de leur
exclusion de la société.
Ils ont été déclarés irrecevables en leur demande en
première instance.
La Cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, mais a
débouté les actionnaires minoritaires de leur demande.
Ils se sont alors
pourvus en cassation.
Dans leur pourvoi, ils contestaient l'arrêt de la Cour
d'appel sur trois points.
Ils soutenaient principalement :
- d'une part, qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des
associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt
social, la Cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil alors que l'intérêt
commun est distinct de l'intérêt social ;
- d'autre part, que la réduction du capital à zéro suivie d'une augmenta
tion de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réali
sait une expropriation illégale contraire à l'article 545 du Code civil.
Par son arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des
actionnaires minoritaires.
Elle précise ainsi par sa décision le régime de l'opé
ration mise en place par la société afin de réaliser sa restructuration.
Cette
opération est connue dans la pratique sous le nom de coup d'accordéon.
La précision apportée par la Cour de cassation répond plus précisément à
la question de savoir si les actionnaires minoritaires d'une société peuvent
demander réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite d'une
réduction du capital à zéro, suivie d'une augmentation de capital avec sup
pression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne
déterminée, tiers à la société.
Autrement dit, la réalisation d'un coup
d'accordéon peut-elle aboutir à l'exclusion des actionnaires minoritaires ?
La Cour de cassation écarte, en l'espèce, toute possibilité d'indemnisation
des actionnaires minoritaires au motif que l'opération litigieuse avait été
décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les
fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans
nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d'une façon ou d'une
autre auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subis
sant le même sort que les actionnaires minoritaires.
Cette opération ne réa
lisait donc pas, en outre, une expropriation illégale, dans la mesure où elle
Code civil pour soutenir que la société existe dans l'intérêt commun des
associés, intérêt qui ne se confond pas avec l'intérêt social qui est l'intérêt
de la personne morale.
Cette conception conduit à donner une place cen
trale à l'égalité des actionnaires, notamment en faveur des minoritaires qui
peuvent ainsi prétendre aux mêmes avantages que ceux qui profitent aux
majoritaires.
Or, en l'espèce, les majoritaires se sont trouvés exclus de la société
comme les minoritaires.
Il n'y avait donc aucune rupture d'égalité.
Ce
constat paraît essentiel dans la motivation de la Cour de cassation, car la
même formule revient à deux reprises : « l'opération litigieuse...
(n'avait pas
nui) à l'intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires...
les actionnaires
majoritaires subissant par ailleurs le même sort ».
Cette prétention était
donc manifestement vouée à l'échec.
Il restait alors aux actionnaires à soute
nir que leur exclusion de la société réalisait une atteinte à leur droit de pro
priété.
B.
Le respect de la propriété des actionnaires
La suppression du droit préférentiel de souscription.
L'apport
essentiel de l'arrêt du 18 juin 2002 au régime du coup d'accordéon tient au
fait qu'en l'espèce, l'assemblée générale avait supprimé le droit préférentiel
de souscription qui appartient en principe à tout actionnaire lors d'une aug
mentation de capital.
Pour la Cour de cassation, la licéité de l'opération n'est
pas subordonnée au maintien du droit préférentiel de souscription.
Cette
solution n'allait cependant pas de soi.
Lorsqu'elle a affirmé la validité du coup d'accordéon, la Cour de cassation
a pris soin de relever le maintien du droit préférentiel de souscription2• Les
arrêts postérieurs, aussi bien des juges du fond que de la Cour de cassation,
avaient procédé de la même façon3• Aussi, la doctrine majoritaire avait-elle
estimé conforme à la jurisprudence de faire du maintien du droit préférentiel
une condition de validité de l'opération4• C'est, en effet, à cette seule condi
tion que les associés peuvent se maintenir dans la société.
Cependant, cette solution n'était pas imposée par les textes.
En effet,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓