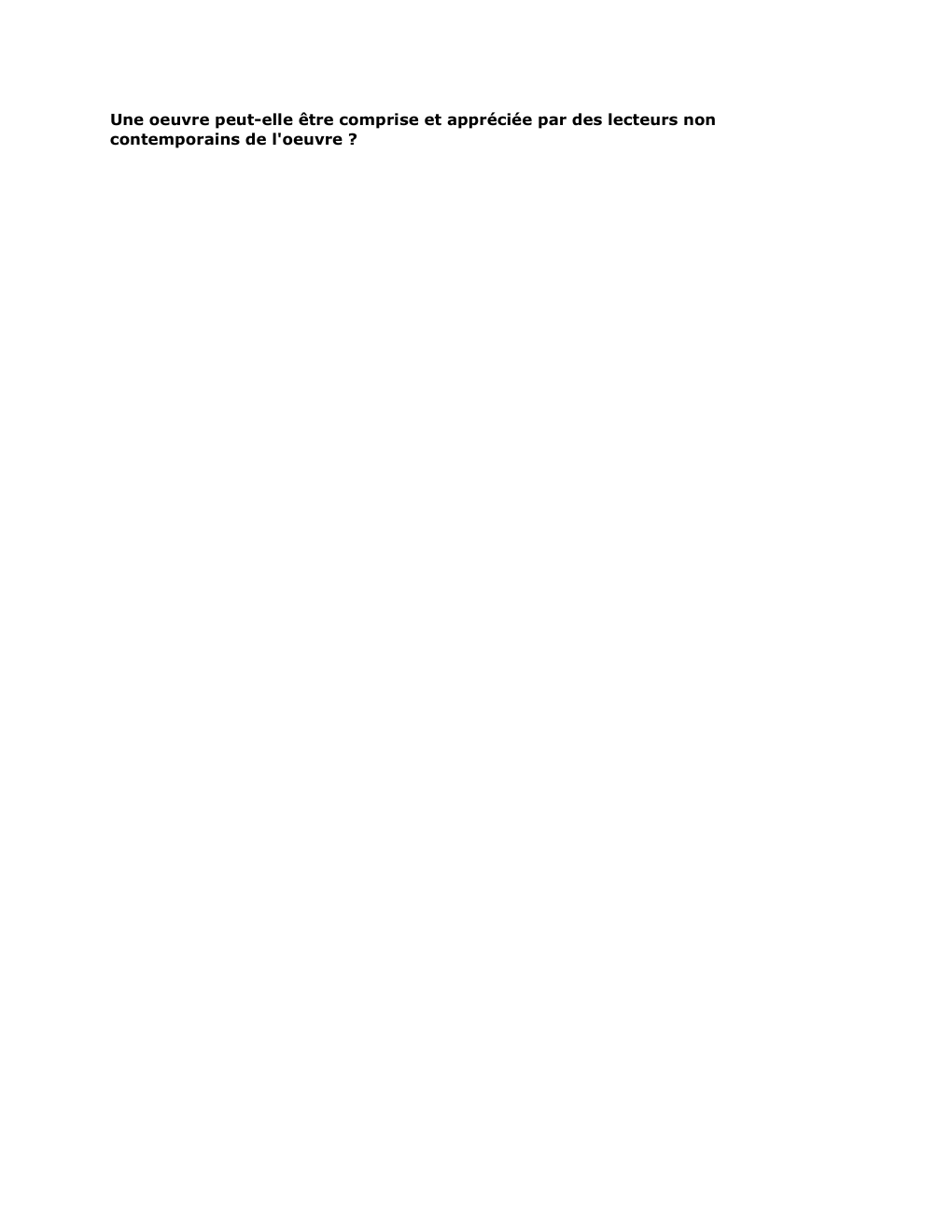Une oeuvre peut-elle être comprise et appréciée par des lecteurs non contemporains de l'oeuvre ? Une oeuvre peut-elle être comprise...
Extrait du document
«
Une oeuvre peut-elle être comprise et appréciée par des lecteurs non
contemporains de l'oeuvre ?
Une oeuvre peut-elle être comprise et appréciée par des lecteurs non
contemporains de l'œuvre ?
« Il ne faut pas qu'un écrivain s'intéresse trop à son époque sous peine de faire des oeuvres
qui n'intéressent que son époque...
» Chateaubriand.
=> Un chef d’œuvre littéraire est-il intemporel ?
I- Des chefs d’œuvres littéraires qui s’usent :
« Le temps use les œuvres littéraires, les chefs d’œuvres même, quoi qu’on en dise ».
Montherlant.
A- Une différence de langue
• Les œuvres du Moyen Age sont en ancien français => incompréhensibles sans de solides
connaissances en ancien français (qui s’apprend à la faculté de lettres).
• Les œuvres du XVIe siècle / de la Renaissance (Montaigne, Rabelais) sont en français
classique : difficilement compréhensibles.
On les lit dans des éditions +/- traduites mais
même là, des mots nous échappent… Cf.
Gargantua, Les Essais…
• Certains mots ou tournures du XVIIe siècle restent obscures.
Cf.
Racine, Corneille…
B- Une différence de mœurs
• Œuvres trop inscrites dans une époque : vieillissent mal ou le lecteur des époques
suivantes se sent étranger à leurs histoires, leurs intrigues.
• Ex : au Moyen Age et même encore à l’époque classique, les gens riaient beaucoup
devant les farces (à tendance scatologique + histoires de cocuage, de mari ivrogne…) –
cela ne nous ferait plus vraiment rire aujourd’hui.
• Ex : la Princesse de Clèves => texte très éloigné du quotidien des lecteurs du XXIe siècle.
Cf.
la cour qui ne fait que parler amour et jouer (vs « métro boulot dodo ! »).
Le lecteur
d’aujourd’hui peut ne pas vraiment comprendre ce que peut avoir d’étonnant et même de
choquant l’attitude de Mme de Clèves – alors qu’en plus, elle refuse de vivre son amour
avec M.
de Nemours…
• Dilemmes qui, a priori, ne se posent plus à notre époque/dans notre culture.
Cf.
Corneille,
Le Cid : Rodrigue doit choisir entre l’honneur de la famille et l’amour : il doit tuer le père
de Chimène (venger le sien qui a reçu…un soufflet…).
=> Les préoccupations des personnages nous semblent bien étrangères…
C- Une différence d’esthétique
• Les conceptions de la littérature évoluent constamment.
Cf.
avant, le roman était le petit
genre méprisé (Balzac n’a jamais eu le droit d’entrer à l’Académie française) / avant,
l’épopée était très appréciée… VS aujourd’hui : le roman est roi.
On lit / publie beaucoup
moins de poésie.
• Ex – le théâtre.
Règles rigides de la bienséance et de la vraisemblance.
Déjà certains
classiques ont critiqué ces règles.
Cf.
Corneille qui les remettait en question.
Pour lui, l’unité
d’action limitait l’intrigue et surtout, l’unité de temps lui semblait peu crédible.
Ex : en une
journée, Rodrigue se bat deux fois en duel, mène une armée contre les Maures, s’entretient
avec son père, sa fiancée et le roi !
• Volonté des dramaturges de s’affranchir des règles traditionnelles, jugées trop
contraignantes.
Cf.
le drame romantique, la préface de Cromwell et la Bataille d’Hernani.
Cf.
Vigny (Journal d'un Poète) : « Le genre bâtard, c'était la tragédie faux antique de Racine
»
=> Déjà au XIXe siècle, les pièces du XVIIe siècle semblent avoir vieilli.
∆) Les chefs d’œuvres, en effet, vieillissent, ne sont pas appréciés de la même manière…
Mais, toutefois, ces écarts créés par le temps, les changements de mœurs sont-ils vraiment
importants ?
II- Des œuvres tout de même lisibles (et appréciées)
A- Un cadre rigide mais favorable à l’œuvre
Ces règles dramaturgiques classiques certes contraignantes ont pourtant permis à des
auteurs de mettre en scène de véritables chefs d’œuvres joués des siècles après.
Ex : Racine a su utiliser de manière intelligente ces règles.
• Aimait écrire des pièces à partir de presque rien et se focaliser sur la crise => unité
d’action.
Crise => cela peut donc se dérouler en quelques heures, pas de problème de
temps.
Pièce centrée sur la crise, pas besoin d’espaces => esthétique de la concentration
extrême, lieu tragique.
=> La règle des trois unités a fourni à Racine un cadre idéal pour sa vision de la tragédie
=> l’essence du tragique est dans le personnage, pas dans les péripéties extérieures ;
NB : Avec le mélange d’actions, la complexité des personnages prônés par Hugo pour le
drame romantique… on s’y perd ! Dans Hernani, parfois, le lecteur voudrait seulement
suivre l’histoire d’amour entre Dona Sol et Hernani et oublier l’intrigue politique très
compliquée.
NB : peu d’œuvres romantiques sont encore représentées et ont peu vieilli =>
au XXIe siècle, on représente bien plus fréquemment les pièces de Racine et de Corneille
que Les Burgraves d’Hugo ou Fantasio de Musset !
B- Des conceptions qui finalement peuvent encore correspondrent à notre
mentalité
• Le rire.
Les mécanismes du comique ne changent pas.
Ex : les Fourberies de Scapin :
quiproquo, coups de bâtons, grands gestes ; scène d'Orgon sous la table (Tartuffe V; 5).
• Le pathétique.
Les tourments d'adolescents du passé ne sont pas étrangers aux jeunes
lecteurs d'aujourd'hui (mythe de Rimbaud, le poète éternellement jeune et rebelle).
La
rébellion contre le père, contre l’autorité touche encore le public/ le lectorat même si les
situations ne sont pas les mêmes.
C- L’universalité des sentiments, des sensations
• On a souvent reproché aux tragédies classiques leurs règles, la bienséance… Mais
universalité du message, des sentiments.
Idées, sentiments intemporels : l’amour, la
jalousie… Ex : Phèdre => Jalousie, passion déchirante.
Évoquer acte IV, scène 6 : ce
sentiment extrême de la jalousie (« craintes », «transports », « fureurs », « feux », «
remords ») lui donnes des idées de meurtres.
Sentiment humain même s’il est
exacerbé (d’ailleurs, Racine écrivait aussi pour nous « purger....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓