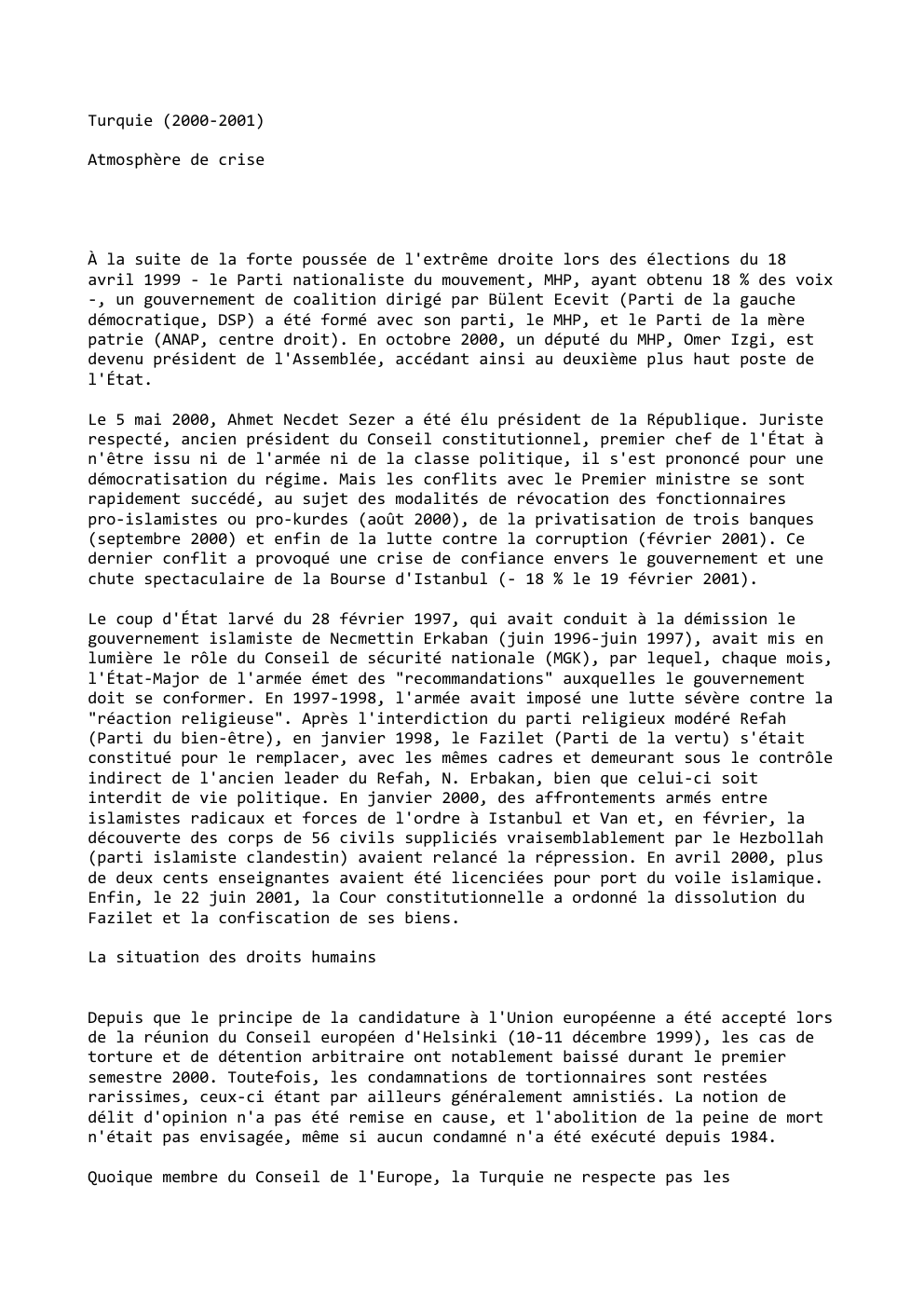Turquie (2000-2001) Atmosphère de crise À la suite de la forte poussée de l'extrême droite lors des élections du 18...
Extrait du document
«
Turquie (2000-2001)
Atmosphère de crise
À la suite de la forte poussée de l'extrême droite lors des élections du 18
avril 1999 - le Parti nationaliste du mouvement, MHP, ayant obtenu 18 % des voix
-, un gouvernement de coalition dirigé par Bülent Ecevit (Parti de la gauche
démocratique, DSP) a été formé avec son parti, le MHP, et le Parti de la mère
patrie (ANAP, centre droit).
En octobre 2000, un député du MHP, Omer Izgi, est
devenu président de l'Assemblée, accédant ainsi au deuxième plus haut poste de
l'État.
Le 5 mai 2000, Ahmet Necdet Sezer a été élu président de la République.
Juriste
respecté, ancien président du Conseil constitutionnel, premier chef de l'État à
n'être issu ni de l'armée ni de la classe politique, il s'est prononcé pour une
démocratisation du régime.
Mais les conflits avec le Premier ministre se sont
rapidement succédé, au sujet des modalités de révocation des fonctionnaires
pro-islamistes ou pro-kurdes (août 2000), de la privatisation de trois banques
(septembre 2000) et enfin de la lutte contre la corruption (février 2001).
Ce
dernier conflit a provoqué une crise de confiance envers le gouvernement et une
chute spectaculaire de la Bourse d'Istanbul (- 18 % le 19 février 2001).
Le coup d'État larvé du 28 février 1997, qui avait conduit à la démission le
gouvernement islamiste de Necmettin Erkaban (juin 1996-juin 1997), avait mis en
lumière le rôle du Conseil de sécurité nationale (MGK), par lequel, chaque mois,
l'État-Major de l'armée émet des "recommandations" auxquelles le gouvernement
doit se conformer.
En 1997-1998, l'armée avait imposé une lutte sévère contre la
"réaction religieuse".
Après l'interdiction du parti religieux modéré Refah
(Parti du bien-être), en janvier 1998, le Fazilet (Parti de la vertu) s'était
constitué pour le remplacer, avec les mêmes cadres et demeurant sous le contrôle
indirect de l'ancien leader du Refah, N.
Erbakan, bien que celui-ci soit
interdit de vie politique.
En janvier 2000, des affrontements armés entre
islamistes radicaux et forces de l'ordre à Istanbul et Van et, en février, la
découverte des corps de 56 civils suppliciés vraisemblablement par le Hezbollah
(parti islamiste clandestin) avaient relancé la répression.
En avril 2000, plus
de deux cents enseignantes avaient été licenciées pour port du voile islamique.
Enfin, le 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution du
Fazilet et la confiscation de ses biens.
La situation des droits humains
Depuis que le principe de la candidature à l'Union européenne a été accepté lors
de la réunion du Conseil européen d'Helsinki (10-11 décembre 1999), les cas de
torture et de détention arbitraire ont notablement baissé durant le premier
semestre 2000.
Toutefois, les condamnations de tortionnaires sont restées
rarissimes, ceux-ci étant par ailleurs généralement amnistiés.
La notion de
délit d'opinion n'a pas été remise en cause, et l'abolition de la peine de mort
n'était pas envisagée, même si aucun condamné n'a été exécuté depuis 1984.
Quoique membre du Conseil de l'Europe, la Turquie ne respecte pas les
engagements souscrits concernant la liberté de la presse : de janvier à juillet
2000, les médias ont été condamnés à plus de 3 200 jours d'interdiction
d'émettre.
En 2000, les prisons turques comptaient 70 000 détenus dont 10 000
pour "terrorisme".
Après les révoltes de 1996 et 1999, le gouvernement avait
décidé le transfert des prisonniers politiques dans des cellules, au lieu des
dortoirs favorisant les actions collectives.
Après l'échec des négociations
entre les prisonniers et le pouvoir, la police est intervenue violemment le 19
décembre 2000, provoquant 32 décès.
La grève de la faim s'est étendue parmi les
prisonniers et leurs proches ; à la mi-juin 2001, 24 d'entre eux avaient
succombé.
Les améliorations proposées le mois précédent par le pouvoir
(possibilité pour les prisonniers de participer en groupe à certaines activités,
possibilité de porter plainte en cas de torture) ont été jugées insuffisantes.
La répression a continué de s'exercer sur les partis prokurdes.
Après
l'arrestation en février 1999 d'Abdullah Öcalan, leader du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), sa condamnation à mort en juin 1999, et la
décision du PKK de déposer les....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓