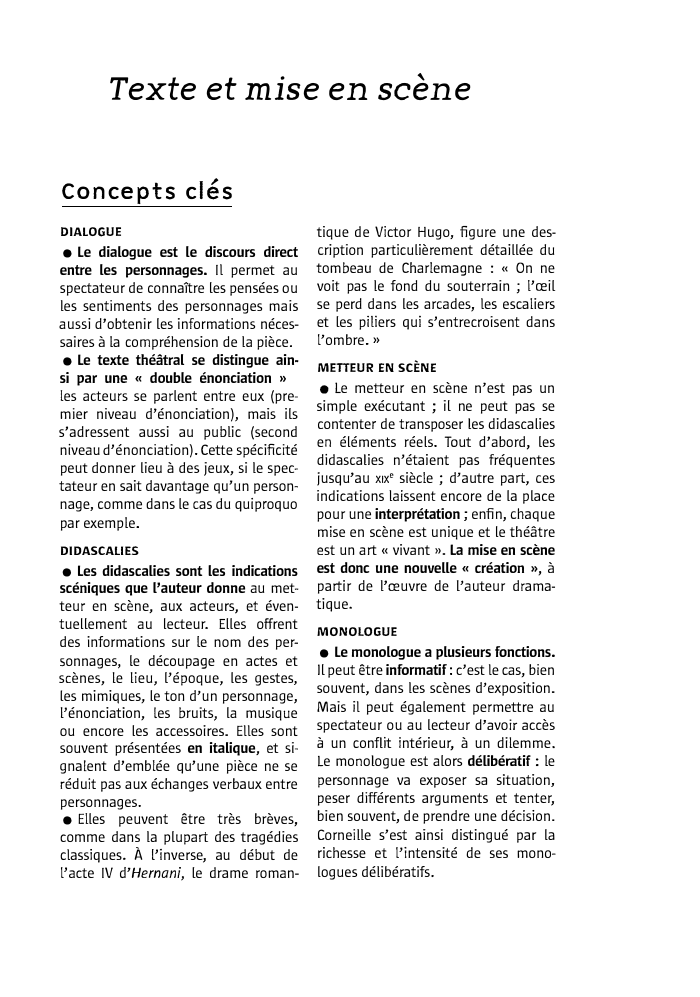Texte et mise en scène Concepts clés DIALOGUE • Le dialogue est le discours direct entre les personnages. Il permet...
Extrait du document
«
Texte et mise en scène
Concepts clés
DIALOGUE
• Le dialogue est le discours direct
entre les personnages.
Il permet au
spectateur de connaître les pensées ou
les sentiments des personnages mais
aussi d'obtenir les informations néces
saires à la compréhension de la pièce.
• Le texte théâtral se distingue ain
si par une « double énonciation »
les acteurs se parlent entre eux (pre
mier niveau d'énonciation), mais ils
s'adressent aussi au public (second
niveau d'énonciation).
Cette spécificité
peut donner lieu à des jeux, si le spec
tateur en sait davantage qu'un person
nage, comme dans le cas du quiproquo
par exemple.
DIDASCALIES
• Les didascalies sont les indications
scéniques que l'auteur donne au met
teur en scène, aux acteurs, et éven
tuellement au lecteur.
Elles offrent
des informations sur le nom des per
sonnages, le découpage en actes et
scènes, le lieu, l'époque, les gestes,
les mimiques, le ton d'un personnage,
l'énonciation, les bruits, la musique
ou encore les accessoires.
Elles sont
souvent présentées en italique, et si
gnalent d'emblée qu'une pièce ne se
réduit pas aux échanges verbaux entre
personnages.
• Elles peuvent être très brèves,
comme dans la plupart des tragédies
classiques.
À l'inverse, au début de
l'acte IV d'Hernani, le drame roman-
tique de Victor Hugo, figure une des
cription particulièrement détaillée du
tombeau de Charlemagne : « On ne
voit pas le fond du souterrain ; l'œil
se perd dans les arcades, les escaliers
et les piliers qui s'entrecroisent dans
l'ombre.
»
METTEUR EN SCÈNE
• Le metteur en scène n'est pas un
simple exécutant ; il ne peut pas se
contenter de transposer les didascalies
en éléments réels.
Tout d'abord, les
didascalies n'étaient pas fréquentes
jusqu'au x1xe siècle ; d'autre part, ces
indications laissent encore de la place
pour une interprétation; enfin, chaque
mise en scène est unique et le théâtre
est un art « vivant ».
La mise en scène
est donc une nouvelle « création », à
partir de l'œuvre de l'auteur drama
tique.
MONOLOGUE
• Le monologue a plusieurs fonctions.
Il peut être informatif: c'est le cas, bien
souvent, dans les scènes d'exposition.
Mais il peut également permettre au
spectateur ou au lecteur d'avoir accès
à un conflit intérieur, à un dilemme.
Le monologue est alors délibératif: le
personnage va exposer sa situation,
peser différents arguments et tenter,
bien souvent, de prendre une décision.
Corneille s'est ainsi distingué par la
richesse et l'intensité de ses mono
logues délibératifs.
'
Reperes
ANTIQUITÉ ET MOYEN ÂGE :
LES ORIGINES
• Le terme « théâtre » vient du grec
theatron et signifie « le lieu où l'on
regarde ».
Le théâtre est ainsi, avant
tout, un espace de spectacle.
Né dans
!'Antiquité grecque, il est devenu un
genre littéraire (le texte des pièces) qui
s'est épanoui de manière diversifiée
selon les époques.
• À son origine, le théâtre est lié au
sacré (culte de Dionysos à Athènes, de
Bacchus à Rome), caractère que l'on
retrouve dans les mystères,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓