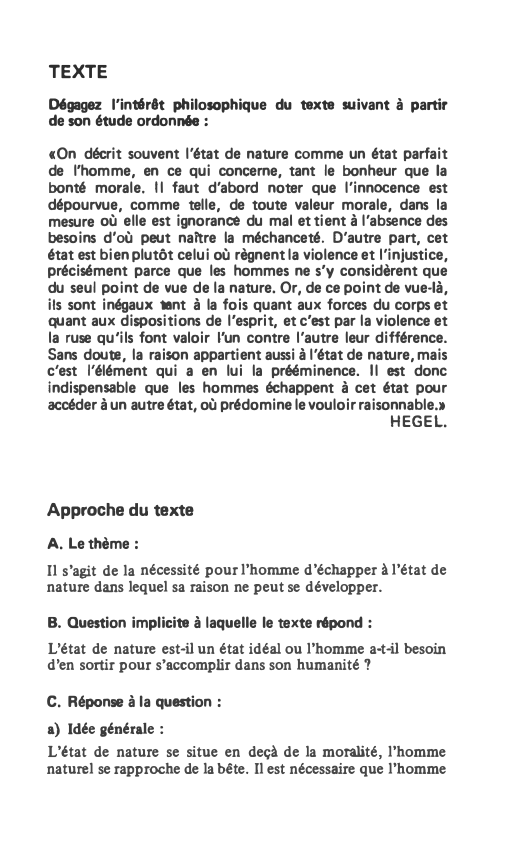TEXTE Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée : «On décrit souvent l'état de nature...
Extrait du document
«
TEXTE
Dégagez l'intérêt philosophique du texte suivant à partir
de son étude ordonnée :
«On décrit souvent l'état de nature comme un état parfait
de l'homme, en ce qui concerne, tant le bonheur que la
bonté morale.
Il faut d'abord noter que l'innocence est
dépourvue, comme telle, de toute valeur morale, dans la
mesure où elle est ignoranCé du mal et tient à l'absence des
besoins d'où peut nal'tre la méchanceté.
D'autre part, cet
état est bien plutôt celui où règnent la violence et l'injustice,
précisément parce que les hommes ne s'y considèrent que
du seul point de vue de la nature.
Or, de ce point de vue-là,
ils sont inégaux tant à la fois quant aux forces du corps et
quant aux dispositions de l'esprit, et c'est par la violence et
la ruse qu'ils font valoir l'un contre l'autre leur différence.
Sans doute, la raison appartient aussi à l'état de nature, mais
c'est l'élément qui a en lui la prééminence.
Il est donc
indispensable que les hommes échappent à cet état pour
accéder à un autre état, où prédomine le vouloir raisonnable.»
HEGEL.
Approche du
texte
A.
Le thème:
Il s'agit de la nécessité pour l'homme d'échapper à l'état de
nature dans lequel sa raison ne peut se développer.
B.
Question implicite à laquelle le texte répond :
L'état de nature est-il un état idéal ou l'homme a-t-il besoin
d'en sortir pour s'accomplir dans son humanité?
C .
Réponse à la question :
a) Idée générale :
L'état de nature se situe en deçà de la moralité, l'homme
naturel se rapproche de la bête.
Il est nécessaire que l'homme
sorte de cet état pour accéder à l'état social «-où P.rédomine
le vouloir raisonnable», c'est la condition du dépassement
de l'être humain et de l'accomplissem�nt de son humanité.
b) Structure logique du texte:
«-On décrit souvent•••_ méchanceté» : L'idée courante d'état
de nature.
(D'autre part•.• différence» : L'état de nature comme état
de violence et d'injustice.
«-Sans doute ...
vouloir raisonnable» : Nécessité pour l'homme
d'accéder à un état où prédomine le vouloir raisonnable.
Analyse du texte
A.
Explication commentée :
a) .1, «-L'état de nature» :Il ne s'agit pas d'un état historique
mais idéologique.
C'est un état que l'on découvre par
l'analyse, par la réflexion, autrement dit, c'est une hypo
thèse destinée à nous faire comprendre l'homme actuel,
l'homme social.
l>our Rousseau par exemple, il' est impos
sible de se faire une idée exacte de l'homme et de la société
si l'on ne distingue au-dessous des êtres sociaux que nous
sommes tous, l'homme naturel, l'homme tel que l'a formé
la nature, dépouillé de tous les dons culturels et de tous les
artifices qu'il n'a pu acquérir que par de lents progrès.
Cependant, personne n'est arrivé à remonter à cet homme
naturel, il se peut qu'il
n'ait, sans doute, jamais existé,
f
mais peu importe, f n'en est pas moins concevable et ce
concept d'homme naturel ou d'homme vivant à l'état de
nature est indispensable à toute spéculation sur l'homme.
2.
Cet «-état de nature est souvent décrit comme un état
parfait de l'homme en ce qui concerne tant le bonheur
que la bonté morale».
En ce sens, l'homme naturel vivrait
dans une sorte d'état paradisiaque, heureux car ses désirs
ne dépasseraient pas ses besoins physiques, sans ambition,
n'ayant le souci que de sa conservation.
De plus, ne connais
sant ni l'envie ni la jalousie, il vivrait dans un état de «bonté
morale», l'homme, disait Rousseau, est naturellement bon.
Mais plutôt que de la bonté, nous constatons en lui une
totale ignorance du bien et du mal, c'est en fait l'«-innocence»
de la vie prémorale.
«-L'innocence» ne peut être qualifiée
�
moralement.
L'homme à l'état de nature, ne cherchant
qu'à satisfaire ses besoins purement naturels, biologiques,
ignore les vains désirs d'où peut naître la �méchanceté»,
c'est dire qu'il ignore les besoins superflus qui engendrent
la concupiscence, la jalousie, etc.
b) l.
«Cet état est bien plutôt celui où règne la violence et
l'injustice, affirme Hegel Selon l'auteur, loin de vivre en
paix à l'état de nature, l'homme vivrait plutôt à l'état de
guerre où le droit de chacun est mesuré par sa puissance
réelle, où la loi du plus fort règne ; tous les moyens alors
sont bons pour obtenir ce que l'on désire, «la violence» et
«la ruse», le détour hypocrite sont de mise pour atteindre
la fin convoitée.
Hobbes lui-même considérait qu'à l'état
de nature, d'homme est un loup pour l'homme>.
Aucune
raison ne peut alors venir tempérer le jaillissement des
instincts car les hommes se comportent du seul point de
vue de la nature, la nature animale prédomine, le droit se
ramenant alors à la force, c'est le règne de d'injustice».
Aucune des inégalités naturelles physiques, «forces du
corps», ou intellectuelles, 4tdlspositions de l'esprit» ne
peuvent-être compensées par l'établissement d'un droit
rationnel.
2.
Pourtant «la raison appartient aussi à l'état de nature» :
l'homme naturel possède la raison, mais une raison en
quelque sorte endormie, qu'il ne sait ni exercer ni déve
lopper, en ce sens Hegel rejoindrait Rousseau, «l'élément»
naturel, animal, domine et....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓