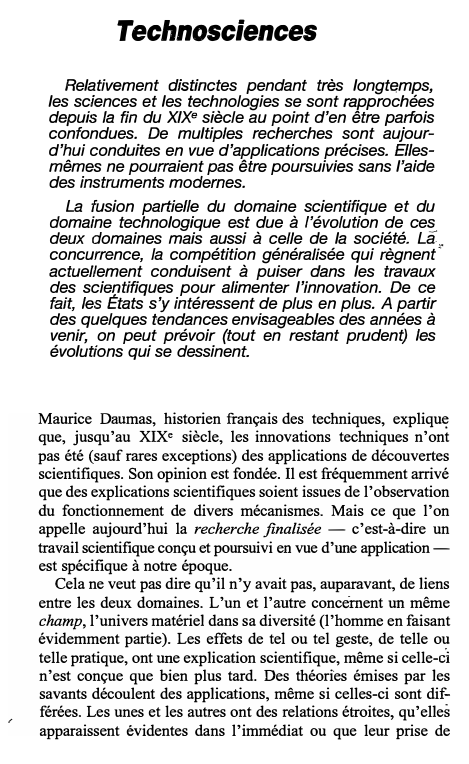Technosciences Relativement distinctes pendant très longtemps, les sciences et les technologies se sont rapprochées depuis la fin du X/Xe siècle...
Extrait du document
«
Technosciences
Relativement distinctes pendant très longtemps,
les sciences et les technologies se sont rapprochées
depuis la fin du X/Xe siècle au point d'en être parfois
confondues.
De multiples recherches sont aujour
d'hui conduites en vue d'applications précises.
Elles
mêmes ne pourraient pas être poursuivies sans l'aide
des instruments modernes.
La fusion partielle du domaine scientifique et du
domaine technologique est due à l'évolution de ce�
deux domaines mais aussi à celle de la société.
La"
concurrence, la compétition généralisée qui règnent
actuellement conduisent à puiser dans les travaux
des scief)tifiques pour alimenter l'innovation.
De ce
fait, /es Etats s'y intéressent de plus en plus.
A partir
des quelques tendances envisageables des années à
venir, on peut prévoir (tout en restant prudent) les
évolutîons qui se dessinent.
Maurice Daumas, historien français des techniques, expliqut?
que, jusqu'au XIX0 siècle, les innovations techniques n'ont
pas été (sauf rares exceptions) des applications de découvertes
scientifiques.
Son opinion est fondée.
Il est fréquemment arrivé
que des explications scientifiques soient issues de l'observation
du fonctionnement de divers mécanismes.
Mais ce que l'on
appelle aujourd'hui la recherche finalisée - c'est-à-dire un
travail scientifique conçu et poursuivi en vue d'une application est spécifique à notre époque.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, auparavant, de liens
entre les deux domaines.
L'un et l'autre concernent un même
champ, l'univers matériel dans sa diversité (l'homme en faisant
évidemment partie).
Les effets de tel ou tel geste, de telle ou
-telle pratique, ont une explication
scientifique, même si celle-ci
n'est conçue que bien plus tard.
Des théories émises par les
savants découlent des applications, même si celles-ci sont dif
férées.
Les unes et les autres ont des relations étroites, qu'elles
apparaissent évidentes dans l'immédiat ou que leur prise de
consèience soit décalée dans le temps.
De plus, elles-s'exercent
dans le cadre d'une société précise et en interaction étroite avec
les structures de celle-ci.
La nouveauté, au :xxe siècle, est l'accentuation de ces relations, tant et si bien qu.' on ne distingue pas toujours très bien les
différents aspects du 'savoir et du savoir-faire humains.
Cette
fusion partielle explique le terme technoscience que l'on utilise fréquemment pour caractériser les sciences et les techniques de notre époque.
La coupure ancienne ~mtre travail manuel
et travail intellectuel
Il n'y a guère de séparations très nettes entre les fonctions
des individus, au sein du groupe humain, pendant les très
longues périodes du paléolithique et du mésolithique.
Des distinctions apparaissent au néolithique.
L'agriculture naît, de
'même que des artisanats relativement spécialisés (fabrication
d'outils et d'armes de pierre, céramique, tissage...
).
Le savoir
spéculatif de l'époque (ce que l'ethnologue Claude LéviStrauss appelait la pensée sauvage) devait être surtout le fait
des sorciers et des prêtres.
La coupure s'accentue dans le cadre
des premières grandes civilisations antiques.
Elle est toutefois
relative.
Les savoirs sont le plus souvent empiriques, constitués principalement par des recettes, non par des théories.
Les
calculs concernent des factures, des partages d'héritage, des
Les âges de la préhistoire
• Le paléolithique (ou âge de la pierre taillée) est la période
qui débute à l'apparition des premiers hominidés et qui se
termine vers 12 000 av~J.-C.
• Le mésolithique, période intermédiaire, va de 12 000 av.
J.-C.
à 8 000 ou 6 000 av.
J.-C.
• Le néolithique (ou âge de la pierre· polie) s'écoule de
8 000 à 6 000 av.
J.-C.
jusqu'au début de la période historique à proprement parler (cours du 4° millénaire, vers 3 200
av.
J.-C.).
évaluations d'impôts ...
Les gouvememênts s'intéressent à la
formation de leurs fonctionnaires (les scribes), de leurs médecins, de leurs architectes, ainsi qu'à la technique en général (et
notamment à la technique militaire), non à la science qui
n'existe pas vraiment en tant que telle.
L'empirisme
Une démarche empirique s'appuie surtout sur les observa-,.
tions courantes, sur des pratiques non théorisées, en •
n'ayant pas recours à la réflexion et au raisonnement scien-,
tifiques.
Une étude peut toutefois être empirique dans un
premier temps, puis donner lieu à une construction scientifique.
Il en a été ainsi, par exemple, de la chimie pendant des
siècles.
Elle n'est devenue une science qu'à partir de Lavoisier, Cavendish, etc., à la fin du XVlll8 siècle.
,
A partir de la civilisation grecque dite classique (V• siècle av.
J.-C.), la science se constitue en tant que partie de la,philosophie.
Celle-ci est l'apanage des catégories sociales les plus
aisées et se veut «désintéressée».
Les artisans (les hommes de
l'art, dira-t-onjusqu'au XIX• siècle) sont, quelle que soit leur
qualité, d'un rang social inférieur.
Les «pratiques sociales de
référence», auxquelles se rattachent les connaissances scientifiques, sont souvent éloignées dans le temps et leurs rapports ne
se découvrent pas immédiatement.
Les hommes utilisaient par
exemple le levier depuis la lointaine préhistoire ; sa théorie est
établie par Archimède au III• siècle av.
J.-C.
Avec des hauts et des bas, avec quelques épisodes en apparence paradoxaux (aucune progression historique n'est parfaitement linéaire), la séparation s'est maintenue en moyenne
inchangée jusqu'au XVI• siècle.
Nous voulons dire par là que
la réflexion $Cientifique (plus dégagée, à vrai dire, de la philosophie qu'elle ne l'était dans l' Antiquité) n'était pas considérée
comme un gisement d'applications techniques.
La montée de la bourgeoisie et la recherche
de l'innovation technique
Depuis que les sociétés se sont structurées (politiquement,
administrativement, etc.) jusqu'aux temps modernes, la catégorie sociale dominante a eu, pour l'essentiel, intérêt à maintenir l'ordre des choses en l'état.
La remarque vaut pour les
patriciens grecs et romains de l' Antiquité comme pour la
noblesse du Moyen Age : chaque corps matériel a sa place dans
l'univers, comme chaque homme (et chaque catégorie sociale)
a sa place dans la société.
Cette volonté est bien affirmée dans
la Politique d'Aristote.
Elle est sacralisée par l'Église dans
l'Europe médiévale.
L'ordonrtancement de l'univers, les rapports entre les hommes, reflètent 1'ordre de Dieu.
La royauté de
France, par exemple, se dit de droit divin.
Pour ne rien modifier, les dirigeants évitent parfois les innovations techniques qui seraient susceptibles de bouleverser le
système de production, ou tout au moins ne les recherchent pas.
Cela explique en particulier que certaines inventions, potentiellement très intéressantes, soient restées inutilisées (le moulin à
eau et des dispositifs actionnés par la vapeur, par exemple, qui
figuraient dans les écrits de Héron d'Alexandrie au ne siècle
av.
J.-C.).
L'émergence de la bourgeoisie en Europe (à partir des XIeXIIe siècles) introduit progressivement un élément de déstabilisation dans la société.
Elle se constitue initialement à partir de
marchands, de banquiers ...
Pour vendre, il faut produire;
quand le commerce s' êtend, il faut produire davantage ; pour
cela, il faut souvent innover; si les possibilités, offertes par les
structures sociales et économiques, plafonnent, ces structures
elles-mêmes sont mises en cause (voir art.
16 à propos des systèmes énergétiques).
L'existence d'une rude concurrence induit
la recherche systématique de tout ce qui est susceptible
d'accroître la production, d'améliorer la rentabilité du travail.
On peut noter quelques temps forts de cette progression : le
XIIIe siècle (où se produit ce que J.
Gimpel appelle la « révolution industrielle aû moyen âge»); la Renaissance dont émergent, pour ce qui nous concerne, les figures emblématiques de
ceux que B.
Gille appelle « les ingénieurs» (Léonard de Vinci :
Brunelleschi, architecte du dôme de la cathédrale de Florence ;
Albrecht Dürer, également peintre et graveur ...
).
Galilée n'est
pas seulement le créateur de la méthode expérimentale, c'est
aussi un personnage qui s'intéresse à la technique (à l' Arsenal
de Venise, entre autres).
Les spécialistes, qui ont la faveur des industriels et des entrepreneurs, sont les maître-artisans, les techniciens, les ingénieurs.
Formés d'abord par l'apprentissage, puis « sur le tas»,
ceux-ci ont bientôt besoin de connaissances plus approfondies.
La technicité accrue des fabrications, l'évolution des sciences
et celle des techniques commandent.
Cela explique l'apparition, aux côtés des modes traditionnels de formation, d'écoles
d'ingénieurs semblables à celles que nous connaissons: École
royale des Ponts et Chaussées (1747), École des Mines et des
Techniques minières (1783) ...
Des savants mettent parfois
eux-mêmes « la main à la pâte» : en optique (Galilée, Kepler,
Huygens, Newton, Euler ...
); à propos de la mesure du temps
(Galilée, Huygens ...
).
Le mouvement s'accentue au XIXe siècle dans le cadre de la
nouvelle révolution industrielle, qui repose sur un système
énergétique dont l'élément dominant est la machine à vapeur.
Les chimistes sont sollicités par l'industrie textile (pour la
fabrication des colorants, pour le blanchiment des tissus, pour
l'amélioration des techniques métallurgiques ...).
Les physiciens conduisent l'évolution de l'électrodynamique et de l'électromagnétisme.
L'électricité, en tant que facteur décisif de
l'essor industriel, se manifeste surtout dans les 30 à 40 dernières années du siècle.
Période charnière capitale, le XIXe siècle comporte, par rap, port à notre temps, des différences nettes: l'État en tant que tel
(c'est-à-dire le pouvoir politique) s'intéresse à la formation des
ingénieurs et des enseignants mais n'organise pas la recherche
et ne la finance pas ; les chercheurs interviennent parfois mais
ies acteurs principaux sont - et de loin - les ingénieurs et les
techniciens; l'intérêt porté par les militaires est réel (explosifs,
etc.), mais n'est pas qualitativement différent de ce qu'il était
précédemment.
Un phénomène n'est pas à négliger: l'influence de la
science, de ses méthodes, de ses philosophies, sur les façons de
penser, sur les mentalités.
Depuis le XVIIIe siècle, et particulièrement à la suite de la philosophie des Lumières (Voltaire,
Rousseaù, Diderot, d'Alembert, Condillac, Condorcet...
) en
France, la science est identifiée au progrès : technique, certainement, mais aussi intellectuel et spirituel.
Au XIXe siècle, cela
se traduit de différentes manières.
La plus connue est le scientisme.
Sorte de religion (dans laquelle -la science remplaçait
Dieu), il proclamait que le progrès des sciences et des techniques allait résoudre tous les problèmes, que le monde serait
scientifiquement gouverné, etc.
Parmi les tenants français les plus connus de cette tendance
figurent Auguste Comte, Ernest Renan, Littré, le chimiste Marcelin Berthelot, etc.
Cette forme de scientisme a imprégné toute
la pensée de son temps et continue à avoir de sérieuses répercussions de nos jours (voir art.
16, 20 et 21).
Influencé aussi par lui, malgré sa volonté contestataire, le
marxisme est pour l'essentiel une tentative d'application à tous les sujets (y compris à la politique et à ce qui deviendra les
sciences humaines et sociales) des méthodes empruntées aux
sciences expérimentales.
En réaction, sont apparues aussi des
philosophies s'opposant aux sciences (Maine de Biran au début
du siècle, Henri Bergson plus tard...
).
La technoscience, composante majeure
de la société
Les bouleversements que nous connaissons au xxe siècle,
étaient déjà en germe au siècle précédent.
Il est vrai qu'ils se
sont accentués, amplifiés et que les prédécesseurs de nos
actuels auteurs de science-fiction (Jules Verne compris) n'ont
pas imaginé cette société totalement conditionnée par la technoscience, qui se fige presque complètement si l'électricité
vient à manquer, qui cesse de fonctionner si les télécommunications se bloquent Il y a quelques années, des analystes ont
imaginé ce qui pourrait se passer si, du fait de l'explosion d'une
bombe thermonucléaire dans la haute atmosphère, tous les centraux téléphoniques (et autres), tous les relais électromagnétiques, tous les ordinateurs etc., sautaient.
Il y a trente ans, les
dégâts auraient été gigantesques.
~ujourd'hui,.
sans quand
même «revenir à l'âge de la pierre», ce sont presque toutes les
activités économiques et sociales qui s'interrompraient
Les modifications décisives, par rapport au siècle dernier, sont
de différentes natures.
Des changements quantitatifs
Ils concernent : le nombre de scientifiques (quelques centaines au XVIII° siècle; 10 000 environ vers 1850; 100 000
environ vers 1900; 1 000 000 vers 1955, 5 000 000 environ
vers 1981 ; la population scientifique mondiale a environ doublé tous les 10 ans de 1945 à 1980, ceci en ne recensant que
ceux qui ont - à plein temps ou à temps partiel - une activité
de recherche) ; le nombre et la dimension des laboratoires
(on est passé en 200 ans du «cabinet» individuel au petit laboratoire, puis au grand Institut); le nombre de publications
(deux revues en 1665; une douzaine vers 1750; un millier vers
1850; 75 000 aujourd'hui); le volume des crédits consacrés à
la recherche (ponctuels et difficiles à évaluer avant 1939, faute
de ligne budgétaire spécifique, ils ont augmenté constamment
de 1945 à 1970, et ont eu ensuite une tendance relative à la
stagnation.
En 1986, les États-Unis consacraient 2,80 % de leur
produit intérieur brut à la recherche et au développement.
Il y a
de très grands écarts entre les pays industrialisés et ceux du
tiers monde).
Des changements structurels
Les chiffres que nous venons de citer évoquent déjà leur existence et leur ampleur.
Le statut social du scientifique s'est
complètement transformé.
Jusqu'au début du XIXe siècle, il
travaillait seul ou, tout au plus, aidé par quelques disciples.
Il
lui arrivait d'être aidé par un riche mécène, d'avoir une fortune
personnelle ou une activité professionnelle principale lui permettant de vivre (Galilée était professeur, Pierre de Fermat était
magistrat, etc.).
Au XIX0 siècle, certains chercheurs ont été
financés pour partie par des industriels (Pasteur, par exemple, a
exécuté des contrats pour le compte de brasseurs du Nord) ou
sont devenus industriels eux-mêmes (le chimiste français Gay-
Lussac, par exemple).
Les gouvernements, en tant que tels, ne
sont jamais intervenus systématiquement
Après quelques décennies de transition au cours desquelles
l'effort de recherche a été officieusement pris en charge par les
universitaires (mais sans qu'ils reçoivent pour cela un financement particulier), l'accroissement du rôle social de la science
est reconnu par la création de ministères spécialisés, l'affectation (très officielle, cette fois) d'un budget, la création de
grands organismes.
Si l'on prend l'exemple français, le premier
sous-secrétariat d'État à la recherche scientifique est fondé par
Léon Blum en 1936 (et sa première titulaire est Irène Joliot
- Curie), le C.N.R.S.
est en principe créé en 1939.
Viennent
ensuite à partir de 45 : le C.E.A., le C.N.E.T., l'I.N.S.E.R.M.,
l'I.N.R:A., l'O.R.S.T.O.M.
devenu I.R.D.
: Institut de Recherche
pour le Développement, le C.N.E.S., I.FR.E.MER.
: Institut
Français de Recherche et d'Exploitation de la Mer, etc.
Il y a certes toujours quelques savants prestigieux (les Prix
Nobel et ceux - les plus médiatiques - que l'on voit à la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓