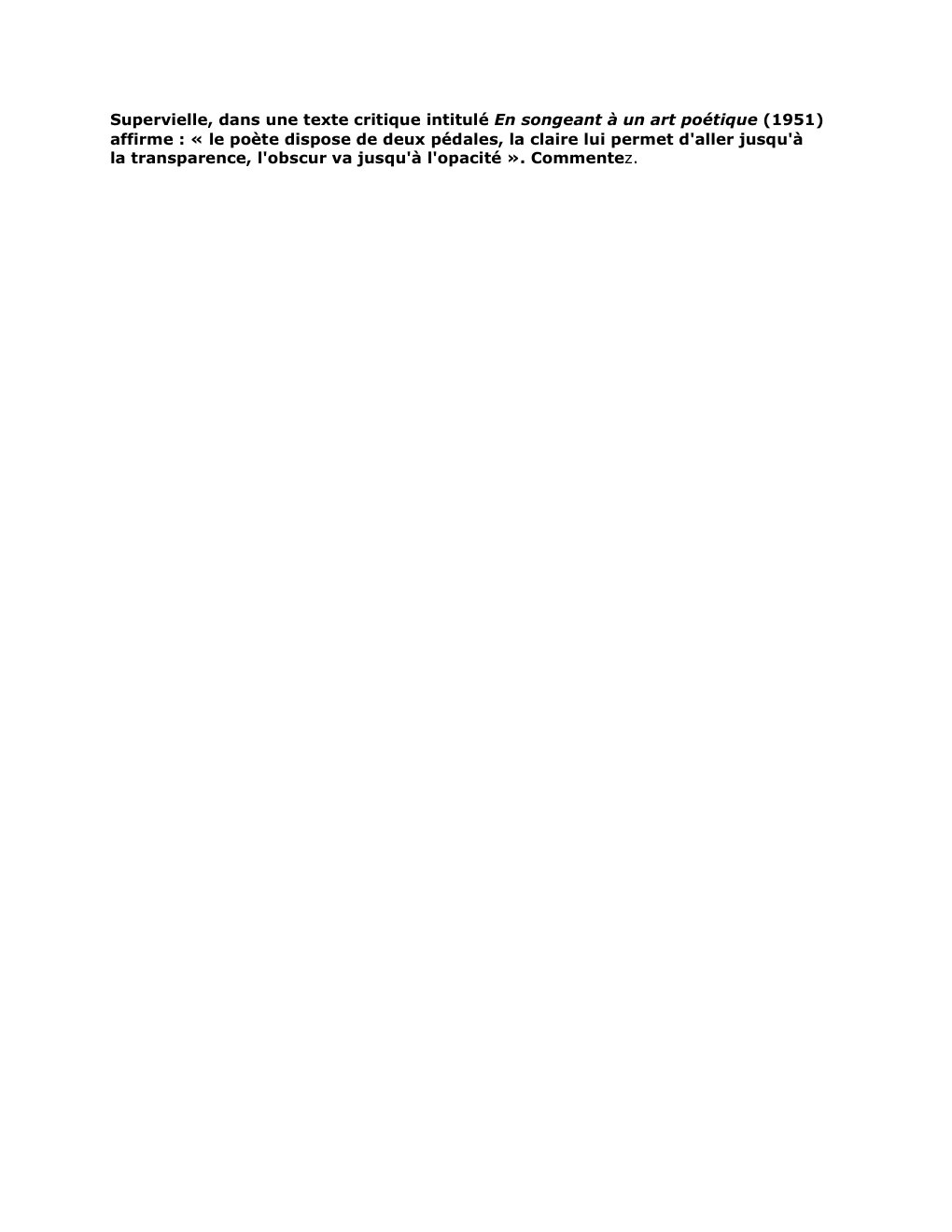Supervielle, dans une texte critique intitulé En songeant à un art poétique (1951) affirme : « le poète dispose de...
Extrait du document
«
Supervielle, dans une texte critique intitulé En songeant à un art poétique (1951)
affirme : « le poète dispose de deux pédales, la claire lui permet d'aller jusqu'à
la transparence, l'obscur va jusqu'à l'opacité ».
Commentez.
Supervielle, dans une texte critique intitulé En songeant à un art poétique (1951)
affirme : « le poète dispose de deux pédales, la claire lui permet d'aller jusqu'à
la transparence, l'obscur va jusqu'à l'opacité ».
Commentez.
La poésie, entre hermétisme et clarté ?
I- La poésie, texte qui est donc parfois difficile à comprendre, obscur
A- Le propre langage de la poésie
• La syntaxe et le vocabulaire de la poésie sont spécifiques.
Ex : onde pour eau ou « sur
un arbre perché » pour « perché sur un arbre ».
=> le poème n’est pas un texte qui peut être résumé.
Il s’agit surtout d’une alliance de
sonorités, d’effets, d’images…
• Le poète crée parfois sa propre langue pour jouer plus librement avec elle.
Étrangeté des
métaphores symbolistes, « déracinement du langages ».
Ex : « la terre est bleue comme
une orange ».
R : tout un pan de la poésie moderne est faite de jeux avec le langage.
Le poème de
Desnos invente un « langage cuit » ; les paronomases de Max Jacob créent un univers
ludique où « Avenue du Maine / Les manèges déménagent » mais qui ne font pas toujours
sens.
• De plus, d’après Mallarmé, il faut : « Donner un sens plus pur aux mots de la tribu […]
» => le mot pur ne veut pas dire simple mais plutôt passé au creuset, épuré, loin du sens
utilitaire du langage commun.
Hermétisme pour saisir la réalité.
B- Le propre langage de la poésie
• La littérature a pour but d'exprimer une perception des choses de telle manière que le
lecteur la comprenne mais la poésie est particulière en ce sens que le poète crée parfois
sa propre langue pour jouer plus librement avec elle.
• Beaucoup de poètes, Baudelaire, Rimbaud, après s’être exprimés en vers ont utilisé la
prose.
Mais la réduction syntaxique peut être telle qu’on finit pas ne plus rien comprendre.
• Au XXe siècle, les poètes ont tenté de réduire l’arbitraire du signe.
=> La poésie utilise aussi son propre langage : Cf.
le « Sonnet des Voyelles » de Rimbaud.
La poésie tend à créer un langage qui lui est propre.
C- La poésie, un art difficile à pénétrer
• Comprend-on toujours qu’un poème aussi simple que Pour faire le portrait d’un oiseau
de Prévert cache en fait un art poétique, un plaidoyer pour un art libre et pour une nature
à préserver ?
« Mes sonnets […] perdraient en charme à être expliqués, si la chose en était possible »
affirme Nerval.
• C’est parfois une revendication du poète de réserver son œuvre aux seuls initiés et de la
rendre volontairement hermétique au profane.
Le message poétique réservé aux êtres
sensibles ? => Hermétisme.
Ex : Mallarmé choisit des mots rares : « Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx, / Aboli
bibelot d’inanité sonore… ».
Cf.
le poète Char qui reconnaissait que certains pans de ses poèmes ne pouvaient être
compris.
=> Le poème peut certes être obscur, impossible à comprendre.
Hermétisme : conception finalement élitiste, poésie volontairement inaccessible au
profane.
NB : la poésie n’a pas intérêt à être trop obscure ou opaque car elle ne serait pas
comprise et finalement, abandonnée.
(Risque d’être trop élitiste).
∆) Obscurité de la poésie qui peut nuire à la compréhension du poème et
déplaire au lecteur qui peut se sentir exclu.
Mais toutefois, cette difficulté peut être
dépassée – elle tient d’ailleurs en partie à l’essence même de la poésie, à ce qui fait sa
spécificité.
II- Le langage de l’émotion
Les poètes créent un nouveau langage, mettent en image des réalités, des
rêves…
A- Une différence à dépasser
=> Finalement, la poésie peut dépasser le problème de compréhension parce qu’elle frappe
directement par les sens et que donc, elle parle à tous les temps, à travers le temps.
Valéry explique : « le poème ne meurt pas pour avoir servi ; il est fait
expressément pour renaître de ses cendres et redevenir indéfiniment ce qu’il vient
d’être.
»
• Cf.
le texte d’H.
Michaux => il crée de nouveaux mots « Il l'emparouille et l'endosque
contre terre ;/ Il le rague et le roupéte jusqu'à son drâle ; / Il le pratéle et le libucque et
lui baroufle les ouillais ».
Travail des mots, travail de la langue.
Mots-valises, néologismes… Même si on ne connaît
pas les mots, on comprend dans ce poème l’horreur de la guerre.
B- Un langage de l’émotion
• La poésie : condensé d'écriture qui rassemble une grande quantité d'émotions (VS prose
ou théâtre qui sont souvent de longs développements).
Ex : « il a deux trous rouges dans la poitrine » => Rimbaud avec son poème « Le Dormeur
du Val», dépeint en quelques lignes toute l'horreur de la guerre que l'on retrouve dans la
littérature en prose dans de longs développements.
C- La musicalité, l’essence de la poésie
• Pour Verlaine, Baudelaire, Mallarmé, Valéry ou Claudel, la poésie est ce....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓