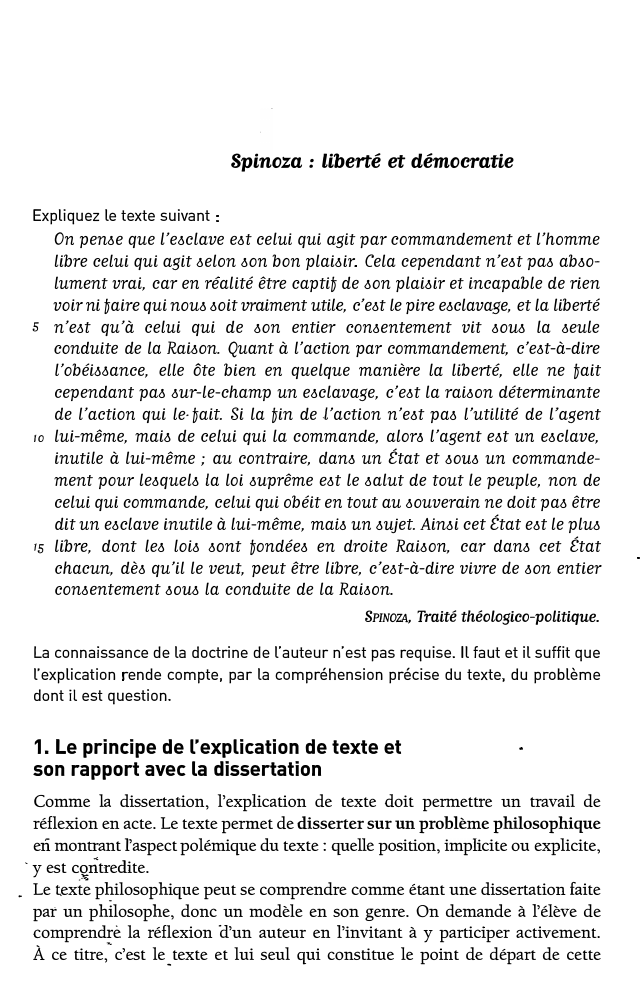Spinoza : liberté et démocratie Expliquez le texte suivant On pen6e que l'e6clave e6t celui qui agit par commandement et...
Extrait du document
«
Spinoza : liberté et démocratie
Expliquez le texte suivant
On pen6e que l'e6clave e6t celui qui agit par commandement et l'homme
libre celui qui agit 6elon 6on bon plai6ir.
Cela cependant n'e6t pa6 ab6o
lument vrai, car en réalité être captit de 6on plai6ir et incapable de rien
voir ni taire qui nou6 60it vraiment utile, c'e6t le pire e6clavage, et la liberté
s n'e6t qu'à celui qui de 60n entier con6entement vit 60U6 la 6eule
conduite de la Rai6on.
Quant à l'action par commandement, c'e6t-à-dire
l'obéiMance, elle ôte bien en quelque manière la liberté, elle ne tait
cependant pa6 6Ur-le-champ un e6clavage, c'e6t la rai60n déterminante
de l'action qui le- tait.
Si la tin de l'action n'e6t pa6 l'utilité de l'agent
10 lui-même, mai6 de celui qui la commande, alon l'agent e6t un e6clave,
inutile à lui-même ; au contraire, dan6 un ttat et 60U6 un commande
ment pour le6quel6 la loi 6Uprême e6t le 6alut de tout le peuple, non de
celui qui commande, celui qui obéit en tout au 6ouverain ne doit pa6 être
dit un e6clave inutile à lui-même, mai6 un 6Ujet.
Ain6i cet ttat e6t le plu6
15 libre, dont le6 loi6 6ont tondée6 en droite Rai6on, car dan6 cet ttat
chacun, dè6 qu'il le veut, peut être libre, c'e6t-à-dire vivre de 6on entier
con6entement 60U6 la conduite de la Rai6on.
SPINOZA, Traité théologico-politique.
La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise.
Il faut et il suffit que
l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème
dont il est question.
1.
Le principe de l'explication de texte et
son rapport avec la dissertation
Comme la dissertation, l'explication de texte doit permettre un travail de
réflexion en acte.
Le texte permet de disserter sur un problème philosophique
en montrant l'aspect polémique du texte : quelle position, implicite ou explicite,
· y est CQrÎtredite.
.
Le text� p1!-ilosophique peut se comprendre comme étant une dissertation faite
pat un philosophe, donc un modèle en son genre.
On demande à l'élève de
comprendrè la réflexion "d'un auteur en l'invitant à y participer activement.
À ce titre,� c'est le _texte et lui seul qui constitue le point de départ de cette
réflexion : comme le précise le libellé du sujet-texte, l'élève n'est pas tenu de
maîtriser la doctrine de l'auteur.
On peut également souligner la nécessité de pratiquer à la fois l'exercice de la
dissertation et l'explication, puisque ces deux démarches sont constitutives du
travail philosophique en général et se complètent : en pratiquant les textes, on
parvient d'autant mieux à disserter; et en dissertant soi-même, on progresse
dans son aptitude à lire les textes philosophiques.
Le libellé exact du sujet-texte est le suivant : « La connaissance de la doctrine
de l'auteur n'est pas requise.
Il faut et il suffit que l'explication rende compte,
par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question.
»
C'est dire qu'on demande à la fois une explication linéaire scrupuleuse et
attentive et un recul critique permettant d'apprécier l'aptitude du texte à
traiter un problème philosophique.
l'.explication doit donc faire apparaître ces
deux démarches :
- soit en deux parties différentes : d'abord l'explication détaillée et ordonnée,
ensuite la réflexion critique ;
- soit en une seule partie : on mène de pair les deux démarches, l'explication
et la mise en relief critique, en suivant toujours le texte pas à pas.
La méthode en deux parties peut être considérée comme plus facile et plus
accessible que l'autre méthode : elle offre l'avantage de séparer distinctement
les deux démarches.
Dans tous les cas, on attend que se manifeste une double aptitude :
- une aptitude à comprendre le texte de l'intérieur en se mettant à la place de
l'auteur et en rendant compte fidèlement de sa pensée;
- une aptitude à discuter le point de vue de l'auteur pour en montrer la portée
philosophique, voire les limites en se plaçant cette fois davantage à l'extérieur
du texte.
2.
L:'introduction
1) Trouver le problème et la thèse
Comme pour la dissertation·, l'introduction de l'explication de texte doit poser
un problème philosophique, celui qui est contenu dans le texte et que l'auteur
s'efforce de resoudre.
Ce peut être la question à laquelle répond le texte mais
cette question doit être problématisée comme on le fait lorsque l'on problématise
un sujet de dissertation, c'est-à-dire à partir d'un paradoxe qui permette la
confrontation de thèses opposées.
Par exemple dans le texte de Spinoza, la question à laquelle répond 1~ texte~
peut être la suivante: qu'est-ce que la liberté? Mais le problème est bea'4,~oup
plus précis : il s'agit de comprendre comment on peut concilier l'çxigenœ
d'indépendance qui semble fonder la liberté avec la nécessité de l'obéissance aù
commandement d'autrui, et plus particulièrement aux lois de l'État..
Y a-t-il
une forme possible d'obéissance politique qui soit compatible: avec hi.liberté?
Le paradoxe qui peut servir de point de départ peut être le suivant: d'un côté,
on pose la liberté comme opposée à l'obéissance; d'un autre côté, on pose la
liberté comme conduite orientée par la raison, donc comme une certaine manière
d'obéir.
La thèse est une réponse au problème, c'est ce que pose l'auteur et qui
représente un dépassement possible d'une certaine opinion.
Ici, la thèse est la
suivante : l'obéissance aux lois de l'État démocratique, loin d'être un esclavage
comme on aurait tendance à le croire, est au contraire ce qui rend possible la
vraie liberté, pour autant qu'on obéisse par raison à une loi de raison.
2) Repérer le plan du texte
r.introduction doit également annoncer clairement le plan du texte de façon
très synthétique.
Par exemple, pour lê texte de Spinoza, on peut annoncer la
structure du texte comme suit :
Nous est d'abord présentée la croyance commune (1.
1-2), que le philosophe
rectifie par un effort définitionnel (1.
2-6).
Cette rectification permet alors de
distinguer deux sortes d'obéissances, que l'opinion confondait (1.
6-14), ce qui
justifie la thèse de Spinoza : l'Etat démocratique permet la liberté (1.
14-17).
3) Dégager l'intérêt philosophique : la mise en perspective critique .
Enfin, l'introduction doit annoncer l'intérêt philosophique du texte, qui sera
traité, selon l'une ou l'autre méthode, soit au fur et à mesure de l'explication,
soit dans une partie à part après l'explication proprement dite.
r.intérêt philosophique est une manière de mettre à l'épreuve de la réflexion
critique le point de vue de l'auteur : quelle portée, quelle valeur, voire quelles
limites sa thèse admet+elle?
4) Rédiger et structurer l'introduction
La structure de l'introduction peut proposer l'ordre suivant.
Premier paragraphe :
- énoncé du problème (question problématisée à laquelle répond le texte);
- énoncé de la thèse (comme réponse au problème posé).
Deuxième paragraphe :
- annonce du plan du texte.
Troisième paragraphe :
- annonce de la réflexion critique.
Exemple d'introduction
[Problème]
S'agissant de la liberté, on ne peut que se demander comment on peut concilier
l'exigence d'indépendance qui semble fonder la liberté avec la nécessité de
L'obéissance au commandement d'autrui, et plus particulièrement aux lois
de l'État.
Y a-t-il une forme possible d'obéissance politique qui soit compatible avec la liberté ?
[Thèse]
Pour Spinoza, l'obéissance aux lois de l'État démocratique, loin d'être un
esclavage, comme on aurait tendance à le croire, est au contraire ce qui rend
possible la vraie liberté, pour autant qu'on obéisse par raison à une loi de
raison.
[Annonce du plan]
Nous est d'abord présentée la croyance commune IL 1-2), que le philosophe
rectifie par un effort définitionnel IL 2-6).
Cette rectification permet alors de
distinguer deux sortes d'obéissances, que l'opinion confondait IL 6-14), ce
qui justifie la thèse de Spinoza: l'État démocratique permet la liberté IL 14-17).
[Annonce de la réflexion critique]
Si, comme le montre Spinoza, l'État démocratique semble un modèle de liberté
et d'obéissance positive, parce que reposant sur des lois raisonnables (justes),
comment cependant s'assurer de la justesse et de la justice de ces lois?
3.
~explication
La démarche explicative doit absolument se distinguer du résumé ou de la
paraphrase.
Elle n'a en effet rien du caractère synthétique du résumé, ni rien
du caractère répétitif de la paraphrase.
Le résumé réduit le texte en ses moments essentiels, alors que l'explication
déploie (explicare signifie en latin déplier) le texte en imposant un travail de
développement.
,
.
La paraphrase se propose de dire ce que dit le texte (paraphraser, c'est littéralement proposer un texte à côté du text~, comme étant sa simple répétition), alors
que l'explication répond à la question :yourquoi l'auteur dit-il ceci?
1) Les concepts
D'où un travail sur ce qu'on appelle les concepts, c'est-à-dire les mots clés du
texte : si l'auteur emploie tel mot plutôt que tel autre, c'est pour une ou
plusieurs raisons.
Expliquer, c'est donc expliciter le sens des mots, clarifier
l'intention de l'auteur, et en ce sens, l'explication de l'élève se doit d'être au
moins aussi claire que le texte.
Cependant, cette analyse doit se faire sans tomber dans le inot à mot : il faut
soigneusement manifester le fil conducteur qui organise le passage interrogé.
!:explication ne doit donc être ni trop globale (on néglige les concepts), ni trop
pointilleuse (on ne comprend plus l'idée directrice du passage expliqué).
2) La structure logique
De même, il faut souligner la structure logique du texte, et pas seulement en
annonçant le plan dans l'introduction.
Le texte philosophique se veut en effet
réflexif :· l'auteur est un philosophe dont le travail consiste à réfléchir sur l'être
humain en s'efforçant de réinterroger un certain nombre d'opinions pour les
remettre en question ou évaluer leur fondement.
Sa thèse, ce qu'il veut montrer,
repose donc sur une progression logique que vous vous devez de faire apparaître en montrant exactement les liens (les articulations) entre les parties et
sous-parties du texte.
3) L.:organisation de l'explication
- Annonce de l'idée directrice de la partie ou de la sous-partie qui va être
expliquée et mise en évidence de sa valeur logique (l'auteur expose, explique,
réfute, illustre, déduit, remarque, constate ...
).
On peut poser une question et
répondre par l'idée directrice.
- Analyse des concepts avec éventuellement citation du texte et mention des
lignes : on ne doit ni trop citer le texte ni ne jamais le citer !
Exemple d'explication pour la première phrase du texte
[Annonce de l'idée directrice du passage]
Comment L'opinion commune conçoit-elle habituellement La Liberté et son
rapport à l'obéissance?
Selon Spinoza, L'opinion repose sur une croyance, qui fait de L'obéissance un
esclavage, et de La satisfaction illimitée des désirs La Liberté.
[Explication et analyse des concepts]
Ici, L'opinion oppose de manière absolue obéissance et Liberté, rendant
impossible une Liberté pouvant reposer sur L'obéissance.
En effet, on conçoit
habituellement La Liberté en termes d'indépendance et de Licence : elle consisterait à pouvoir tout se permettre sans suivre aucun ordre pouvant venir
d'autrui.
La Liberté, selon L'opinion, doit venir de soi et de ses propres désirs.
La notion de «commandement» au contraire impliquerait soumission aux
désirs d'autrui et par conséquent esclavage.
L.'.opinion oppose brutalement
deux sources possibles d'action [« agit par...
agit selon») qui décideraient de
notre Liberté ou de notre esclavage selon que La source est en nous [« selon
son bon plaisir») ou en autrui [« par commandement»).
4.
Les transitions
On trouvera des transitions à plusieurs niveaux du commentaire.
1) À l'intérieur de la partie explicative
Il s'agit ici de mettre en évidence la structure logique précise du texte aussi
bien dans ses grandes parties que dans ses sous-parties.
Les transitions nous
font passer de l'explication d'un moment du texte à l'explication du moment
suivant.
Elles peuvent prendre la forme de questions.
Exemples de transition
à l'intérieur de la partie explicative
[Pour le passage de l'explication des lignes (1-2) à l'explication des lignes (2-6)]
Quelle réfutation de cette opinion Spinoza nous propose-t-il ?
[Pour le passage de l'explication des lignes (9-10) à l'explication des lignes (10-14)]
En quoi l'obéissance n'est-elle pas nécessairement la négation de la liberté et
quelles sont les différentes formes d'obéissance ?
2) Entre la partie explicative et la réflexion critique
(pour la première méthode)
Il s'agit, comme dans l'introduction, de passer de ce que pose l'auteur dans le
texte, à ce qu'on peut poser en prenant un recul critique par rapport au texte.
On fait ici un premier bilan de l'explication pour annoncer ce qui sera
développé dans la partie critique.
Exemple de transition entre la partie explicative et la réflexion critique
Nous constatons ainsi avec Spinoza que l'obéissance, à certaines conditions,
n'exclut pas la liberté, tout au contraire, comme le montre l'obéissance aux
lois de l'État démocratique.
Cependant, on ne peut que s'interroger aussi sur
ce qui rend possible une telle obéissance, c'est-à-dire en fait sur ce qui rend
possible des lois fondées en raison.
5.
La réflexion critique
Elle doit proposer une réflexion à partir du texte et essentiellement de la thèse
soutenue par l'auteur pour en approfondir la portée philosophique (quelles
conséquences?), la valeur (en quoi enrichit-elle ou réduit-elle notre perception
du monde et de l'homme?), les limites éventuelles (jusqu'à quel point peut-on
la soutenir?).
Plusieurs choix sont possibles et c'est à l'élève de décider de
l'orientation de sa réflexion critique, à condition qu'elle prenne directement
appui sur le texte : la question posée doit s'inscrire directement dans le prolongement de sa lecture ; il ne faut pas partir d'une question trop générale ni
trop réduite.
Prendre la thèse comme point de départ est conseillé.
La réflexion doit permettre de répondre à la question ou aux questions posées
dans l'introduction dans ce qui constituait précisément l'annonce de la réflexion
critique.
On peut ainsi décomposer la partie critique en plusieurs mouvements comme
dans le cadre d'une dissertation, sachant qu'ici on développera moins chaque
idée.
Le premier moment de la partie critique peut reprendre la thèse de l'auteur
pour en montrer la portée et la valeur philosophique en général (on évitera de
répéter ce qui aura été dit da_ns l'explication).
Par exemple ici, on pourra expliquer l'intérêt que représente une conception positive de l'État, au sens où cela
permet à l'homme de s'impliquer dans la décision politique et de développer
son souci de créer et de maintenir des lois justes garantissant sa liberté.
Le second moment de la partie critique peut ensuite montrer les limites de la
thèse de l'auteur.
Par exemple ici, il s'agira d'interroger les conditions de la justice
des lois et de la libre république : comment s'assurer que les lois et leurs
auteurs ont pour but « le salut de tout le peuple» et non pas des intérêts particuliers cachés? Comment former le sens critique· du citoyen pour qu'il puisse
justement s'assurer....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓