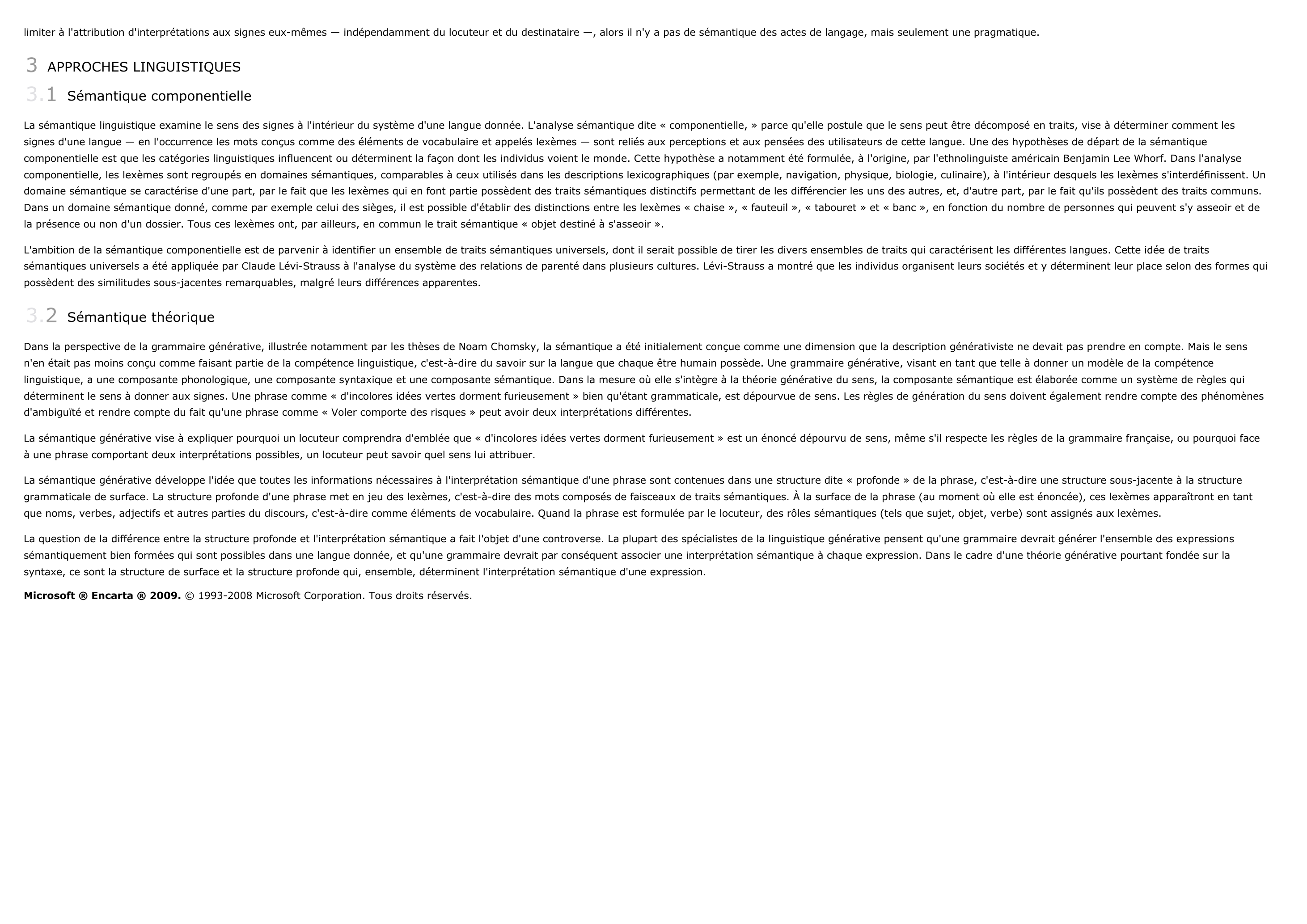sémantique - Langues et Linguistique.
Publié le 07/05/2013
Extrait du document
«
limiter à l'attribution d'interprétations aux signes eux-mêmes — indépendamment du locuteur et du destinataire —, alors il n'y a pas de sémantique des actes de langage, mais seulement une pragmatique.
3 APPROCHES LINGUISTIQUES
3. 1 Sémantique componentielle
La sémantique linguistique examine le sens des signes à l'intérieur du système d'une langue donnée.
L'analyse sémantique dite « componentielle, » parce qu'elle postule que le sens peut être décomposé en traits, vise à déterminer comment les
signes d'une langue — en l'occurrence les mots conçus comme des éléments de vocabulaire et appelés lexèmes — sont reliés aux perceptions et aux pensées des utilisateurs de cette langue.
Une des hypothèses de départ de la sémantique
componentielle est que les catégories linguistiques influencent ou déterminent la façon dont les individus voient le monde.
Cette hypothèse a notamment été formulée, à l'origine, par l'ethnolinguiste américain Benjamin Lee Whorf.
Dans l'analyse
componentielle, les lexèmes sont regroupés en domaines sémantiques, comparables à ceux utilisés dans les descriptions lexicographiques (par exemple, navigation, physique, biologie, culinaire), à l'intérieur desquels les lexèmes s'interdéfinissent.
Un
domaine sémantique se caractérise d'une part, par le fait que les lexèmes qui en font partie possèdent des traits sémantiques distinctifs permettant de les différencier les uns des autres, et, d'autre part, par le fait qu'ils possèdent des traits communs.
Dans un domaine sémantique donné, comme par exemple celui des sièges, il est possible d'établir des distinctions entre les lexèmes « chaise », « fauteuil », « tabouret » et « banc », en fonction du nombre de personnes qui peuvent s'y asseoir et de
la présence ou non d'un dossier.
Tous ces lexèmes ont, par ailleurs, en commun le trait sémantique « objet destiné à s'asseoir ».
L'ambition de la sémantique componentielle est de parvenir à identifier un ensemble de traits sémantiques universels, dont il serait possible de tirer les divers ensembles de traits qui caractérisent les différentes langues.
Cette idée de traits
sémantiques universels a été appliquée par Claude Lévi-Strauss à l'analyse du système des relations de parenté dans plusieurs cultures.
Lévi-Strauss a montré que les individus organisent leurs sociétés et y déterminent leur place selon des formes qui
possèdent des similitudes sous-jacentes remarquables, malgré leurs différences apparentes.
3. 2 Sémantique théorique
Dans la perspective de la grammaire générative, illustrée notamment par les thèses de Noam Chomsky, la sémantique a été initialement conçue comme une dimension que la description générativiste ne devait pas prendre en compte.
Mais le sens
n'en était pas moins conçu comme faisant partie de la compétence linguistique, c'est-à-dire du savoir sur la langue que chaque être humain possède.
Une grammaire générative, visant en tant que telle à donner un modèle de la compétence
linguistique, a une composante phonologique, une composante syntaxique et une composante sémantique.
Dans la mesure où elle s'intègre à la théorie générative du sens, la composante sémantique est élaborée comme un système de règles qui
déterminent le sens à donner aux signes.
Une phrase comme « d'incolores idées vertes dorment furieusement » bien qu'étant grammaticale, est dépourvue de sens.
Les règles de génération du sens doivent également rendre compte des phénomènes
d'ambiguïté et rendre compte du fait qu'une phrase comme « Voler comporte des risques » peut avoir deux interprétations différentes.
La sémantique générative vise à expliquer pourquoi un locuteur comprendra d'emblée que « d'incolores idées vertes dorment furieusement » est un énoncé dépourvu de sens, même s'il respecte les règles de la grammaire française, ou pourquoi face
à une phrase comportant deux interprétations possibles, un locuteur peut savoir quel sens lui attribuer.
La sémantique générative développe l'idée que toutes les informations nécessaires à l'interprétation sémantique d'une phrase sont contenues dans une structure dite « profonde » de la phrase, c'est-à-dire une structure sous-jacente à la structure
grammaticale de surface.
La structure profonde d'une phrase met en jeu des lexèmes, c'est-à-dire des mots composés de faisceaux de traits sémantiques.
À la surface de la phrase (au moment où elle est énoncée), ces lexèmes apparaîtront en tant
que noms, verbes, adjectifs et autres parties du discours, c'est-à-dire comme éléments de vocabulaire.
Quand la phrase est formulée par le locuteur, des rôles sémantiques (tels que sujet, objet, verbe) sont assignés aux lexèmes.
La question de la différence entre la structure profonde et l'interprétation sémantique a fait l'objet d'une controverse.
La plupart des spécialistes de la linguistique générative pensent qu'une grammaire devrait générer l'ensemble des expressions
sémantiquement bien formées qui sont possibles dans une langue donnée, et qu'une grammaire devrait par conséquent associer une interprétation sémantique à chaque expression.
Dans le cadre d'une théorie générative pourtant fondée sur la
syntaxe, ce sont la structure de surface et la structure profonde qui, ensemble, déterminent l'interprétation sémantique d'une expression.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA LINGUISTIQUE : SCIENCE DU LANGAGE ET DES LANGUES
- Johnson, Samuel - Langues et Linguistique.
- Jakobson, Roman - Langues et Linguistique.
- Grimm, frères - Langues et Linguistique.
- fonctions du langage - Langues et Linguistique.