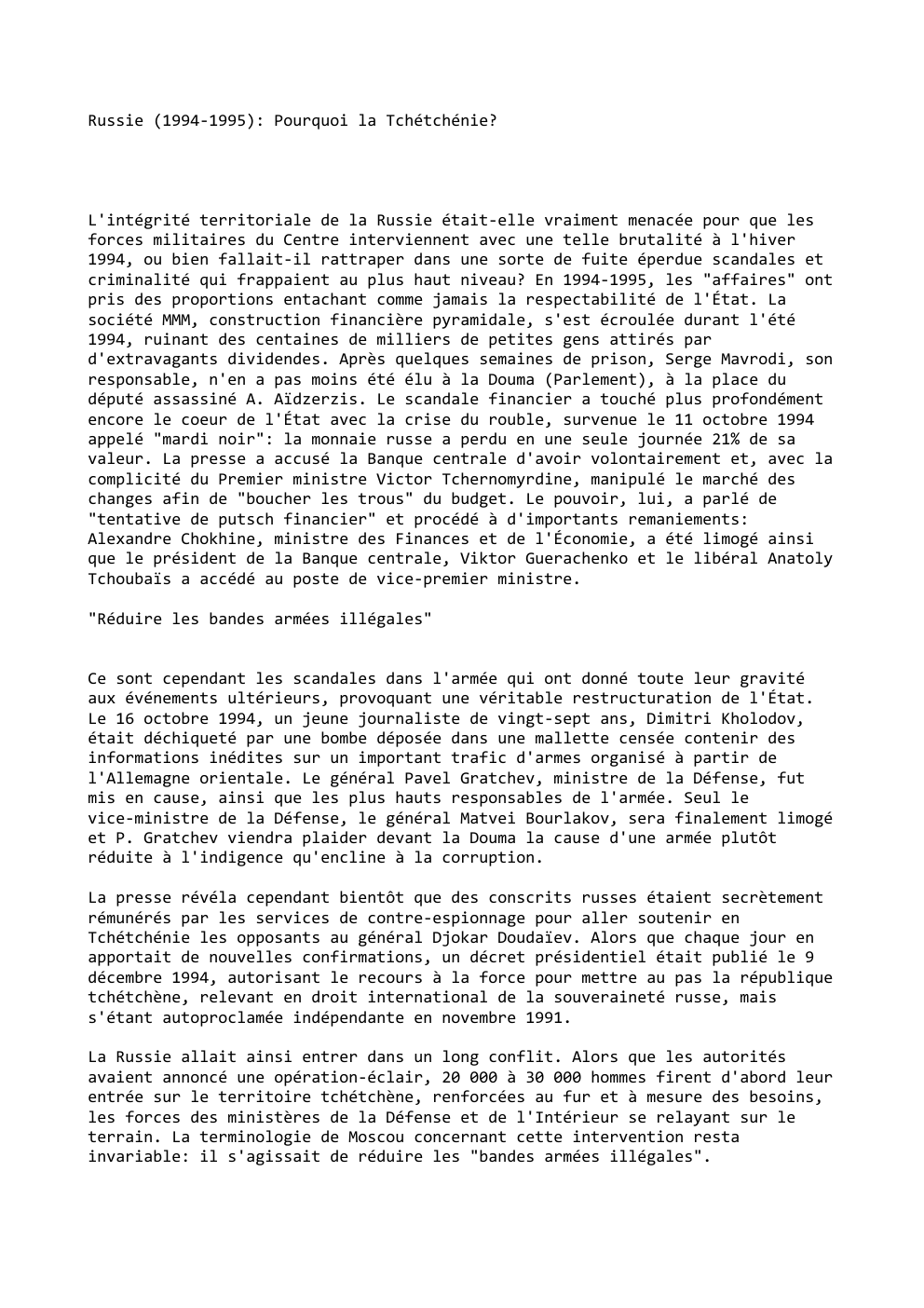Russie (1994-1995): Pourquoi la Tchétchénie? L'intégrité territoriale de la Russie était-elle vraiment menacée pour que les forces militaires du Centre...
Extrait du document
«
Russie (1994-1995): Pourquoi la Tchétchénie?
L'intégrité territoriale de la Russie était-elle vraiment menacée pour que les
forces militaires du Centre interviennent avec une telle brutalité à l'hiver
1994, ou bien fallait-il rattraper dans une sorte de fuite éperdue scandales et
criminalité qui frappaient au plus haut niveau? En 1994-1995, les "affaires" ont
pris des proportions entachant comme jamais la respectabilité de l'État.
La
société MMM, construction financière pyramidale, s'est écroulée durant l'été
1994, ruinant des centaines de milliers de petites gens attirés par
d'extravagants dividendes.
Après quelques semaines de prison, Serge Mavrodi, son
responsable, n'en a pas moins été élu à la Douma (Parlement), à la place du
député assassiné A.
Aïdzerzis.
Le scandale financier a touché plus profondément
encore le coeur de l'État avec la crise du rouble, survenue le 11 octobre 1994
appelé "mardi noir": la monnaie russe a perdu en une seule journée 21% de sa
valeur.
La presse a accusé la Banque centrale d'avoir volontairement et, avec la
complicité du Premier ministre Victor Tchernomyrdine, manipulé le marché des
changes afin de "boucher les trous" du budget.
Le pouvoir, lui, a parlé de
"tentative de putsch financier" et procédé à d'importants remaniements:
Alexandre Chokhine, ministre des Finances et de l'Économie, a été limogé ainsi
que le président de la Banque centrale, Viktor Guerachenko et le libéral Anatoly
Tchoubaïs a accédé au poste de vice-premier ministre.
"Réduire les bandes armées illégales"
Ce sont cependant les scandales dans l'armée qui ont donné toute leur gravité
aux événements ultérieurs, provoquant une véritable restructuration de l'État.
Le 16 octobre 1994, un jeune journaliste de vingt-sept ans, Dimitri Kholodov,
était déchiqueté par une bombe déposée dans une mallette censée contenir des
informations inédites sur un important trafic d'armes organisé à partir de
l'Allemagne orientale.
Le général Pavel Gratchev, ministre de la Défense, fut
mis en cause, ainsi que les plus hauts responsables de l'armée.
Seul le
vice-ministre de la Défense, le général Matvei Bourlakov, sera finalement limogé
et P.
Gratchev viendra plaider devant la Douma la cause d'une armée plutôt
réduite à l'indigence qu'encline à la corruption.
La presse révéla cependant bientôt que des conscrits russes étaient secrètement
rémunérés par les services de contre-espionnage pour aller soutenir en
Tchétchénie les opposants au général Djokar Doudaïev.
Alors que chaque jour en
apportait de nouvelles confirmations, un décret présidentiel était publié le 9
décembre 1994, autorisant le recours à la force pour mettre au pas la république
tchétchène, relevant en droit international de la souveraineté russe, mais
s'étant autoproclamée indépendante en novembre 1991.
La Russie allait ainsi entrer dans un long conflit.
Alors que les autorités
avaient annoncé une opération-éclair, 20 000 à 30 000 hommes firent d'abord leur
entrée sur le territoire tchétchène, renforcées au fur et à mesure des besoins,
les forces des ministères de la Défense et de l'Intérieur se relayant sur le
terrain.
La terminologie de Moscou concernant cette intervention resta
invariable: il s'agissait de réduire les "bandes armées illégales".
Ce que l'on pouvait considérer comme une partie jouée d'avance, étant donné la
supériorité militaire russe, tourna cependant vite et publiquement au désastre.
L'armement était inadapté au terrain, l'opération mal préparée et certains
régiments manifestaient une absence de motivation qui accentuait l'embourbement.
L'assaut contre la capitale tchétchène Grozny demanda des semaines et la ville
ne tomba que début mars 1995, après avoir été presque totalement détruite.
Des
dissensions s'exprimèrent d'ailleurs au sein de l'armée, certains responsables
militaires refusant d'obtempérer quand il s'agissait, par exemple, de mener des
opérations atteignant des civils ou d'obéir à des ordres incohérents.
Manipulation?
Double jeu ou mauvaise coordination? Au sommet de l'État aussi, les
contradictions s'accumulèrent.
Le président Boris Eltsine ordonna, fin décembre
1994, la suspension des hostilités, mais sur place les bombardements reprirent
plus intensivement que jamais.
Le "traître" Doudaïev, selon les termes de la
propagande russe, échappait étrangement à ses poursuivants, alors qu'il
multipliait les interviews publiques à la presse russe et internationale.
Mais
c'est avec les massacres commis en avril 1995 dans la ville de Samachki, à
l'ouest de la république, que fut atteint le sommet de l'horreur: des
vieillards, femmes et enfants furent sommairement exécutés et les maisons
brûlées une à une.
Le conflit a cependant eu pour effet de réveiller une partie de la société
civile russe.
Le Comité des mères de soldats, soucieux de protéger - ou
retrouver - les conscrits engagés ou disparus dans l'affrontement, a montré à la
société le visage de la dignité.
Les mères russes et tchétchènes ont oeuvré côte
à côte, conjuguant expéditions sur place et assistance juridique dans les
principales villes de Russie.
Les militaires opposés au conflit s'organisèrent
eux aussi en un mouvement, tandis que réapparaissaient des publications proches
des samizdat (tirages clandestins) de l'époque bréjnévienne.
Le propre
conseiller aux Droits de l'homme du président Eltsine, Sergueï Kovalev, qui est
resté dans le réduit de Grozny pendant les phases les plus dures des combats,
sera ensuite un témoin infatigable, surnommé "le nouveau Sakharov".
S.
Kovalev avança le chiffre de 20 000 à 30 000 morts civils pour la seule prise
de Grozny.
Les médias russes ont montré certaines images insoutenables ou
souligné les contradictions existant entre informations de sources militaires et
témoignages de terrain.
Enquêtes, documents, éditoriaux au vitriol, une forme de
nouveau journalisme russe est née du conflit, dont la télévision indépendante
NTV a été l'un des supports les plus éloquents.
La "normalisation" que le Kremlin appelait régulièrement de ses voeux, annonçant
tantôt de pseudo-négociations, tantôt des ralliements politiques qui n'avaient
pas eu lieu, ressembla plutôt au fil des mois à une forme d'indifférence jusqu'à
la spectaculaire prise d'otages de Boudennovsk par un commando tchétchène, le 15
juin 1994, qui a débloqué un vrai processus de négociation.
Qui gouverne la Russie?
Pendant que la guerre se déroulait dans le Caucase, le pouvoir, lui, se
réorganisait.
Dans un premier temps, toute autorité fut donnée au Conseil de
sécurité, marginalisant à la fois le travail du gouvernement et les débats
parlementaires.
Cette institution, surnommée "le nouveau Politburo" devait
acquérir une influence grandissante.
Les discours s'y radicalisèrent et ses
décisions devinrent aussi secrètes qu'incontestées.
Mais derrière la question lancinante souvent posée par la presse "Qui gouverne
la Russie?" se profilait un autre rapport de forces, plus occulte encore.
Alexandre Korjakov, officiellement responsable de la Garde présidentielle,
contrôlait en fait au sein du Kremlin une sorte de garde prétorienne rassemblant
quelque 40 000 hommes.
Dans l'entourage du président, on ne tarda pas à parler
de terreur, paralysant toute décision collégiale et évoquant une sorte d'État
policier naissant.
Après les événements de Boudennovsk, le Premier ministre, ayant su négocier et
faire preuve de responsabilité, a semblé bénéficier de plus de poids.
Les
remaniements qui ont suivi ont cependant contribué à accentuer le sentiment de
reprise en main du pouvoir: le ministre de l'Intérieur Victor Erine a été
remplacé par le commandant en chef des forces armées en Tchétchénie, le général
Koulikov, et le responsable des services de contre-espionnage, Sergueï
Stepachine, a été sanctionné au bénéfice du général Barsoukov,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓