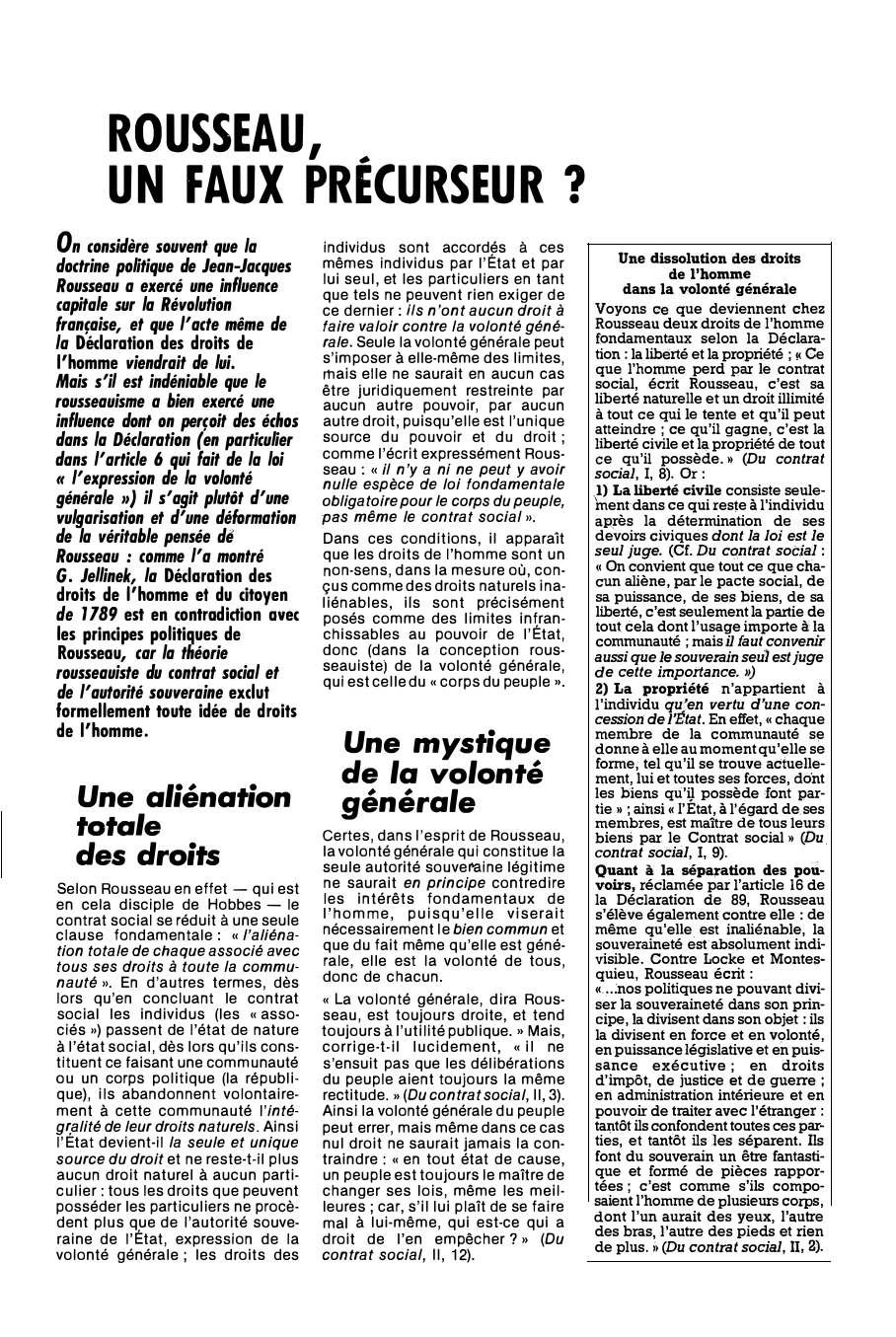ROUSSEAU, UN FAUX PRÉCURSEUR On considère souvent que la doctrine politique de Jean-Jacques Rousseau a exercé une influence capitale sur...
Extrait du document
«
ROUSSEAU,
UN FAUX PRÉCURSEUR
On considère souvent que la
doctrine politique de Jean-Jacques
Rousseau a exercé une influence
capitale sur la Révolution
lranfaise, et que l'acte même de
la Déclaration des droits de
l'homme viendrait de lui.
Mais s'il est indéniable que le
rousseauisme a bien exercé une
influence dont on perf oit des échos
dans la Déclaration (en particulier
dans l'article 6 qui lait de la loi
« l'expression de la volonté
générale ") il s'agit plutôt d'une
vulgarisation et d'une déformation
de la véritable pensée de
Rousseau : comme l'a montré
G.
Jellinek, la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen
de 1189 est en contradiction avec
les principes politiques de
Rousseau, car la théorie
rousseauiste du contrat social et
de l'autorité souveraine exclut
formellement toute idée de droits
de l'homme.
Une aliénation
totale
des droits
Selon Rousseau en effet - qui est
en cela disciple de Hobbes - le
contrat social se réduit à une seule
clause fondamentale: « l'aliéna
tion totale de chaque associé avec
tous ses droits à toute la commu
nauté».
En d'autres termes, dès
lors qu'en concluant le contrat
social les individus (les « asso
ciés ») passent de l'état de nature
à l'état social, dès lors qu'ils cons
tituent ce faisant une communauté
ou un corps politique (la républi
que), ils abandonnent volontaire
ment à cette communauté l'inté
g(alité de leur droits naturels.
Ainsi
l'Etat devient-il la seule et unique
source du droit et ne reste-t-il plus
aucun droit naturel à aucun parti
culier: tous les droits que peuvent
posséder les particuliers ne procè
dent plus que de l'autorité souve
raine de l'État, expression de la
volonté générale ; les droits des
?•
individus sont accordés à ces
mêmes individus par l'État et par
lui seul, et les particuliers en tant
que tels ne peuvent rien exiger de
ce dernier: ils n'ont aucun droit à
faire valoir contre la volonté géné
rale.
Seule la volonté générale peut
s'imposer à elle-même des limites,
mais elle ne saurait en aucun cas
être juridiquement restreinte par
aucun autre pouvoir, par aucun
autre droit, puisqu'elle est l'unique
source du pouvoir et du droit ;
comme l'écrit expressément Rous
seau : « il n'y a ni ne peut y avoir
nulle espèce de loi fondamentale
obligatoire pour le corps du peuple,
pas même le contrat social».
Dans ces conditions, il apparaît
que les droits de l'homme sont un
non-sens, dans la mesure où, con
çus comme des droits naturels ina
liénables, ils sont précisément
posés comme des limites infran
chissables au pouvoir de l'État,
donc (dans la conception rous
seauiste) de la volonté générale,
qui est celle du « corps du peuple » .
Une mystique
de la volonté
générale
Certes, dans l'esprit de Rousseau,
la volonté générale qui constitue la
seule autorité souveraine légitime
ne saurait en principe contredire
les intérêts fondamentaux de
l'homme, puisqu'elle viserait
nécessairement le bien commun et
que du fait même qu'elle est géné
rale, elle est la volonté de tous,
donc de chacun.
« La volonté générale, dira Rous
seau, est toujours droite, et tend
toujours à l'utilité publique.
» Mais,
corrige-t-il lucidement, « il ne
s'ensuit pas que les délibérations
du peuple aient toujours la même
rectitude.
» (Du contrat social, Il, 3).
Ainsi la volonté générale du peuple
peut errer, mais même dans ce cas
nul droit ne saurait jamais la con
traindre: « en tout état de cause,
un peuple est toujours le maître de
changer ses lois, même les meil
leures; car, s'il lui plaît de se faire
mal à lui-même, qui est-ce qui a
droit de l'en empêcher? » (Du
contrat social, Il, 12).
Une dissolution des droits
de l'homme
dans la volonté générale
Voyons ce que deviennent chez
Rousseau deux droits de l'homme
fondamentaux selon la Déclara
tion : la liberté et la propriété ; 1< Ce
que l'homme perd par le contrat
social, écrit Rousseau, c'est sa
liberté naturelle et un droit illimité
à tout ce qui le tente et qu'il peut
atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la
liberté civile et la propriété de tout
ce qu'il possède.
» (Du contrat
social, I, 8).
Or:
J) La liberté civile consiste seule
ment dans ce qui reste à l'individu
après la .
détermination de ses
devoirs civiques dont la loi est le
seul juge.
(Cf.
Du cqntrat soèial:
« On convient que tout ce que cha
cun aliène, par le pacte social, de
sa puissance, de ses biens, de sa
liberté, c'est seulement la partie de
tout èela dont l'usage importe à la
communauté ; mais il faut convenir
aussi que le souverain seu1 est juge
de cette importance.»)
2) La propriété· n'appartient à
l'individu qu;en vertu d'un.e con
cession de l'Etat.
En effet, > (Du contrat social, II, 2).
Contrat social
et Volonté générale
"Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force com
mune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unis
sant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant."
Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution.
« Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que
la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet; en sorte que, bien
qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les
mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social
étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits, et reprenne sa liberté
naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça.
« Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule : savoir l'aliénation
totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premiè·
rement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous; et la
condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.
« De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle
peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer : car, s'il restait quelques droits
aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût pronon
cer entre eux et le public, chacun, étant en quelque point son propre juge, pré
tendrait bientôt l'être....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓