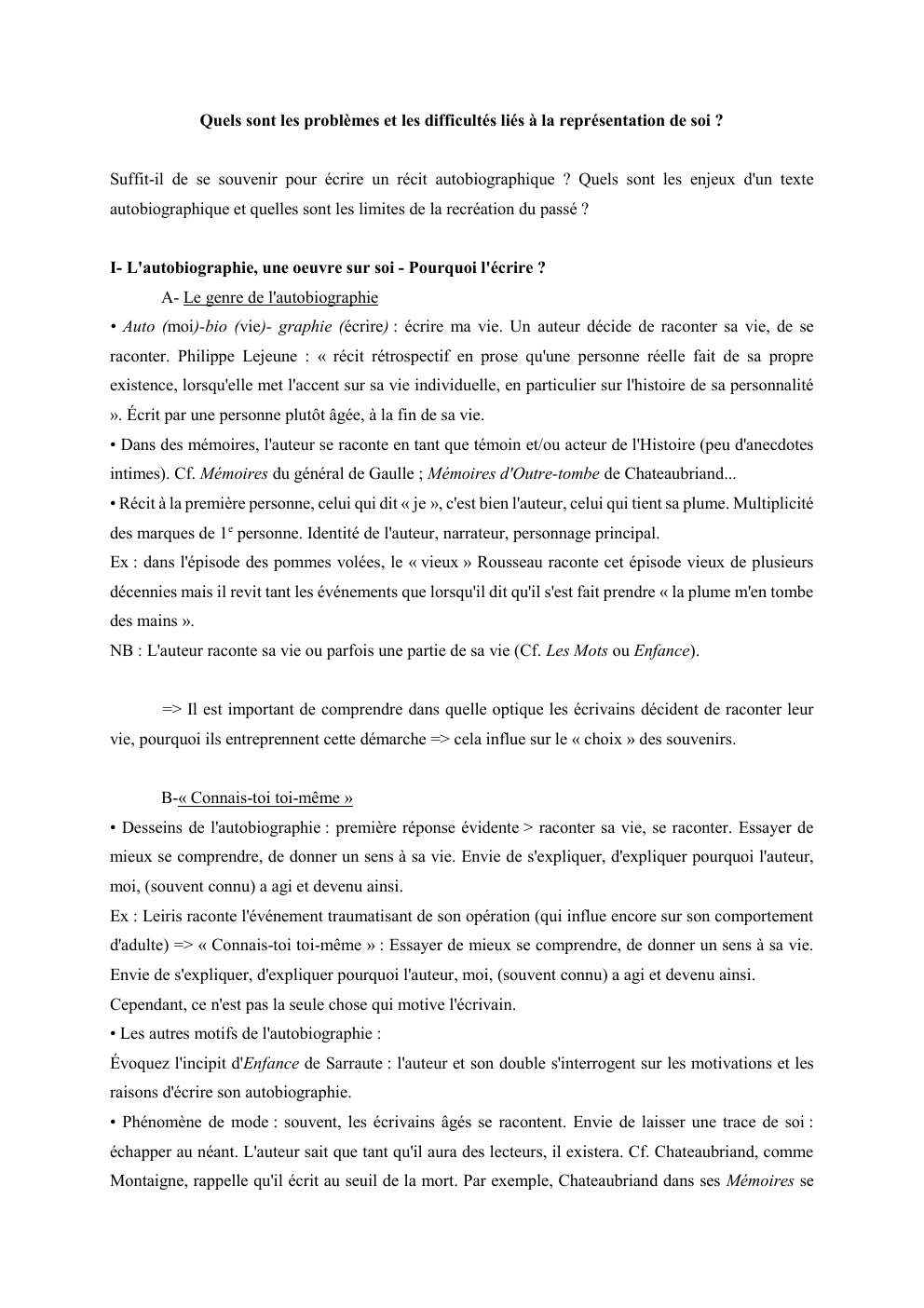Quels sont les problèmes et les difficultés liés à la représentation de soi ? Suffit-il de se souvenir pour écrire...
Extrait du document
«
Quels sont les problèmes et les difficultés liés à la représentation de soi ?
Suffit-il de se souvenir pour écrire un récit autobiographique ? Quels sont les enjeux d'un texte
autobiographique et quelles sont les limites de la recréation du passé ?
I- L'autobiographie, une oeuvre sur soi - Pourquoi l'écrire ?
A- Le genre de l'autobiographie
• Auto (moi)-bio (vie)- graphie (écrire) : écrire ma vie.
Un auteur décide de raconter sa vie, de se
raconter.
Philippe Lejeune : « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre
existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité
».
Écrit par une personne plutôt âgée, à la fin de sa vie.
• Dans des mémoires, l'auteur se raconte en tant que témoin et/ou acteur de l'Histoire (peu d'anecdotes
intimes).
Cf.
Mémoires du général de Gaulle ; Mémoires d'Outre-tombe de Chateaubriand...
• Récit à la première personne, celui qui dit « je », c'est bien l'auteur, celui qui tient sa plume.
Multiplicité
des marques de 1e personne.
Identité de l'auteur, narrateur, personnage principal.
Ex : dans l'épisode des pommes volées, le « vieux » Rousseau raconte cet épisode vieux de plusieurs
décennies mais il revit tant les événements que lorsqu'il dit qu'il s'est fait prendre « la plume m'en tombe
des mains ».
NB : L'auteur raconte sa vie ou parfois une partie de sa vie (Cf.
Les Mots ou Enfance).
=> Il est important de comprendre dans quelle optique les écrivains décident de raconter leur
vie, pourquoi ils entreprennent cette démarche => cela influe sur le « choix » des souvenirs.
B-« Connais-toi toi-même »
• Desseins de l'autobiographie : première réponse évidente > raconter sa vie, se raconter.
Essayer de
mieux se comprendre, de donner un sens à sa vie.
Envie de s'expliquer, d'expliquer pourquoi l'auteur,
moi, (souvent connu) a agi et devenu ainsi.
Ex : Leiris raconte l'événement traumatisant de son opération (qui influe encore sur son comportement
d'adulte) => « Connais-toi toi-même » : Essayer de mieux se comprendre, de donner un sens à sa vie.
Envie de s'expliquer, d'expliquer pourquoi l'auteur, moi, (souvent connu) a agi et devenu ainsi.
Cependant, ce n'est pas la seule chose qui motive l'écrivain.
• Les autres motifs de l'autobiographie :
Évoquez l'incipit d'Enfance de Sarraute : l'auteur et son double s'interrogent sur les motivations et les
raisons d'écrire son autobiographie.
• Phénomène de mode : souvent, les écrivains âgés se racontent.
Envie de laisser une trace de soi :
échapper au néant.
L'auteur sait que tant qu'il aura des lecteurs, il existera.
Cf.
Chateaubriand, comme
Montaigne, rappelle qu'il écrit au seuil de la mort.
Par exemple, Chateaubriand dans ses Mémoires se
montre le plus souvent sous son meilleur jour (vs Rousseau) – ce qui lui a été reproché par ses
contemporains, considérant ses Mémoires d'outre-tombe comme un monument qu'il s'était lui-même
construit.
C- Se justifier
• Rousseau se justifie.
Il écrit ses Confessions : on ne peut le juger qu'après l'avoir lu et ses défauts de
son caractère s'expliquent tous (effets de la société...).
• Ce sont des écrivains qui font leur autobiographie, des écrivains reconnus : il leur semble important de
parler de l'origine de leur goût pour la littérature.
Besoin de justifier, d'expliquer leur vocation.
• Les Mots : moment où Sartre est rejeté par les autres enfants au Luxembourg et qu'il se réfugie dans la
lecture.
Enfance : Sarraute rappelle tous les livres qu'elle a lus enfant (et donc sa culture livresque).
=> XXE siècle : multiplication du nombre de récits d'enfance (Sartre, Sarraute ou Perec...)
émergence du freudisme, cassures de l'histoire (guerres, exils, expatriations).
∆) L'autobiographie, permet de raconter son histoire (pour se connaître mieux, se comprendre...)
=> les souvenirs occupent une place centrale dans l'autobiographie, ils dépendent néanmoins de la raison
qui a fait que l'auteur ait décidé d'écrire sa vie (se justifier...) – si les souvenirs sont importants, il ne faut
pas oublier qu'ils sont choisis par l'auteur, lui-même écrivain et donc, capable d'influencer le récit.
II- L'écriture d'un écrit biographique
A- La sympathie du personnage
• Afin de se rendre sympathique, l'auteur, qui est maître de son récit, peut ne pas tout dire.
Ex : Chateaubriand dans Les Mémoires d'Outre-tombe ne raconte pas tout => passe sous silence certains
événements pour se rendre plus sympathique.
Par exemple, dans l'épisode où il se fait gronder par son
père, il raconte la remontrance => fait passer son père pour un méchant.
• Pour plaire au lecteur, pour qu'il achète et lise le livre, le personnage central doit avoir un intérêt et les
auteurs ont tout intérêt à le rendre sympathique.
Ex : Dans Le Livre de ma mère de Cohen => autobiographie, normalement mais en fait, récit centré sur
la maman.
Véritable éloge de la maman.
Elle est décédée : il n'évoque pas sa mort (vs Une mort si douce
de Beauvoir) mais il lui rend hommage.
Il se rappelle toutes les bonnes intentions qu'elle avait pour lui.
NB : Cohen avoue que parfois, sa mère l'irritait et il s'en veut.
Il la défend, défend sa mémoire =>
Panégyrique en l'honneur de sa mère.
La maman n'a pas de défauts et si elle en a, ils sont malgré tout
présentés comme positifs.
Il la défend, défend sa mémoire => hymne à sa mère.
B- Un personnage déplaisant
Au nom de la sincérité, gage de l'entreprise autobiographique, des auteurs ont insisté sur leurs défauts
=> Évoquez Rousseau ou Leiris.
• Rousseau avoue ses fautes : il a volé des pommes, accusé la jeune servante d'avoir volé un ruban...
• Saint-Augustin : dans l'épisode des poires, il insiste très longtemps en disant à son lecteur (et à Dieu)
qu'il a commis un acte très grave.
Et ce n'est qu'au bout de nombreuses phrases que l'on apprend qu'il
« n'a fait que » voler des poires => l'auteur insiste ici sur ses défauts.
=> Volonté de montrer, de confesser son «larcin » (qui n'est qu'un simple vol, pas un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓