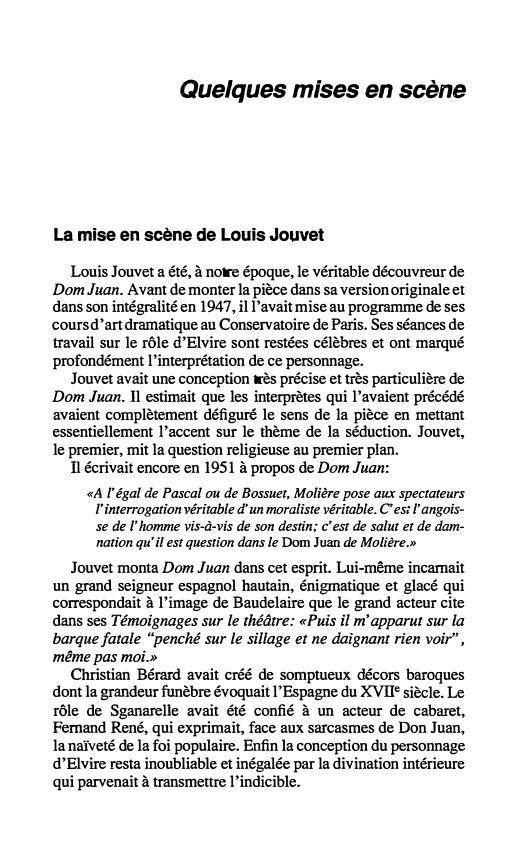Quelques mises en scène La mise en scène de Louis Jouvet Louis Jouvet a été, à notre époque, le véritable...
Extrait du document
«
Quelques mises en scène
La mise en scène de Louis Jouvet
Louis Jouvet a été, à notre époque, le véritable découvreur de
Dom Juan.
Avant de monter la pièce dans sa version originale et
dans son intégralité en 1947, il l'avait mise au programme de ses
cours d'art dramatique au Conservatoire de Paris.
Ses séances de
travail sur le rôle d'Elvire sont restées célèbres et ont marqué
profondément l'interprétation de ce personnage.
Jouvet avait une conception très précise et très particulière de
Dom Juan.
Il estimait que les interprètes qui l'avaient précédé
avaient complètement défiguré le sens de la pièce en mettant
essentiellement l'accent sur le thème de la séduction.
Jouvet,
le premier, mit la question religieuse au premier plan.
Il écrivait encore en 1951 à propos de Dom Juan:
«A l'égal de Pascal ou de Bossuet, Molière pose aux spectateurs
l'interrogation véritable d'un moraliste véritable.
C' es; l'angois
se de l'homme vis-à-vis de son destin; c'est de salut et de dam
nation qu'il est question dans le Dom Juan de Molière.
»
Jouvet monta Dom Juan dans cet esprit.
Lui-même incarnait
un grand seigneur espagnol hautain, énigmatique et glacé qui
correspondait à l'image de Baudelaire que le grand acteur cite
dans ses Témoignages sur le théâtre: «Puis il m'apparut sur la
barque fatale "penché sur le sillage et ne daignant rien voir",
même pas moi.»
Christian Bérard avait créé de somptueux décors baroques
dont la grandeur funèbre évoquait l'Espagne du xvne siècle.
Le
rôle de Sganarelle avait été confié à un acteur de cabaret,
Fernand René, qui exprimait, face aux sarcasmes de Don Juan,
la naïveté de la foi populaire.
Enfin la conception du personnage
d'Elvire resta inoubliable et inégalée par la divination intérieure
qui parvenait à transmettre l'indicible.
Ce spectacle eut deux cents représentations triomphales qui
marquèrent une époque de la vie théâtrale.
Il est certain que,
Jouvet a non seulemenfrecréé Dom Juan, il l'a, peut-on dire,
créé, car pour la première fois sans doute la pièce était révélée
dans sa profondeur métaphysique.
A travers le destin de Don
Juan, Jouvet retraçait un drame spirituel dans lequel chaque
spectateur pouvait projeter ses propres questions.
La vision que Jouvet donnait de Dom Juan était à l'opposé
- d'une lecture textuelle, littérale, épidermique.
Cette interpréta
tion a été souvent contestée.
Jacques Schérer écrit à ce propos:
«On ne saurait nier la qualité de séducteur de Don Juan, abon
damment prouvée par la pièce, au profit d'une inquiétude reli
gieuse qui est pure hypothèse, contredite au reste par l'assuran
ce constante de l'athée.
Rien dans le texte, absolument rien, ne
permet de penser que Don Juan voudrait croire en Dieu.
»
(Schérer, 27, p.
78-79)
L'approche de Dom Juan par Jouvet éclaire un paradoxe
étonnant du théâtre.
Une lecture partiale, engagée, à la limite du
contresens, devient une vérité théâtrale quand cette partialité, cet
engagement sont poussés jusqu'au bout, avec une sincérité to
tale, et sont servis par un sens profond de la scène et une maîtri
se parfaite du métier d'acteur.
C'est là toute la différence entre
les hommes de théâtre et les critiques ou les historiens.
Dans
cette confrontation, les premiers auront toujours raison, surtout
quand il s'agit de Molière.
Jouvet a très justement analysé ce processus dans les notes re
cueillies sous le titre Le Comédien désincarné, où il écrit:
« Etre possédé par une œuvre et la posséder, tel est le problème de
l'acteur, et sa liberté s'exerce entre ces deux possibles, qui sont
contradictoires.
»
Toute interprétation suppose un choix et donc l'oubli d'un
certain nombre d'éléments pour dégager une ligne jugée fonda
mentale.
C'est ainsi que procède Jouvet quand il décide de gom
mer dans Dom Juan le thème de la séduction pour se concentrer
sur le thème de l'athéisme et du combat avec Dieu.
Dans cet approfondissement et cette appropriation, il a resti
tué à l'œuvre sa véritable dimension, celle par laquelle Molière
rejoint Shakespeare.
Il a, par là même, ouvert la voie à la carriè-
re moderne de la pièce, en la mettant au premier rang des chefs
d 'œuvre du théâtre universel.
La mise en scène de Jean Vilar
La mise en scène de Jean Vilar au T.N.P., en 1953, marque
une date importante dans l'histoire de Dom Juan.
Cette interpré
tation déplaçait complètement la perspective et la problématique
dans lesquelles Jouvet avait situé la pièce.
L'Espagne baroque
de Christian Bérard faisait place à la France de Louis XIII.
Jean Vilar incarnait un héros cartésien et résolument athée qui
ne questionnait pas le Ciel, ne le défiait pas, mais l'ignorait su
perbement pour se tourner vers l'espace libre des territoires à
conquérir.
Mais le principal intérêt de ce spectacle était constitué par le
couple que formaient le maître et le valet.
Pour la première fois,
Sganarelle, admirablement joué par Daniel Sorano, apparaissait
comme le double de Don Juan.
L'article que Roland Barthes consacra à cette mise en scène,
dans la revue Théâtre populaire (n° 5, 1954), montrait l'extrême
cohérence d'une conception qui reliait le thème de la séduction
et celui de l'athéisme comme les composantes indissolubles
d'une même logique de liberté.
Analysant le jeu de Vilar, Barthes écrivait:
« •..
Un acteur peut-il €tre plus silencieux que d'autres dans le
mime r6/e? li faut bien que cela soit et qu'il y ait au théâtre un
art de la litote, puisqu'il y a une technique-et combien pratiquée
- de l'emphase.
Donc Vilar est un Don Juan silencieux, et c' est
ce silence de Vilar qui fonde l'athéisme de Don Juan, le dirige
comme un scandale au cœur du public.
»
Barthes ajoutait que:
« .•.
le silence de Vilar, c'est le silence d'un homme non qui doute,
mais qui sait.
Son Don Juan est moins privé de croyance que de
certitude, et cette certitude est silencieuse parce qu'elle se sent
justifiée,forte d'avoir posé les raisons du monde si loin de Dieu,
que le prodige lui-mime participe d'un inconnu provisoire et non
d'un mystère éternel.
»
On a compris, d'après ce beau texte, que le Don Juan de Vilar
revendiquait d'un même mouv�ment le droit à la libre pensée et
le droit au plaisir contre les illusions et les stéréotypes qui
niaient l'un et l'autre.
Et dans un élan de connivence avec les
aspirations libertaires qui sous-tendaient cette interprétation,
Barthes précisait:
«On avait beaujeu d'accuser la pièce cl'incohérence, c'est que tout
simplement on l'y mettait.
Vilar a su rétablir la poussée continue
du personnage en lui donnant une sorte de profondeur sadienne:
sa parole brève, son visage sans sourire, ses silences - admi
rables pour un art où,: emphase est le pain béni des acteurs-tout
nous impose un Don Juan privé de Dieu, non par scepticisme po
seur, mais par détermination profonde; ce Don Juan est un hom
me seul, dont chaque geste et chaque mot sont comme l'exercice
d'une liberté absolue.
Ainsi Don Juan amoureux et Don Juan
athée se fondent dans r unité cl'une même démarche, celle d'un
homme à qui il suffit defaire le mal pour connaître qu'il est irré
médiablement seul et libre.»
(Barthes, 39 p., 264-267)
Dom Juan en Russie
Le spectacle monté par Meyerhold à Moscou en 1932, au
Théâtre de la Révolution, inaugure la carrière de Dom Juan en
Russie.
Fidèle à son engagement marxiste, le grand metteur en
scène centra délibérément la pièce sur le rapport entre Don Juan
et Sganarelle, devenus les prototypes de la classe dominante et
de la classe dominée selon le schéma désormais classique de la
dialectique hégélienne du maître et de l'esclave.
Meyerhold inversait les relations entre les deux personnages,
présentés comme les emblèmes du passé et de l'avenir.
Le grand
seigneur méchant homme incarnait la noblesse décadente, bla
sée, corrompue, condamnée par l'histoire et dont le cynisme tra
hissait l'impuissance.
Sganarelle représentait la vitalité, la jovia
lité, la saveur et le bon sens du peuple appelé à occuper bientôt
le devant de la scène.
Pourtant cette interprétation n'a pas fait école.
Ses présuppo
sés idéologiques la discréditaient sans doute auprès des metteurs
en scène de l'après-guerre, plus soucieux de contester que
d'exalter le régime communiste.
C'est pourquoi l'un des hommes de théâtre les plus doués de
cette période, Anatole Efros, quand il monta à son tour un re
marquable Dom Juan, s'inspira plutôt de la leçon de Jean Vilar
dont il avait admiré le spectacle lors d'une tournée du T.N.P.
à
Moscou.
Il a raconté dans un livre de témoignages comment sa
propre conception de l' œuvre a mûri à partir de la lecture propo
sée par le metteur en scène français.
Après avoir analysé
l'influence de Vilar, il écrit:
«Don Juan, au contraire, n'accorde d'importance à rien, il vit à sa
guise.
A ·chaque pas de sa vie Molière a payé très cher pour tout: pour
son œuvre, pour son amour, pour ses attachements humains,
pour sa haine.
A Don Juan, au contraire, tout est permis.
Et
Molière voulait croire qu'il existe pourtant un jugement pour
punir des types comme Don Juan.
On dit à présent que l'on ne monte pas Dom Juan parce que cette
comédie n'est pas très drôle du point de vue des goûts d'au
jourtf hui.
On prétend que c'est une comédie démodée qui ne fait
plus rire, et c' est pour cela qu'elle est ennuyeuse.
Mais je pense,
pour mâ part, que ce n'est pas une œuvre comique.je pense que
Dom Juan n'a pas pour but de faire rire et que de toute façon la
question n'est pas là.
C'est une parabole sur un homme qui vit mal et qui parce qu'il
vit mal.finit mal, parce qu'il y a sur terre, enfin de compte une
justice, qu'on le veuille ou non![ .•.
]
Oh! comme je comprends Molière et sa haine pour des types de
ce genre! Et sa propre incapacité de se moquer de tout et tJ: ou
blier tout ce qui dérange! Mais Don Juan, rien ne le touche, car
il ne garde rien, TOUT LUI EST ÉGAL.
Et il est HABITUÉ.
Peut-être,
autrefois, il éprouvait quelques remords, quelque froissement de
conscience, mais à présent il ne ressent plus rien.
Pendant que sa femme était là et pleurait, il restait assis, renfro
gné, et quand ellefut sortie, il continua un moment à rester assis.
Et Sganarelle décida même que son maitre était ébranlé.
Mais
pas du tout, il ne faisait qu'attendre.
Et pourtant il y a des moments où Don Juan croit entendre
quelque chose, où il perçoit comme des signes de quelque chose.
Lui-même serait incapable tJ: expliquer ce que c'est.
Il est cependant une seconde à l'écoute de quelque chose et même
il se retourne, puis il rejette aussitôt loin de lui cette pensée in
truse qui ne dure qu'une seconde.
Cependant, chaque fois, cela durera un peu plus.»
Ce commentaire d'un homme de théâtre russe contemporain
sur Dom Juan est éclairant dans le mesure où il montre qu'un
grand texte est moins révélateur des idées et des intentions de
son auteur que de celles de ses interprètes.
Un grand texte de
théâtre est le fixateur des tourments pathétiques d'une âme indi
viduelle, comme c'est le cas chez Jouvet, mais aussi des plaies
d'une société, d'un régime politique, comme c'est le cas avec
Efros.
Ce dernier, vivant, au moment où il écrivait ces lignes,
sous le joug d'un pouvoir totalitaire, est avant tout sensible, dans
Dom Juan, au thème de l'humiliation, de l'arbitraire.
C'est pourquoi, à travers les règlements de compte qu'il prê
te à Molière, Efros règle ses propres comptes en reconnaissant
dans l'unposture, le cynisme et la cruauté de Don Juan l'impos
ture, le cynisme et la cruauté des parasites et des bourreaux de
son propre peuple.
Certes, la question qu'il pose n'est pas politique, elle est
beaucoup plus vaste, elle est universelle, elle est humaine, elle
concerne les attitudes différentes que l'on peut avoir devant la
vie, devant les hommes.
Mais le contexte, tant culturel que
social, dans lequel il décide de monter cette pièce, et les motiva
tions qu'il analyse ici, montrent bien que le texte, là encore, n'est
pas approché dans sa littéralité, mais qu'il est le miroir de
conflits, de débats actuels, brûlants, qui vont lui donner son
urgence, sa vérité.
La mise en scène de Marcel Bluwal
En 1965, Marcel Bluwal a mis en scène Dom Juan pour la
télévision, avec Michel Piccoli dans le rôle titre et Claude
Brasseur dans celui de Sganarelle.
Les élèves de tous les lycées ont vu en vidéo ce téléfilm
remarquable qui fixe une nouvelle image de Don Juan, une
autre potentialité que celles qui ont été abordées jusqu'ici.
Dans sa conception du héros, admirablement interprété par
Michel Piccoli, Marcel Bluwal n'insiste ni sur le séducteur, ni
sur l'athée, ni sur le noble décadent et blasé, ni sur le scélérat qui
se moque de tout et de tous et qui fait mal pour passer le temps,
il montre un homme face à l'échéance de sa propre mort, une
mort programmée, une mort qu'il a choisie.
Don Juan, botté et habillé de cuir, chevauchant sans fin dans
de vastes espaces, errant au milieu de décors grandioses, et
Sganarelle monté sur un mulet, évoquent les silhouettes de Don
Quichotte....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓