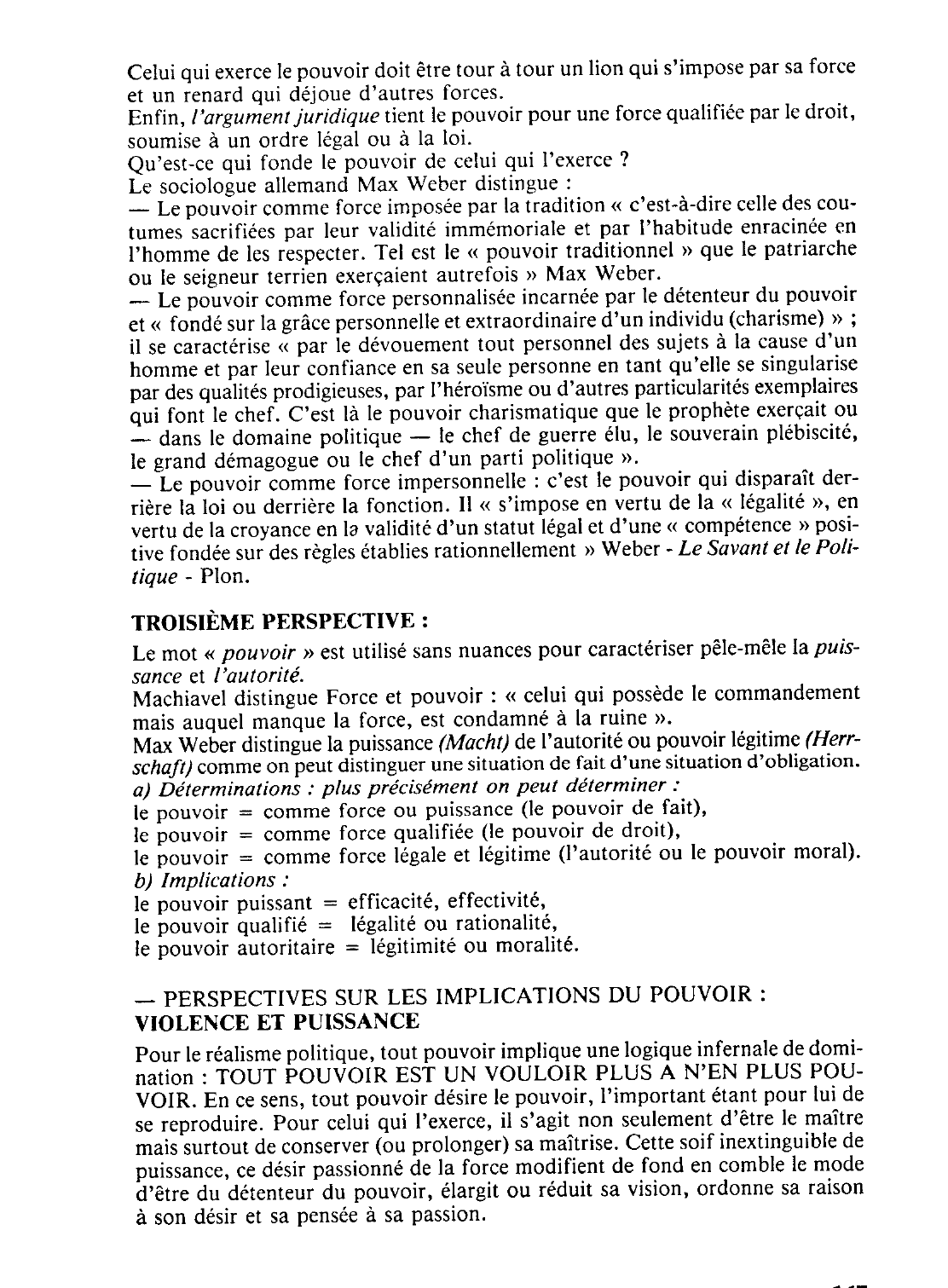POUVOIR ET PUISSANCE (cours de philosophie)
Publié le 10/07/2016
Extrait du document

Celui qui exerce la force n’est pas le plus fort. Il ne va pas jusqu’au bout de la force. Sa ruse ou son charisme ne suffisent pas à faire de sa force une force active. La force de celui qui exerce le pouvoir est toujours une force utilitaire et intéressée, force d’adaptation et de limitation. Force départagée entre l’exc�s et le compromis, prisonni�re de son désir d’accroissement et tributaire de son principe de réalité. Elle est pour autant qu’elle s’exerce sur une autre force et la domine « une force séparée de tout ce qu’elle peut, qui se nie elle-même et se retourne contre soi ».
Elle nie toute force active et affirme partout le triomphe de la réaction. Tout pouvoir « institué » ou « constitué » est réactif en ce sens. L’exercice du pouvoir est le fait de l’homme faible. Nietzsche parle d’un « rang immuable et inné dans la hiérarchie ». Autrement dit, le faible qui exerce le pouvoir ne change pas sa qualité d’être même s’il augmente sa quantité de force. L’avoir n’a aucune incidence sur l’être. Le réactif du pouvoir demeure réactif. L’actif sans le pouvoir demeure actif : alors que l’actif n’a nul besoin d’exercer le pouvoir pour être puissant, le réactif cherche invariablement les instruments de domination pour un semblant de puissance. L’actif r�gne sans gouverner. Le réactif gouverne sans régner. Ce sont donc les impuissants qui déterminent la réalité du pouvoir. C’est le devenir réactif de la force qui en décide ainsi. Et toute l’histoire « ce pêle-mêle d’ordures » n’est rien moins que le triomphe de ces forces réactives. Plus précisément, l’exercice du pouvoir ne change pas l’être de celui qui l’exerce, il n’a aucune incidence ontologique mais exclusivement une incidence psychologique ou une incidence morale et politique.
POUVOIR ET PUISSANCE
Perspectives sur le sens du pouvoir :
PREMIÈRE PERSPECTIVE :
Qu’est-ce que le pouvoir ?
Nul ne peut éluder, et pas plus à propos du pouvoir que de toute autre chose, l’interrogation philosophique sur le sens. Car s’il peut être vrai (il faudrait l’établir) que la recherche métaphysique d’une essence universelle et éternelle du pouvoir, et donc d’une valeur en soi du pouvoir, soit une recherche mystifiée ou vouée à l’échec, cela ne ruine pas mais au contraire impose une recherche « des sens » multiples du pouvoir ; recherche proprement philosophique que Nietzsche, par exemple, proposait de substituer partout à la quête métaphysique de l’essence. En général : le pouvoir est la capacité effective de faire quelque chose.
Au sens abstrait : c’est la faculté de commander et d’exiger quelque chose sous peine de sanction. Pouvoir = pression et répression.
Au sens concret : le pouvoir est identifié au détenteur de l’autorité. En guise d’une délimitation inspirée par Machiavel, on peut dire que le pouvoir est l’art et la mani�re d’imposer sa volonté aux autres, en profitant si c’est nécessaire de leur faiblesse ou en triomphant si c’est possible de leur résistance.
DEUXIÈME PERSPECTIVE :
Sur quoi repose le pouvoir ? Qu’est-ce qui le rend possible ?
L’argument de la force est nécessaire mais non suffisant pour comprendre le pouvoir. Rousseau a démystifié le prétendu « droit du plus fort » en mettant en évidence la contradiction interne d’une telle prétention : « le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir ».
En effet, la force est toujours « étayée par des capacités ». A l’argument de la force, il faut rajouter l’argument de la compétence, celle qui définit, par exemple, le pouvoir politique de la technocratie : « c’est un régime politique dans lequel la couche sociale dominante et dirigeante, celle qui détient le pouvoir effectif de décision et de commandement au niveau de la société globale, est celle qui poss�de le privil�ge de la compétence dans les techniques les plus modernes de la production et de gestion » (J-W. Lapierre - Le pouvoir politique - P.U.F.). Ou encore l’argument traditionnel de la science ou sagesse : pour Socrate par exemple, la force doit être complétée par la sagesse. Mais comme dit Napoléon, « la force dévore la pensée » et les hommes ne sont pas toujours capables d’entendre raison ou d’entrevoir le vrai. Afin de les inciter à obéir, il est moins nécessaire d’agir sur leur intelligence ou de s’adresser à leur bon sens que de savoir comment agir sur leur cœur ou leur imagination. Ceci nous conduit aupr�s de Machiavel, qui estime à son tour que la puissance sans la ruse est condamnée à l’impuissance tout comme la ruse sans la puissance est condamnée à la ruine.

«
Celui qui exerce le pouvoir doit être tour à tour un lion qui s'impose par sa force
et un renard qui déjoue
d'autres forces.
Enfin,
l'argument juridique tient le pouvoir pour une force qualifiée par le droit,
soumise à
un ordre légal ou à la loi.
Qu'est-ce qui fonde le pouvoir de celui qui l'exerce ?
Le sociologue allemand Max Weber distingue :
- Le pouvoir comme force imposée
par la tradition« c'est-à-dire celle des cou
tumes sacrifiées
par leur validité immémoriale et par l'habitude enracinée en
l'homme de les respecter.
Tel est le « pouvoir traditionnel » que le patriarche
ou le seigneur terrien exerçaient autrefois » Max Weber.
- Le pouvoir comme force personnalisée incarnée par le détenteur du pouvoir
et« fondé sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu (charisme) » ;
il se caractérise
« par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d'un
homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu'elle se singularise
par des qualités prodigieuses, par l'héroïsme ou d'autres particularités exemplaires
qui font
le chef.
C'est là le pouvoir charismatique que le prophète exerçait ou
-dans le domaine politique - le chef de guerre élu, le souverain plébiscité,
le grand démagogue
ou le chef d'un parti politique ».
-Le pouvoir comme force impersonnelle : c'est le pouvoir qui disparaît der
rière la loi
ou derrière la fonction.
Il « s'impose en vertu de la « légalité », en
vertu de la croyance en
le1 validité d'un statut légal et d'une« compétence» posi
tive fondée sur des règles établies rationnellement
»Weber- Le Savant et le Poli
tique -Plon.
TROISIÈME PERSPECTIVE :
Le mot « pouvoir » est utilisé sans nuances pour caractériser pêle-mêle la puis
sance
et l'autorité.
Machiavel distingue Force et pouvoir : « celui qui possède le commandement
mais auquel manque
la force, est condamné à la ruine ».
Max Weber distingue la puissance (Macht) de l'autorité ou pouvoir légitime (Herr
schaft)
comme on peut distinguer une situation de fait d'une situation d'obligation.
a) Déterminations : plus précisément on peut déterminer : le pouvoir comme force ou puissance (le pouvoir de fait),
le pouvoir
= comme force qualifiée (le pouvoir de droit),
le pouvoir = comme force légale et légitime (l'autorité ou le pouvoir moral).
b) Implications : le pouvoir puissant = efficacité, effectivité,
le pouvoir qualifié = légalité ou rationalité,
le pouvoir autoritaire
= légitimité ou moralité.
-
PERSPECTIVES SUR LES IMPLICATIONS DU POUVOIR :
VIOLENCE ET PUISSANCE
Pour le réalisme politique, tout pouvoir implique une logique infernale de domi
nation :
TOUT POUVOIR EST UN VOULOIR PLUS A N'EN PLUS POU
VOIR.
En ce sens, tout pouvoir désire le pouvoir, l'important étant pour lui de
se reproduire.
Pour celui qui l'exerce, il s'agit non seulement d'être le maître
mais surtout de conserver (ou prolonger)
sa maîtrise.
Cette soif inextinguible de
puissance, ce désir passionné de
la force modifient de fond en comble le mode
d'être du détenteur du pouvoir, élargit ou réduit sa vision, ordonne sa raison
à son désir et sa pensée à
sa passion..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LE POUVOIR (cours de philosophie)
- cours philosophie travail et technique
- Résumé de cours de philosophie: comment réussir en philosophie ?
- COURS DE PHILOSOPHIE POSITIVE Auguste Comte (résumé & analyse)
- COURS DE PHILOSOPHIE POSITIVE. (résumé & analyse)