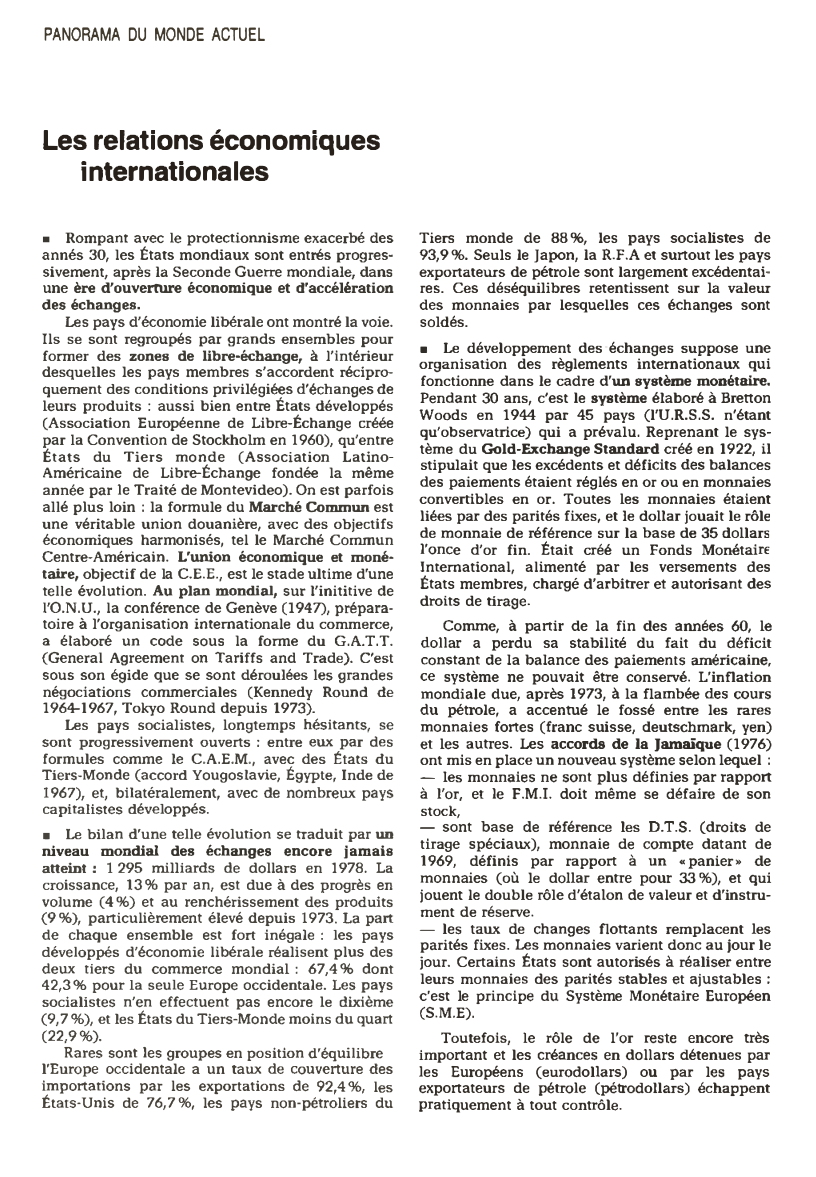PANORAMA DU MONDE ACTUEL Les relations économiques internationales ■ Rompant avec le protectionnisme exacerbé des annés 30, les États mondiaux...
Extrait du document
«
PANORAMA DU MONDE ACTUEL
Les relations économiques
internationales
■ Rompant avec le protectionnisme exacerbé des
annés 30, les États mondiaux sont entrés progres
sivement, après la Seconde Guerre mondiale, dans
une ère d'ouverture économique et d'accélération
des échanges.
Les pays d'économie libérale ont montré la voie.
Ils se sont regroupés par grands ensembles pour
former des zones de libre-échange, à l'intérieur
desquelles les pays membres s'accordent récipro
quement des conditions privilégiées d'échanges de
leurs produits : aussi bien entre États développés
(Association Européenne de Libre-Échange créée
par la Convention de Stockholm en 1960), qu'entre
États du Tiers monde (Association Latino
Américaine de Libre-Échange fondée la même
année par le Traité de Montevideo).
On est parfois
allé plus loin : la formule du Marché Commun est
une véritable un.ion douanière, avec des objectifs
économiques harmonisés, tel le Marché Commun
Centre-Américain.
L'union économique et moné
taire, objectif de la C.E.E., est le stade ultime d'une
telle évolution.
Au plan mondial, sur l'inititive de
l'O.N.U., la conférence de Genève (1947), prépara
toire à l'organisation internationale du commerce,
a élaboré un code sous la forme du G.A.T.T.
(General Agreement on Tariffs and Trade).
C'est
sous son égide que se sont déroulées les grandes
négociations commerciales (Kennedy Round de
1964-1967, Tokyo Round depuis 1973).
Les pays socialistes, longtemps hésitants, se
sont progressivement ouverts : entre eux par des
formules comme le C.A.E.M., avec des États du
Tiers-Monde (accord Yougoslavie, Égypte, Inde de
1967), et, bilatéralement, avec de nombreux pays
capitalistes développés.
■ Le bilan d'une telle évolution se traduit par un
niveau mondial des échanges encore jamais
atteint : 1 295 milliards de dollars en 1978.
La
croissance, 13 % par an, est due à des progrès en
volume (4%) et au renchérissement des produits
(9 %), particulièrement élevé depuis 1973.
La part
de chaque ensemble est fort inégale : les pays
développés d'économie libérale réalisent plus des
deux tiers du commerce mondial : 67,4 % dont
42,3 % pour la seule Europe occidentale.
Les pays
socialistes n'en effectuent pas encore le dixième
(9, 7 %), et les États du Tiers-Monde moins du quart
(22,9%).
Rares sont les groupes en position d'équilibre
l'Europe occidentale a un taux de couverture des
importations par les exportations de 92,4 %, les
États-Unis de 76, 7 %, les pays non-pétroliers du
Tiers monde de 88 %, les pays socialistes de
93,9%.
Seuls le Japon, la R.F.A et surtout les pays
exportateurs de pétrole sont largement excédentai
res.
Ces déséquilibres retentissent sur la valeur
des monnaies par lesquelles ces échanges sont
soldés.
■ Le développement des -échanges suppose une
organisation des règlements internationaux qui
fonctionne dans le cadre d'un système monétaire.
Pendant 30 ans, c'est le système élaboré à Bretton
Woods en 1944 par 45 pays (l'U.R.S.S.
n'étant
qu'observatrice) qui a prévalu.
Reprenant le sys
tème du Gold-Excbange Standard créé en 1922, il
stipulait que les excédents et déficits des balances
des paiements étaient réglés en or ou en monnaies
convertibles en or.
Toutes les monnaies étaient
liées par des parités fixes, et le dollar jouait le rôle
de monnaie de référence sur la base de 35 dollars
l'once d'or fin.
Était créé un Fonds Monétaire
International, alimenté par les versements des
États membres, chargé d'arbitrer et autorisant des
droits de tirage.
Comme, à partir de la fin des années 60, le
dollar a perdu sa stabilité du fait du déficit
constant de la balance des paiements américaine,
ce système ne pouvait être conservé.
L'inflation
mondiale due, après 1973, à la flambée des cours
du pétrole, a accentué le fossé entre les rares
monnaies fortes (franc suisse, deutschmark, yen)
et les autres.
Les accords de la Jamaïque (1976)
ont mis en place un nouveau système selon lequel :
- les monnaies ne sont plus définies par rapport
à l'or, et le F.M.I.
doit même se défaire de son
stock,
- sont base de référence les D.T.S.
(droits de
tirage spéciaux), monnaie de compte datant de
1969, définis par rapport à un «panier» de
monnaies (où le dollar entre pour 33 %), et qui
jouent le double rôle d'étalon de valeur et d'instru
ment de réserve.
- les taux de changes flottants remplacent les
parités fixes.
Les monnaies varient donc au jour le
jour.
Certains États sont autorisés à réaliser entre
leurs monnaies des parités stables et ajustables :
c'est le principe du Système Monétaire Européen
(S.M.E).
Toutefois, le rôle de l'or reste encore très
important et les créances en dollars détenues par
les Européens (eurodollars) ou par les pays
exportateurs de pétrole (pétrodollars) échappent
pratiquement à tout contrôle.
Les grands courants....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓