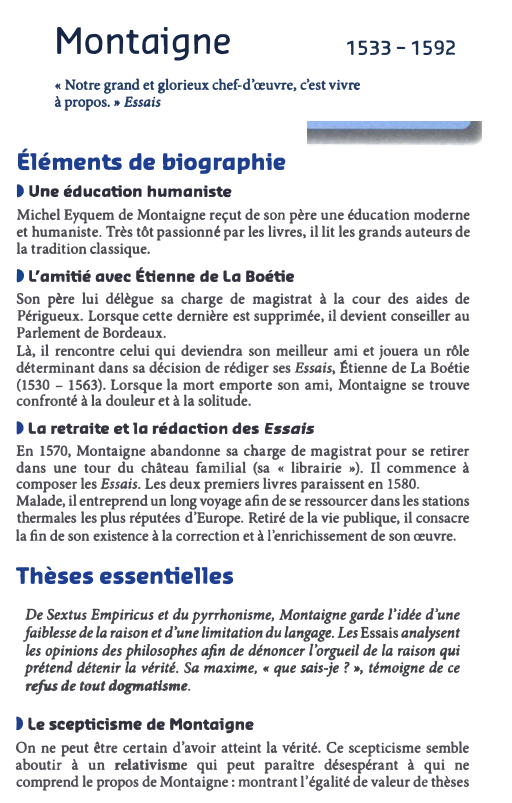Montaigne 1533-1592 « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. » Essais Éléments de biographie t Une éducation...
Extrait du document
«
Montaigne
1533-1592
« Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre
à propos.
» Essais
Éléments de biographie
t Une éducation humaniste
Michel Eyquem de Montaigne reçut de son père une éducation moderne
et humaniste.
Très tôt passionné par les livres, il lit les grands auteurs de
la tradition classique.
t l'amitié auec Étienne de la Boétie
Son père lui délègue sa charge de magistrat à la cour des aides de
Périgueux.
Lorsque cette dernière est supprimée, il devient conseiller au
Parlement de Bordeaux.
Là, il rencontre celui qui deviendra son meilleur ami et jouera un rôle
déterminant dans sa décision de rédiger ses Essais, :Étienne de La Boétie
(1530 - 1563).
Lorsque la mort emporte son ami, Montaigne se trouve
confronté à la douleur et à la solitude.
t la retraite et la rédaction des
Essais
En 1570, Montaigne abandonne sa charge de magistrat pour se retirer
dans une tour du château familial (sa « librairie »).
Il commence à
composer les Essais.
Les deux premiers livres paraissent en 1580.
Malade, il entreprend un long voyage afin de se ressourcer dans les stations
thermales les plus réputées d'Europe.
Retiré de la vie publique, il consacre
la fin de son existence à la correction et à l'enrichissement de son œuvre.
Thèses essentielles
De Sextus Empiricus et du pyrrhonisme, Montaigne garde l'idée d'une
faibksse de la raison et d'une limitation du langage.
Les Essais analysent
les opinions des philosophes afin de dénoncer l'orgueil de la raison qui
prétend détenir la vérité.
Sa maxime, « que sais-je ? », témoigne de ce
refus de tout dogmatisme.
t le scepticisme de Montaigne
On ne peut être certain d'avoir atteint la vérité.
Ce scepticisme semble
aboutir à un relativisme qui peut paraître désespérant à qui ne
comprend le propos de Montaigne : montrant l'égalité de valeur de thèses
contradictoires, les Essais nous laissent dans l'incertitude d'un moi qui
se cherche et avoue ne pouvoir s'extraire de sa subjectivité.
Montaigne
ne construit pas un système doctrinal, mais une pensée active qui n'a
de cesse de se réinterroger, comme en attestent les multiples ajouts et
corrections au manuscrit originel.
Le titre lui-même, Essais, suggère une
pensée qui s'essaie, se juge et se rectifie continuellement.
Par sa critique du dogmatisme et du fanatisme, Montaigne vise un
usage raisonnable de la raison qui s'accorde à la vraie vie de l' homme
moyen.
Loin de toute prétention démesurée, la raison débarrasse des
illusions et procure une vie heureuse et simple en appelant à la tolérance
et à l'indulgence.
t la subjectivité et le mot
Les Essais avertissent le lecteur: « c'est moi que je peins ».
L'ouvrage n'est
cependant pas une autobiographie, il y est aussi question de problèmes
indépendants de la personnalité de Montaigne.
Mais il s'agit bien de
subjectivité: refusant d'affirmer une doctrine, Montaigne enseigne qu'il
n'y a pas d'objectivité, que tout savoir est celui d'un sujet.
Montaigne partage l'exigence socratique : se connaître soi-même.
L'exercice constant de l'intelligence, qui se regarde et s'interroge, est la vie
même de la pensée et se constitue dans cette quête de soi-même toujours
à renouveler : le moi, se saisissant dans le devenir temporel, s'échappe
constamment, si bien que « se trouve autant de différence de nous à nous
mêmes que de nous à autrui ».
Si « chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition », ce n'est
que subjectivement : seul l'individu existe, avec toute ses particularités.
Nominaliste, Montaigne....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓