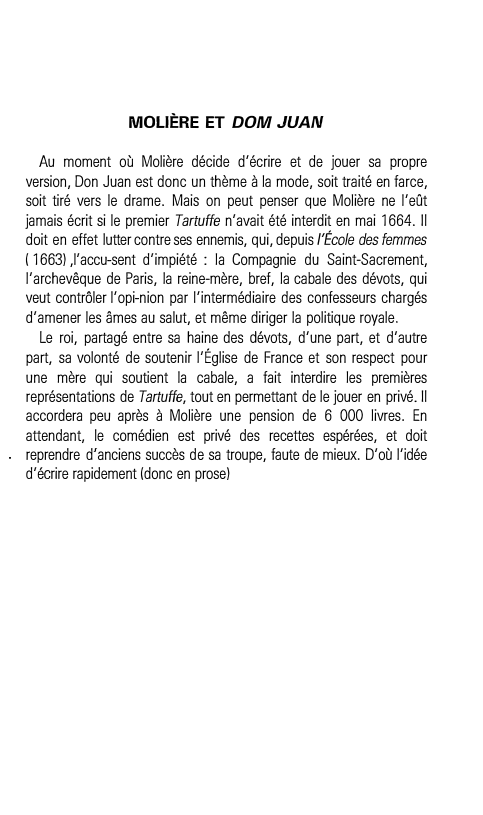MOLIÈRE ET DOM JUAN Au moment où Molière décide d'écrire et de jouer sa propre version, Don Juan est donc...
Extrait du document
«
MOLIÈRE ET DOM JUAN
Au moment où Molière décide d'écrire et de jouer sa propre
version, Don Juan est donc un thème à la mode, soit traité en farce,
soit tiré vers le drame.
Mais on peut penser que Molière ne l'eût
jamais écrit si le premier Tartuffe n'avait été interdit en mai 1664.
Il
doit en effet lutter contre ses ennemis, qui, depuis /'École des femmes
( 1663) ,l'accusent d'impiété : la Compagnie du Saint-Sacrement,
l'archevêque de Paris, la reine-mère, bref, la cabale des dévots, qui
veut contrôler l'opinion par l'intermédiaire des confesseurs chargés
d'amener les âmes au salut, et même diriger la politique royale.
Le roi, partagé entre sa haine des dévots, d'une part, et d'autre
part, sa volonté de soutenir l'Église de France et son respect pour
une mère qui soutient la cabale, a fait interdire les premières
représentations de Tartuffe, tout en permettant de le jouer en privé.
Il
accordera peu après à Molière une pension de 6 000 livres.
En
attendant, le comédien est privé des recettes espérées, et doit
reprendre d'anciens succès de sa troupe, faute de mieux.
D'où l'idée
d'écrire rapidement (donc en prose)
sur un sujet à la mode, qui lui permette d'approfondir, sous le masque
de Don Juan, les termes de son conflit avec ses ennemis.
Le 3 décembre
1664, il signe avec deux peintres le marché des décors (un par acte),
et le 15 février 1665 la pièce est créée au Palais-Royal avec un succès
considérable.
Malheureusement, comme le premier Tartuffe, elle doit
s'arrêter subitement le 20 mars : Molière cède à l'opposition furieuse
d'une partie de l'opinion, qui déchaîne une série de pam
phlets dans les deux sens, et empêche désormais de jouer la pièce dans
le texte original, situation qui va durer jusqu'en ...
1841 ! D'ailleurs,
dès la deuxième représentation, Molière doit couper des répliques, ou
même des scènes entières (la scène du pauvre, Ill, 2), et sa pièce ne
sera imprimée, avec des mutilations dans la plupart des exemplaires,
qu'après sa mort, en 1682.
La pièce n'est connue, dès lors, que par une version édulcorée, en
vers, de Thomas Corneille, le frère de Pierre, autorisée par la veuve
de Molière à partir de 1677.
Reprise dans le texte original en 1841,
l'œuvre a été jouée régulièrement par la Comédie-Française, mais n'a
pris l'importance qu'on lui reconnaît aujourd'hui qu'avec la mise en
scène de Louis Jouvet (1947) et, surtout, celle de Jean Vilar (1953).
Depuis, les Dom Juan les plus marquants ont été ceux de Patrice
Chéreau (1969), d'Antoine Vitez (1978) et de Roger Planchon (1980).
Dom Juan et le libertinage
Pour les modernes, le libertinage, depuis le XVIII• siècle, évoque la
« licence des mœurs», la recherche effrénée du plaisir.
Pour les con
temporains de Molière, il s'agissait de licence, certes, mais« en matière
de foi, de discipline, de morale religieuse» (Petit Robert).
Autrement
dit, c'était la liberté de l'esprit plutôt que celle du corps qui était en
jeu, même si la première induisait facilement la seconde.
En quoi le
Dom Juan pouvait-il choquer l'opinion ? On a vu la lutte de Molière
contre la fausse dévotion, considérée comme un moyen de parvenir,
et son corollaire, l'hypocrisie.
Don Juan sacrifie, in extremis, au« vice
à la mode», afin de mieux cacher sa vie privée (V, 2).
Mais le reste
de la pièce montre le libertin au grand jour : il ne croit qu'en « deux
et deux sont quatre », se moque des superstitions incarnées par
Sganarelle, ne considère la foi que comme un moyen d'être tranquille,
méprise le mariage, la parole donnée, la croyance d'autrui, l'autorité.
En cela il appartient à une tradition minoritaire et souterraine du Grand
Siècle, à la fois mouvement philosophique inspiré du matérialisme
antique d'Épicure - représenté au XVII• siècle par Gassendi, Vanini,
Théophile de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓