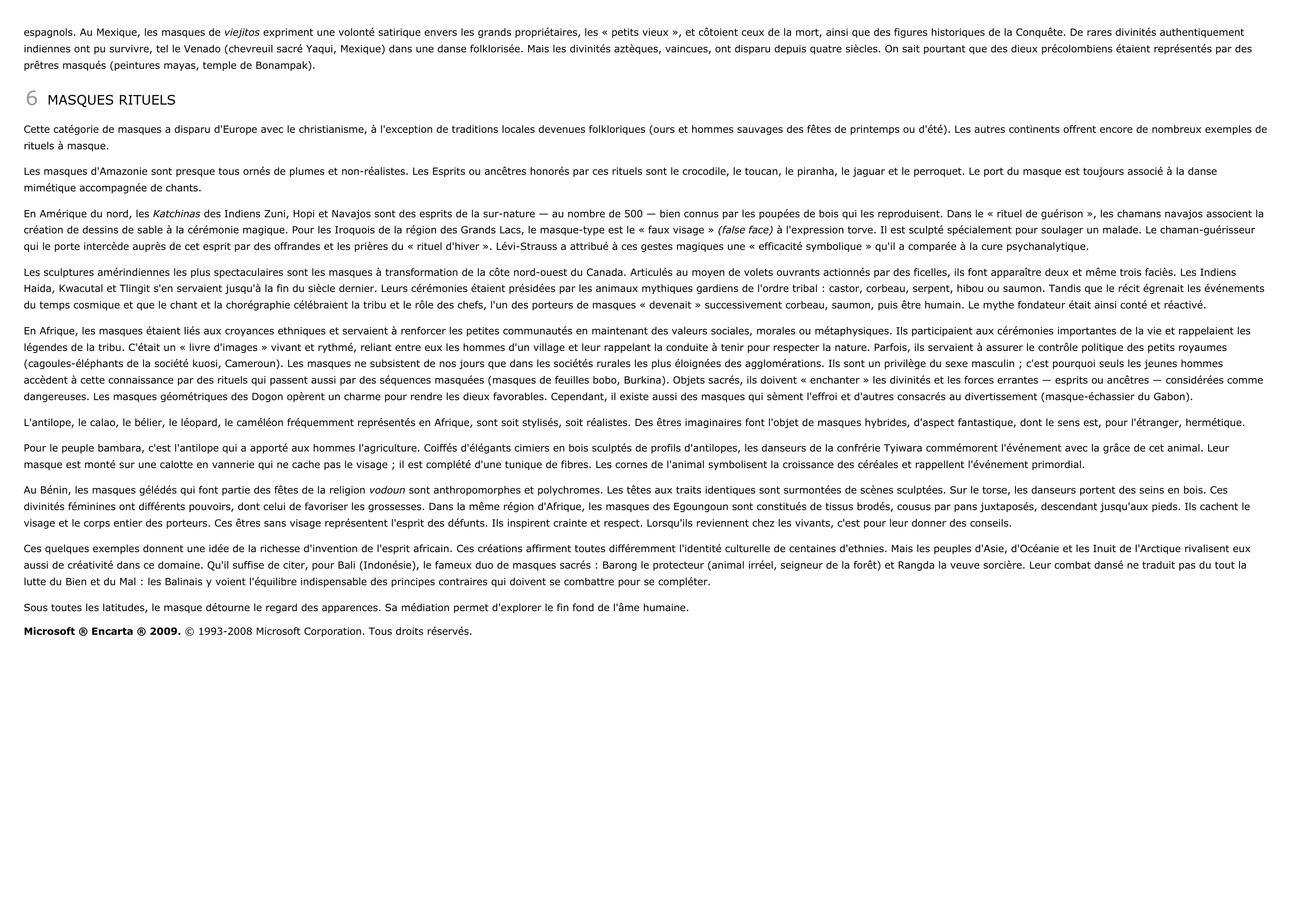masque - anthropologie.
Publié le 19/05/2013
Extrait du document
«
espagnols.
Au Mexique, les masques de viejitos expriment une volonté satirique envers les grands propriétaires, les « petits vieux », et côtoient ceux de la mort, ainsi que des figures historiques de la Conquête.
De rares divinités authentiquement
indiennes ont pu survivre, tel le Venado (chevreuil sacré Yaqui, Mexique) dans une danse folklorisée.
Mais les divinités aztèques, vaincues, ont disparu depuis quatre siècles.
On sait pourtant que des dieux précolombiens étaient représentés par des
prêtres masqués (peintures mayas, temple de Bonampak).
6 MASQUES RITUELS
Cette catégorie de masques a disparu d'Europe avec le christianisme, à l'exception de traditions locales devenues folkloriques (ours et hommes sauvages des fêtes de printemps ou d'été).
Les autres continents offrent encore de nombreux exemples de
rituels à masque.
Les masques d'Amazonie sont presque tous ornés de plumes et non-réalistes.
Les Esprits ou ancêtres honorés par ces rituels sont le crocodile, le toucan, le piranha, le jaguar et le perroquet.
Le port du masque est toujours associé à la danse
mimétique accompagnée de chants.
En Amérique du nord, les Katchinas des Indiens Zuni, Hopi et Navajos sont des esprits de la sur-nature — au nombre de 500 — bien connus par les poupées de bois qui les reproduisent.
Dans le « rituel de guérison », les chamans navajos associent la
création de dessins de sable à la cérémonie magique.
Pour les Iroquois de la région des Grands Lacs, le masque-type est le « faux visage » (false face) à l'expression torve.
Il est sculpté spécialement pour soulager un malade.
Le chaman-guérisseur
qui le porte intercède auprès de cet esprit par des offrandes et les prières du « rituel d'hiver ».
Lévi-Strauss a attribué à ces gestes magiques une « efficacité symbolique » qu'il a comparée à la cure psychanalytique.
Les sculptures amérindiennes les plus spectaculaires sont les masques à transformation de la côte nord-ouest du Canada.
Articulés au moyen de volets ouvrants actionnés par des ficelles, ils font apparaître deux et même trois faciès.
Les Indiens
Haida, Kwacutal et Tlingit s'en servaient jusqu'à la fin du siècle dernier.
Leurs cérémonies étaient présidées par les animaux mythiques gardiens de l'ordre tribal : castor, corbeau, serpent, hibou ou saumon.
Tandis que le récit égrenait les événements
du temps cosmique et que le chant et la chorégraphie célébraient la tribu et le rôle des chefs, l'un des porteurs de masques « devenait » successivement corbeau, saumon, puis être humain.
Le mythe fondateur était ainsi conté et réactivé.
En Afrique, les masques étaient liés aux croyances ethniques et servaient à renforcer les petites communautés en maintenant des valeurs sociales, morales ou métaphysiques.
Ils participaient aux cérémonies importantes de la vie et rappelaient les
légendes de la tribu.
C'était un « livre d'images » vivant et rythmé, reliant entre eux les hommes d'un village et leur rappelant la conduite à tenir pour respecter la nature.
Parfois, ils servaient à assurer le contrôle politique des petits royaumes
(cagoules-éléphants de la société kuosi, Cameroun).
Les masques ne subsistent de nos jours que dans les sociétés rurales les plus éloignées des agglomérations.
Ils sont un privilège du sexe masculin ; c'est pourquoi seuls les jeunes hommes
accèdent à cette connaissance par des rituels qui passent aussi par des séquences masquées (masques de feuilles bobo, Burkina).
Objets sacrés, ils doivent « enchanter » les divinités et les forces errantes — esprits ou ancêtres — considérées comme
dangereuses.
Les masques géométriques des Dogon opèrent un charme pour rendre les dieux favorables.
Cependant, il existe aussi des masques qui sèment l'effroi et d'autres consacrés au divertissement (masque-échassier du Gabon).
L'antilope, le calao, le bélier, le léopard, le caméléon fréquemment représentés en Afrique, sont soit stylisés, soit réalistes.
Des êtres imaginaires font l'objet de masques hybrides, d'aspect fantastique, dont le sens est, pour l'étranger, hermétique.
Pour le peuple bambara, c'est l'antilope qui a apporté aux hommes l'agriculture.
Coiffés d'élégants cimiers en bois sculptés de profils d'antilopes, les danseurs de la confrérie Tyiwara commémorent l'événement avec la grâce de cet animal.
Leur
masque est monté sur une calotte en vannerie qui ne cache pas le visage ; il est complété d'une tunique de fibres.
Les cornes de l'animal symbolisent la croissance des céréales et rappellent l'événement primordial.
Au Bénin, les masques gélédés qui font partie des fêtes de la religion vodoun sont anthropomorphes et polychromes.
Les têtes aux traits identiques sont surmontées de scènes sculptées.
Sur le torse, les danseurs portent des seins en bois.
Ces
divinités féminines ont différents pouvoirs, dont celui de favoriser les grossesses.
Dans la même région d'Afrique, les masques des Egoungoun sont constitués de tissus brodés, cousus par pans juxtaposés, descendant jusqu'aux pieds.
Ils cachent le
visage et le corps entier des porteurs.
Ces êtres sans visage représentent l'esprit des défunts.
Ils inspirent crainte et respect.
Lorsqu'ils reviennent chez les vivants, c'est pour leur donner des conseils.
Ces quelques exemples donnent une idée de la richesse d'invention de l'esprit africain.
Ces créations affirment toutes différemment l'identité culturelle de centaines d'ethnies.
Mais les peuples d'Asie, d'Océanie et les Inuit de l'Arctique rivalisent eux
aussi de créativité dans ce domaine.
Qu'il suffise de citer, pour Bali (Indonésie), le fameux duo de masques sacrés : Barong le protecteur (animal irréel, seigneur de la forêt) et Rangda la veuve sorcière.
Leur combat dansé ne traduit pas du tout la
lutte du Bien et du Mal : les Balinais y voient l'équilibre indispensable des principes contraires qui doivent se combattre pour se compléter.
Sous toutes les latitudes, le masque détourne le regard des apparences.
Sa médiation permet d'explorer le fin fond de l'âme humaine.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Anthropologie de l'habitat
- De l'anthropologie structurale au structuralisme
- ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE. THEME : LE MOUVEMENT ALMORAVIDE ENTRE ECONOMIE ET RELIGION.
- UE 1.1. S1 Psychologie, sociologie, anthropologie Les grands domaines de la psychologie
- ANTHROPOLOGIE DU POINT DE VUE PRAGMATIQUE, Emmanuel Kant