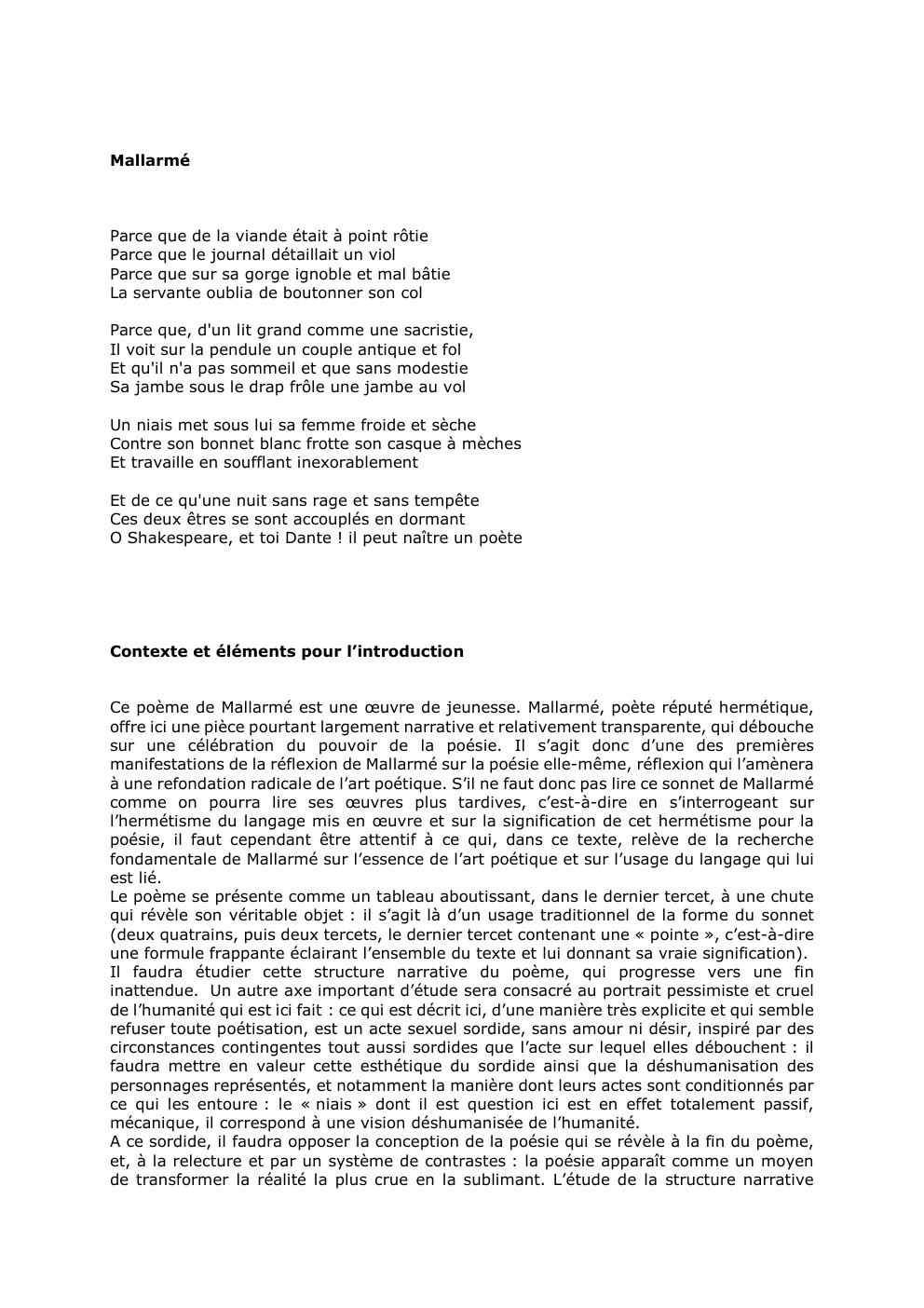Mallarmé Parce que de la viande était à point rôtie Parce que le journal détaillait un viol Parce que sur...
Extrait du document
«
Mallarmé
Parce que de la viande était à point rôtie
Parce que le journal détaillait un viol
Parce que sur sa gorge ignoble et mal bâtie
La servante oublia de boutonner son col
Parce que, d'un lit grand comme une sacristie,
Il voit sur la pendule un couple antique et fol
Et qu'il n'a pas sommeil et que sans modestie
Sa jambe sous le drap frôle une jambe au vol
Un niais met sous lui sa femme froide et sèche
Contre son bonnet blanc frotte son casque à mèches
Et travaille en soufflant inexorablement
Et de ce qu'une nuit sans rage et sans tempête
Ces deux êtres se sont accouplés en dormant
O Shakespeare, et toi Dante ! il peut naître un poète
Contexte et éléments pour l’introduction
Ce poème de Mallarmé est une œuvre de jeunesse.
Mallarmé, poète réputé hermétique,
offre ici une pièce pourtant largement narrative et relativement transparente, qui débouche
sur une célébration du pouvoir de la poésie.
Il s’agit donc d’une des premières
manifestations de la réflexion de Mallarmé sur la poésie elle-même, réflexion qui l’amènera
à une refondation radicale de l’art poétique.
S’il ne faut donc pas lire ce sonnet de Mallarmé
comme on pourra lire ses œuvres plus tardives, c’est-à-dire en s’interrogeant sur
l’hermétisme du langage mis en œuvre et sur la signification de cet hermétisme pour la
poésie, il faut cependant être attentif à ce qui, dans ce texte, relève de la recherche
fondamentale de Mallarmé sur l’essence de l’art poétique et sur l’usage du langage qui lui
est lié.
Le poème se présente comme un tableau aboutissant, dans le dernier tercet, à une chute
qui révèle son véritable objet : il s’agit là d’un usage traditionnel de la forme du sonnet
(deux quatrains, puis deux tercets, le dernier tercet contenant une « pointe », c’est-à-dire
une formule frappante éclairant l’ensemble du texte et lui donnant sa vraie signification).
Il faudra étudier cette structure narrative du poème, qui progresse vers une fin
inattendue.
Un autre axe important d’étude sera consacré au portrait pessimiste et cruel
de l’humanité qui est ici fait : ce qui est décrit ici, d’une manière très explicite et qui semble
refuser toute poétisation, est un acte sexuel sordide, sans amour ni désir, inspiré par des
circonstances contingentes tout aussi sordides que l’acte sur lequel elles débouchent : il
faudra mettre en valeur cette esthétique du sordide ainsi que la déshumanisation des
personnages représentés, et notamment la manière dont leurs actes sont conditionnés par
ce qui les entoure : le « niais » dont il est question ici est en effet totalement passif,
mécanique, il correspond à une vision déshumanisée de l’humanité.
A ce sordide, il faudra opposer la conception de la poésie qui se révèle à la fin du poème,
et, à la relecture et par un système de contrastes : la poésie apparaît comme un moyen
de transformer la réalité la plus crue en la sublimant.
L’étude de la structure narrative
pourra se rattacher à cet examen, puisque celle-ci fait partie de l’élaboration, par le recours
au contraste et au paradoxe, de cette célébration finale du pouvoir de la poésie.
Eléments pour le développement
NB : les éléments donnés ici ne sont volontairement pas composés en plan abouti
pour un commentaire ; ils ne font que mettre en lumière les éléments à
commenter : il vous revient de hiérarchiser ces éléments en fonction de votre
propre lecture du texte.
I.
Une peinture cruelle de l’humanité, s’appuyant sur un anti-érotisme
- Cette première partie s’appuie sur les trois premières strophes, narratives, du sonnet.
En
observer d’abord la progression d’ensemble : les deux quatrains sont consacrés à une
énumération des causes qui suscitent chez le « niais » qui est le personnage central le
désir sexuel : remarquer l’anaphore de la locution conjonctive « parce que », qui revient à
quatre reprises.
Relever le passage de l’imparfait, qui décrit le cadre de l’action, au présent
de narration, qui renvoie à une forme narrative du discours.
- Etudier la nature des causes introduites par ce « parce que » : de la viande, un viol décrit
dans le journal, la poitrine « ignoble et mal bâtie » d’une servante, la statue d’un couple,
etc.
: montrer par là que c’est l’environnement, et l’environnement seul qui inspire le désir
de cet homme, ce qui va à rebours des lieux communs poétiques qui voudraient que le
désir soit inspiré par l’amour.
(Cela est d’ailleurs renforcé par la permanence de certaines
sonorités, qui créent une impression d’unité et de cohérence de la scène, et renforcent
donc le thème du conditionnement de l’acte par l’environnement – par exemple, dans le
premier quatrain, les sons « o », « i » et « v » reviennent fréquemment, mimant peutêtre, par paragrammatisation, le mot « viol ».)
Dans cette liste de causes, il y a trois objets – la viande, le journal, la statue -, et deux
parties d’humain – et non des humains entiers, ce qui contribue à la déshumanisation de
la scène – dont une est exposée par hasard – puisqu’il s’agit d’un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓