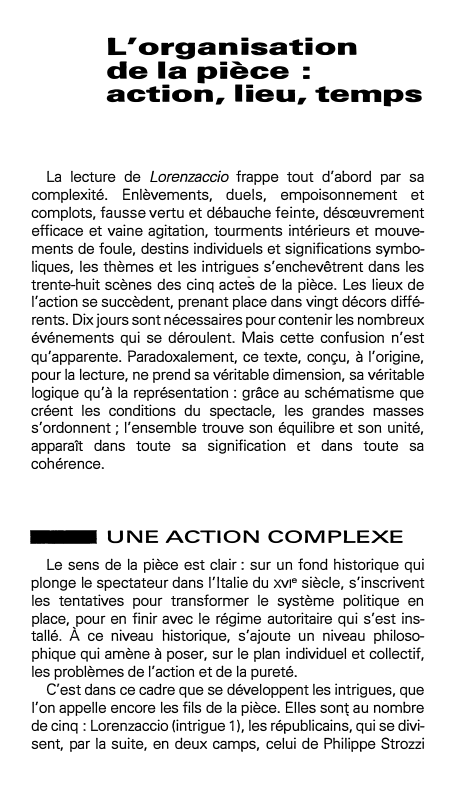L'organisation de la pièce: action, lieu, temps La lecture de Lorenzaccio frappe tout d'abord par sa complexité. Enlèvements, duels, empoisonnement...
Extrait du document
«
L'organisation
de la pièce:
action, lieu, temps
La lecture de Lorenzaccio frappe tout d'abord par sa
complexité.
Enlèvements, duels, empoisonnement et
complots, fausse vertu et débauche feinte, désœuvrement
efficace et vaine agitation, tourments intérieurs et mouve
ments de foule, destins individuels et significations symbo
liques, les thèmes et les intrigues s'enchevêtrent dans les
trente-huit scènes des cinq actes de la pièce.
Les lieux de
l'action se succèdent, prenant place dans vingt décors diffé
rents.
Dix jours sont nécessaires pour contenir les nombreux
événements qui se déroulent.
Mais cette confusion n'est
qu'apparente.
Paradoxalement, ce texte, conçu, à l'origine,
pour la lecture, ne prend sa véritable dimension, sa véritable
logique qu'à la représentation : grâce au schématisme que
créent les conditions du spectacle, les grandes masses
s'ordonnent; l'ensemble trouve son équilibre et son unité,
apparaît dans toute sa signification et dans toute sa
cohérence.
UNE ACTION COMPLEXE
Le sens de la pièce est clair : sur un fond historique qui
plonge le spectateur dans l'Italie du xv1 ° siècle, s'inscrivent
les tentatives pour transformer le système politique en
place, pour en finir avec le régime autoritaire qui s'est ins
tallé.
A ce niveau historique, s'ajoute un niveau philoso
phique qui amène à poser, sur le plan individuel et collectif,
les problèmes de l'action et de la pureté.
C'est dans ce cadre que se développent les intrigues, que
l'on appelle encore les fils de la pièce.
Elles sont au nombre
de cinq : Lorenzaccio (intrigue 1 ), les républicains, qui se divi
sent, par la suite, en deux camps, celui de Philippe Strozzi
(intrigue 2) et celui de son fils Pierre (intrigue 3), la marquise
Cibo (intrigue 4) et la masse anonyme des habitants 'âe
Florence (intrigue 5) affrontent, avec des moyens et des
objectifs divers, le tyran Alexandre de Médicis.
Faut-il en conclure à une absence d'unité d'action ? Oui,
en apparence, d'autant plus que ces cinq intrigues se dérou
lent de façon relativement autonome.
Non, en fait, car des
liens viennent les relier: c'est la faillite de l'opposition répu
blicaine organisée qui amène Lorenzaccio et la marquise
d'abord, Pierre ensuite, à chercher des formes d'action
moins classiques; c'est l'abandon de la marquise par le duc
qui permet à Lorenzaccio d'attirer sa victime dans un piège;
c'est pour les républicains et pour le peuple que Lorenzaccio
travaille.
Et puis, surtout, il s'agit de cinq tentatives dirigées
contre le pouvoir représenté par un obstacle visible, le duc,
et par un obstacle occulte, le cardinal Cibo.
Il s'agit de cinq
formes d'action qui toutes échouent.
Chacun de ces cinq fils
est conduit avec son exposition, son développement et son
dénouement.
Première intrigue :
Lorenzaccio et l'engagement
total
L'intrigue essentielle est évidemment celle qui concerne
Lorenzaccio: c'est lui qui donne son nom à la pièce et il y
occupe 17 scènes sur 38 1 • C'est l'histoire de l'engagement
total d'un être dans l'action.
Pour parvenir à ses fins, pour éli
miner le tyran, il ne recule devant rien, il a tout misé, tout
sacrifié, jusqu'à sa pureté, et constate avec désespoir qu'il
s'est sali les mains, que, dans un souci d'efficacité, il est allé
jusqu'à la destruction de ses valeurs les plus chères.
L'exposition, qui consiste à fournir les données néces
saires à la compréhension de la situation, est fort longue
(acte 1, scènes 1 et 4; acte Il, scènes 2, 4, 5 et 6; acte Ill,
1.
Le total des scènes concernant les différentes intrigues
dépasse le nombre de scènes que compte la pièce, parce que sou
vent plusieurs intrigues prennent place dans la même scène.
scène 1).
Elle se prolonge jusqu'au début de l'acte Ill.
Mus
set entretient savamment le suspense, en maintenant le
plus longtemps possible les doutes sur la véritable person
nalité de Lorenzaccio.
Est-il un débauché, définitivement
perverti ? Est-il, au contraire, un être désintéressé qui tra
vaille pour le bonheur de Florence ? Cette ambiguïté ne se
dissipe qu'à la scène 1 de l'acte Ill.
Le but que poursuit
Lorenzaccio se révèle enfin, lorsqu'il confie à Scoroncon
colo: «Tu as deviné mon mal, j'ai un ennemi», et désigne
ainsi sa cible, Alexandre de Médicis.
La technique adoptée présente deux particularités qui la
distinguent des procédés de l'exposition traditionnelle et
créent le dynamisme: Musset utilise l'effet de surprise qui
repose sur le jeu des apparences et de la réalité et enchâsse
habilement, à l'intérieur de l'exposé des faits, deux données,
le vol de la cotte de mailles (acte Il, scène 6) et la lutte avec
Scoronconcolo (acte Ill, scène 1), qui entrent déjà dans· la
conduite de l'intrigue.
Une fois qu'a été indiqué au spectateur toui: ce qui est
nécessaire à la compréhension des faits, Lorenzaccio va se
trouver partagé entre la préparation de son plan (acte IV,
scènes 1, 3, 5 et 9), les efforts de dissimulation de son projet
au duc (acte IV, scènes 1 et 10) et les avertissements inutiles
donnés aux républicains (acte Ill, scène 3; acte IV, scène 7).
Pour animer l'action, trois coups de théâtre interviennent,
mais ils ne provoquent pas de rebondissements spectacu
laires : à la scène 7 de l'acte IV, le refus des républicains de
prendre Lorenzaccio au sérieux n'aura pas d'influence sur
l'action entreprise, mais pèsera lourd sur ses conséquences.
À la scène 1 de l'acte IV, la méfiance du duc au constat du vol
de sa cotte de mailles, enfin, à la scène 10 de l'acte IV, les
avertissements du cardinal Cibo auraient pu compromettre
le déroulement du plan.
Mais il n'en est rien: ces épisodes
ne connaissent pas en effet de véritable développement.
L'action ne comporte donc que peu de rebondissements
et rend parfaitement compte de la logique implacable avec
laquelle Lorenzaccio conduit ses desseins.Trois scènes seu
lement sont consacrées au dénouement qui se déroule
pourtant en deux temps: à la scène 11 de l'acte IV, c'est la
disparition de l'obstacle avec l'assassinat du duc; à la scène
6 de l'acte V, c'est la mort de Lorenzo, dont la tête a été mise
à prix (acte V, scène 2).
C'est là une fin significative qui montre que le véritable
obstacle, ce n'était pas le duc.
Il ne l'était pas politiquement,
puisqu'il est aussitôt remplacé.
Il ne l'était pas personnelle
ment pour Lorenzaccio, dont le mal est, à l'évidence, tapi au
fond même de l'âme.
Deuxième et troisième intrigues :
Philippe et Pierre Strozzi,
la pensée ou l'action
· L'action menée par Philippe et Pierre Strozzi occupe
16 scènes sur les 38 que compte la pièce.
Les deux
intrigues se développent avec une symétrie parfaite.
Elles
représentent les deux réponses données par les républi
cains au pouvoir tyrannique : la patience et le compromis
préconisés par le père, Philippe (12 scènes) ; la violence et
l'irresponsabilité adoptées par le fils, Pierre (13 scènes) 1 .
L'exposition est commune aux deux actions.
Elle ne
s'étend pas au-delà du premier acte.
Elle est dynamique.
Elle
montre concrètement la situation politique, la lutte sourde
qui oppose le régime du duc aux républicains, en mettant en
scène des affrontements individuels, comme l'insulte faite à
Louise Strozzi par Salviati (acte 1, scènes e et 5), et la persé
cution collective symbolisée par le banrtissemen:t des oppo
sants (acte 1, scène 6).
C'est cet ensemble de données qui entraîne les réactions.
de Philippe et de Pierre Strozzi.
La conduite du père, homme�
de pensée, philosophe, est marquée par l'indécision, les
revirements, mais aussi le désintéressement.
Le comporte
ment du fils, homme d'action, est, au contraire, placé sous le
signe de la détermination, mais aussi de l'ambition.
Partis s
d'une analyse identique, ils vont donc suivre des chemins
totalement différents.
1.
Souvent, ces deux intrigues prennent place dans les mêmes
scènes.
C'est pourquoi, l'addition des scènes où elles se dévelop
pent (25 scènes) dépasse le nombre global de scènes concernant la
famille Strozzi (16 scènes).
Contrairement à ce qui se passe pour Lorenzaccio, cette
double intrigue est traversée par des coups de théâtre
importants: ils soulignent les contradictions entre la
conduite du père et celle du fils et influent, de façon diffé
rente et même opposée, sur les desseins des deux
hommes.
L'échec de l'assassinat de Salviati (acte Il, scène
7), l'arrestation de Pierre et de Thomas (acte Ill, scène 3), la
mort de Louise (acte 111, scène 7), autant de faits, entre
autres, qui plongent Philippe dans le désespoir et la résigna
tion, Pierre dans la fureur et le désir de vengeance (acte Il,
scènes 1 et 5; acte Ill, scènes 2, 3 et 7; acte IV, scène 2).
Le dénouement se produit en deux temps.
Les deux
hommes, dont les conceptions apparaissent irrémédiable
ment inconciliables, se séparent (acte IV, scène 6) : Philippe
se retire à Venise, renonce à l'action et consacre sa vie à
l'étude (acte V, scènes 2 et 6), tandis que Pierre, dévoré
d'ambition, devient un activiste prêt à tout pour faire triom
pher sa cause (acte IV, scène 8 ; acte V, scène 4).
Mais, pour
l'un et l'autre, le couronnement de Côme de Médicis (acte V,
scène 7) sonne comme un échec.
Quatrième intrigue : la marquise,
ou la voie de la sensibilité
C'est toute sa sensibilité qu'engage la marquise Cibo pour
faire pression sur les événements: éprise d'Alexandre de
Médicis, elle espère l'amener par la force de son amour à
modifier sa politique et à faire triompher la liberté.
Cette intrigue, somme toute accessoire, ne se déroule
que sur 6 scènes : une rapide exposition (acte 1, scène 3)
révèle en action les liens qui existent entre le duc et la mar
quise.
Un développement en 3 scènes raconte l'histoire d'un
bref amour traversé par quelques cas de conscience: c'est,
à la scène 3 de l'acte Il, la confession de la marquise au car
dinal, son beau-frère ; à la scène 5 de l'acte Ill, l'attente
angoissée de l'arrivée du duc; à la scène 6 de l'acte Ill, l'im
possible amour entre deux êtres qui ne peuvent se
comprendre.
Le dénouement intervient en deux temps, avec l'aveu de
la marquise à son mari (acte IV, scène 4) et la réconciliation
finale des deux époux (acte V, scène....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓