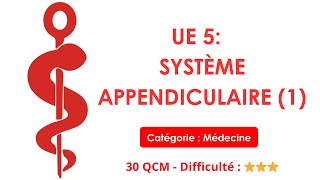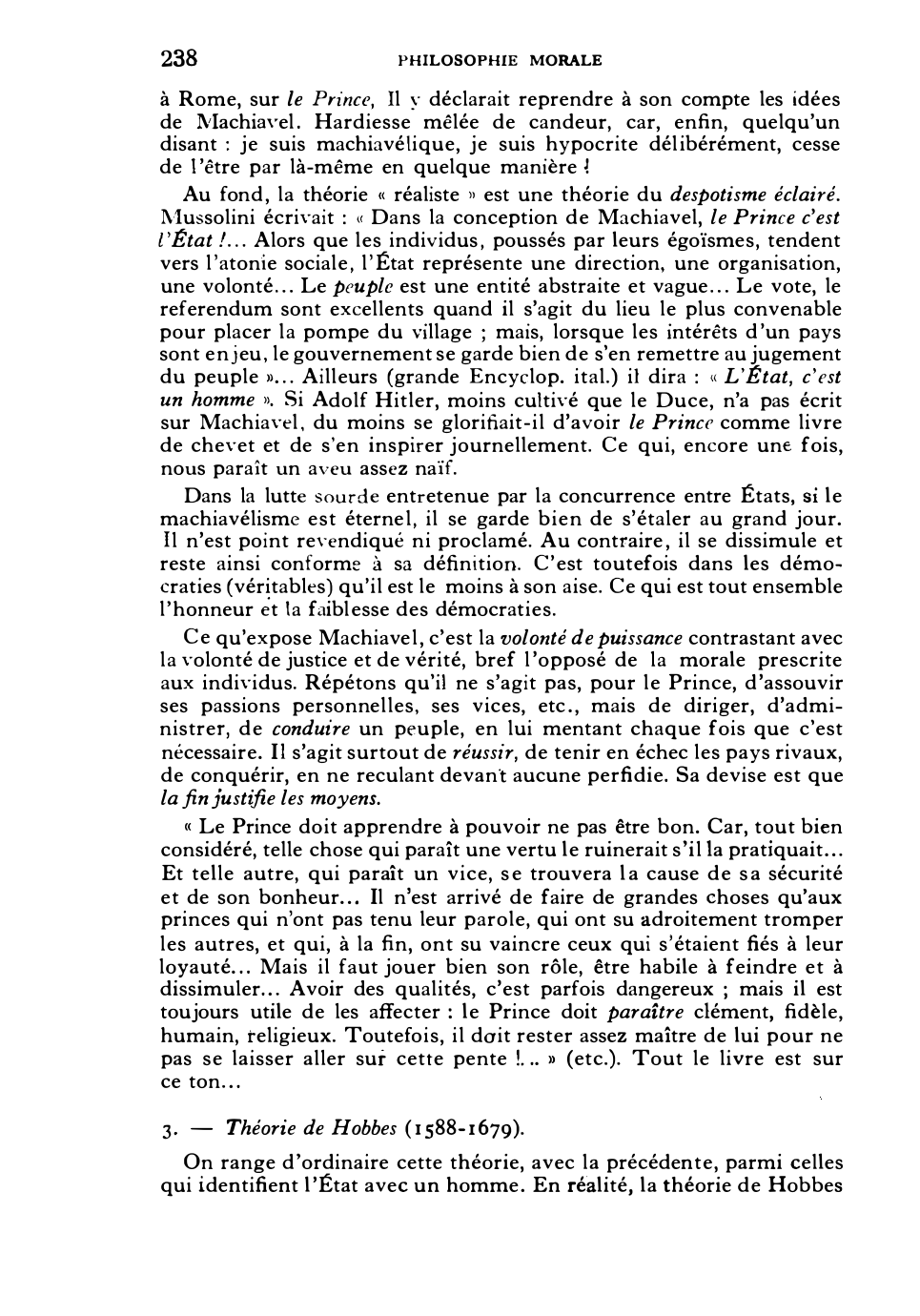L’état. — L’homme dans l’état.
Publié le 12/11/2016
Extrait du document
est très originale. Elle fait reposer l’autorité du souverain sur un quasi-contrat : chaque individu est supposé transférer son droit et sa force à une personne unique. Désormais, un homme pense, veut et agit au nom et place de tous. (Les théoriciens du nazisme ont repris cette thèse comme base du Führerprinzip). Les sujets se reconnaissent solidairement responsables des actes de leur souverain, puisque celui-ci exprime la volonté de la Nation. Hobbes distingue soigneusement le peuple et la multitude. Seul, le peuple n’est pas multiplicité, mais unité. Bref, sous tous les régimes, le peuple est roi... Cette doctrine ne considère donc plus le roi comme une sorte de propriétaire terrien administrant son domaine et ses gens. Elle ne s’appuie pas sur des éléments religieux, et s’oppose, en cela, aux théories alors en vigueur.
4- — Théorie Idéaliste et Démocratique.
J.-J. Rousseau (1712-1778) dans le Contrat social, se demande à quelles conditions un État peut légitimement exister. Légitimement, c’est-à-dire sans détruire l’égalité et la liberté naturelles, mais en leur donnant au contraire une extension et des garanties qu’elles ne sauraient avoir sans lui.
Pour que la loi ne détruise pas la liberté de l’individu, il faut qu’elle ait sa source dans la volonté même de cet individu. Ainsi seulement la liberté civique rejoindra la liberté naturelle. Car l'obéissance à la loi que l'on s’est prescrite est liberté. La société reposera donc sur un pacte. La valeur morale du pacte, son caractère obligatoire et sacré viennent de ce qu’il est la conséquence, la traduction sociale de la loi naturelle. Ce pacte est simple : tous s’engagent envers tous à ne reconnaître d’autre puissance que la volonté générale. C’est l’aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits, à la communauté. Toute théorie politique qui admet un contrat social aboutit nécessairement au problème des droits respectifs de l’individu et de l’Êtat. Les individus ne sont pas dépouillés en faveur du « Prince », dans la conception de Rousseau. Le peuple n’a pas, comme dans la thèse de Hobbes, contracté avec un chef. Il a contracté avec lui-même. Il s’est démuni de tous ses droits naturels, mais seulement en faveur de la volonté générale. Il s’est engagé à obéir, mais à n’obéir qu’à la loi. Or, la loi ne peut détruire la liberté individuelle. Elle en est, au contraire, la seule garantie, pouirvu. qu'elle émane bien de la volonté du peuple. Les individus ne sont donc pas livrés à une puissance indéterminée, sans règle et sans frein. Tout citoyen doit voter la loi. Sans doute, l’accord unanime est rarement possible, et le corps politique ne pourrait agir si l’on ne convenait de tenir pour loi la volonté de la majorité. Il n’empêche que le principe est celui d’une consultation du peuple entier. Si la voix du plus grand nombre oblige tous les autres, c’est une conséquence du contrat lui-même. Elle est impossible à éviter, cette conséquence. Toutefois, Rousseau ajoute que la loi doit être conforme à l’intérêt général (Il y a là, notons-le, un élément appréciatif!) Si elle était faite dans l’intérêt égoïste d’un groupe, même le plus nombreux, nous
L’État. — L’homme dans l’État.
1. — PRINCIPE DE L’ÉTAT.
Donc, l’État, c’est bien la nation, mais considérée en tant que société organisée, ayant un gouvernement, des institutions, des lois. C’est une sorte de réalité transcendante par rapport à la masse sans cesse renouvelée des individus constituant un peuple, une nation... L’État exerce un pouvoir et assume un certain nombre de fonctions : diplomatiques, militaires, judiciaires, administratives, économiques, etc.
Diverses conceptions ou théories ont eu pour objet de fonder le pouvoir sur un principe. Il n’est pas sans intérêt de les résumer ici. Il y a toujours eu, sauf chez des primitifs ou des barbares (et encore !) le désir de légitimer, de justifier l’exercice du pouvoir.
1. — Thèse Religieuse.
Tout pouvoir vient de Dieu (Omnis potestas a Deo). Le loyalisme des sujets confirme ce pouvoir, mais ne le fonde pas. La monarchie (absolue) est héréditaire et « de droit divin ». Le roi est possesseur du sol, maître souverain de ses sujets ; étant roi « par la grâce de Dieu », il n’a de comptes à rendre qu’à Dieu. Il est donc libre d’administrer la nation comme il l’entend. L’intérêt de la dynastie est identifié avec l’intérêt de la nation. Bossuet, parmi d’autres auteurs, s’est fait le théoricien de ce «droit divin » (cf. Louis XIV : « L’État, c’est moi ... »).
2. — Thèse dite « Réaliste ».
Ne s’appuyant pas sur le fondement divin du pouvoir politique, une thèse comme celle de MACHIAVEL (1469-1527) pose cependant comme postulat que le Prince (c’est aussi le titre de l’ouvrage) exerce sa contrainte sur les sujets pour le plus grand bien de ceux-ci. Le livre célèbre de Machiavel est comme le bréviaire de la « volonté de puissance » d’un État représenté par un homme qui le dirige sans autre règle que l’intérêt de cet État: un Duce (en italien : celui qui conduit),, un Führer (même sens, en allemand). Benito Mussolini, alors qu’il était déjà dictateur, soutint une thèse de Doctorat, en Mai 1924,
«
238
PHILOSOPHIE
MORALE
à Rome, sur le Prince, Il y déclarait reprendre à son compte les idées
de !VIachim·e l.
Hardiesse mêlée de candeur, car, enfin, quelqu'un
disant : je suis machiavé lique, je suis hypocrite délibérément, cesse
de 1 'être par là-même en quelque manière l
Au fon d, la théorie « réaliste , est une théorie du despotisme éclairé.
1\lussolini écrivait: «Dans la conception de Machiavel, le Prince c'est
l' Ét at ! ...
Alors que les individus , poussés par leurs égoïsm es, tendent
vers l'atonie sociale, l'État représente une direction, une organisation,
une volonté ...
Le peuple est une entité abstraite et vague ...
Le vote, le
referendum sont excellents quand il s'agit du lieu le plus convenable
pour placer la po mpe du village ; mais, lorsque les intérêts d'un pays
sont enjeu, le gouvernement se garde bien de s'en remettre au jugement
du peuple » ...
Aill eurs (grande Encyclop.
ital.) il dira : «L 'État, c'est
un homme "· Si Adolf Hitler, moins cultivé que le Duce, n'a pas écrit
sur Machiavel , du moins se glorifiait -il d'avoir le Prince comme livre
de chevet et de s'en inspirer journellement.
Ce qui, encore une fois,
nous paraît un aveu assez naïf.
Dans la lutte sourde entretenue par la concurrence entre États, si le
machiavélisme est étern el, il se garde bien de s'étaler au grand jour.
Il n'est point revendiqué ni proclamé.
Au contraire , il se dissimule et
reste ainsi conforme à sa définition.
C'est tout efois dans les démo
craties (véritables) qu'il est le moins à son aise.
Ce qui est tout ensemble
l'h onneur ét la faibl esse des démocrat ies.
Ce qu'expose Machiavel, c'est la volonté de puissance contrastant avec
la volonté de justice et de vérité, bref l'opposé de la morale prescrite
aux individus.
Répétons qu'il ne s'agit pas, pour le Prince, d'assouvir
ses passions personnelles, ses vices, etc., mais de diriger, d'admi
nistrer, de conduire un pt'uple, en lui mentant chaque fois que c'est
nécessai re.
Il s'agit surtout de réussir, de tenir en échec les pays rivaux,
de conquérir, en ne reculant devant aucune perfidie.
Sa devise est que
la fin justifie les moyens.
« Le Prince doit apprendre à pouvoir ne pas être bon.
Car, tout bien
considéré, telle chose qui paraît une vertu le ruinerait s'ilia pratiquait ...
Et telle autre, qui para ît un vice, se trouvera la cause de sa sécurité
et de son bonheur ...
Il n'est arrivé de faire de grandes choses qu'aux
princes qui n'ont pas tenu leur parole, qui ont su adroitement tromper
les autres, et qui, à la fin, ont su vaincre ceux qui s'étaient fiés à leur
loyauté ...
Mais il faut jouer bien son rôle, être habile à feindre et à
dissimuler ...
Avoir des qualités, c'est parfois dangereux ; mais il est
toujours utile de les affecter : le Prince doit paraître clément, fidèle,
humain, religieux.
Toutefois, il doit rester assez maître de lui pour ne
pas se laisser aller sur cette pente !.
..
» (etc.).
Tout le livre est sur
ce ton ...
3· - Théorie de Hobbes (1s88- I679).
On range d'ordinaire cette théorie, avec la précéde nte, parmi celles
qui identifient l'État avec un homme .
En réal ité, la théorie de Hobbes.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Castelo Branco ( Humberto de Alencar), 1900-1967, n? ? Mecejana, mar?chal et homme d'?tat br?silien.
- Carmona ( Ant?nio ?scar de Fragoso), 1869-1951, n? ? Lisbonne, mar?chal et homme d'?tat portugais.
- Théorie du complot : L’Homme n’a jamais marché sur la lune
- LES ALIMENTS CONTRIBUENT IL A LA SANTE CHEZ L’HOMME PAR LA COUVERTURE DES BESOINS DE L’ORGANISME ?
- « L’homme est une invention récente » MICHEL FOUCAULT