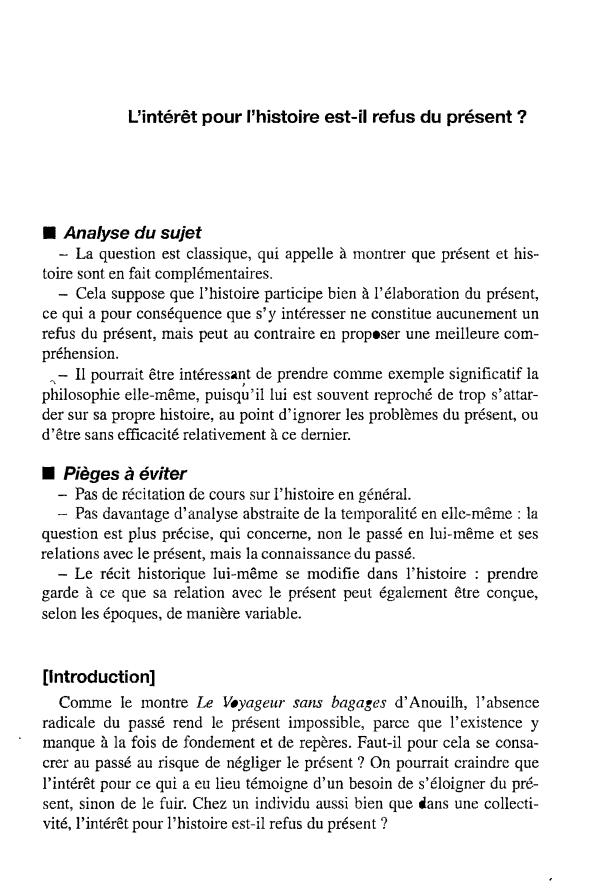L'intérêt pour l'histoire est-il refus du présent ? ■ Analyse du sujet - La question est classique, qui appelle à...
Extrait du document
«
L'intérêt pour l'histoire est-il refus du présent ?
■ Analyse du sujet
- La question est classique, qui appelle à montrer que présent et his
toire sont en fait complémentaires.
- Cela suppose que l'histoire participe bien à l'élaboration du présent,
ce qui a pour conséquence que s'y intéresser ne constitue aucunement un
refus du présent, mais peut au contraire en proposer une meilleure com
préhension.
" - Il pourrait être intéress�t de prendre comme exemple significatif la
philosophie elle-même, puisqu'il lui est souvent reproché de trop s'attar
der sur sa propre histoire, au point d'ignorer les problèmes du présent, ou
d'être sans efficacité relativement à ce dernier.
■ Pièges à éviter
- Pas de récitation de cours sur l'histoire en général.
- Pas davantage d'analyse abstraite de la temporalité en elle-même: la
question est plus précise, qui concerne, non le passé en lui-même et ses
relations avec le présent, mais la connaissance du passé.
- Le récit historique lui-même se modifie dans l'histoire : prendre
garde à ce que sa relation avec le présent peut également être conçue,
selon les époques, de manière variable.
[Introduction]
Comme le montre Le Voyageur sans bagages d' Anouilh, l'absence
radicale du passé rend le présent impossible, parce que l'existence y
manque à la fois de fondement et de repères.
Faut-il pour cela se consa
crer au passé au risque de négliger le présent ? On pourrait craindre que
l'intérêt pour ce qui a eu lieu témoigne d'un besoin de s'éloigner du pré
sent, sinon de le fuir.
Chez un individu aussi bien que dans une collecti
vité, l'intérêt pour l'histoire est-il refus du présent?
SUJETS CORRIGÉS
[I.
L'histoire est fondatrice]
Si le récit historique s'élabore initialement du moins pour ce qui
concerne la culture occidentale en Grèce, ce n'est certainement pas par
hasard: c'est au contraire en relation avec l'organisation politique de cette
dernière en cités différentes, toujours soucieuses d'affirmer leur suprématie ou leur indépendance.
Dans un tel contexte, chercher à connaître les
origines de la cité (même si elles restent encore en majeure partie
mythiques), c'est d'abord justifier l'existence de cette dernière; c'est
aussi renforcer son sentiment communautaire par référence à une origine
commune; c'est enfin pouvoir s'enorgueillir d'un passé déjà long ou glorieux, qui donne en quelque sorte« le droit» de s'imposer aux autres, par
la simple comparaison de ce qui fut accompli dans le passé de chaque
cité.
L'intérêt initial pour l'histoire paraît ainsi lié à un « civisme » particulier, préfiguration du patriotisme, ou même du nationalisme.
Mais il
concerne du même coup la recherche des valeurs communes, en soulignant leur ancienneté et en renforçant ainsi leur légitimité.
Lorsque Hegel affirme que « être, c'est avoir été», il lie inextricablement le présent à l'histoire, et prend acte des relations complexes qui les
unissent.
Ce faisant, il introduit dans la réflexion philosophique la nécessité d'une connaissance historique : pour comprendre ce qui est, il faut
commencer par analyser ce qui a été.
De ce point de vue, l'intérêt pour
l'histoire indique, non un refus du présent, mais tout au contraire le souci
de l'explorer et de l'interpréter plus justement, comme «conséquence»
ou «production» de l'histoire elle-même.
L'idéalisme hégélien pourra
être critiqué par Marx.
Il n'en reste pas moins que ce dernier réaffirme,
dans son propre système, le primat de la connaissance historique, et considère à son tour qu'en l'absence de cette dernière, toute analyse du présent
est vouée à l'incompréhension : il est impossible de comprendre les problèmes de l'organisation moderne du travail si on ignore ses origines et
son évolution historique, tout comme il est impossible de comprendre ce
que peut être la liberté actuelle, ou ce que pourra être son futur, si l'on n'a
pas d'abord la connaissance historique de ses moments antérieurs, des
luttes qui en ont ponctué l'histoire, et de la façon dont son élargissement
partiel s'est toujours opéré pour résoudre des contradictions sociales.
[Il.
L'intérêt pour l'histoire agit sur le présent]
Ce n'est donc pas seulement d'un point de vue politique que l'histoire
fonde le présent, c'est, peut-être plus fondamentalement, aussi d'un
point de vue philosophique.
Dans la philosophie elle-même, telle qu'elle
se pratique, il est d'ailleurs aisé de constater, malgré les reproches qui
peuvent lui être adressés un peu naïvement à ce propos, que l'intérêt pour
sa propre histoire, loin d'être un refus du présent, constitue la condition
CORRIGÉ32
d'un travail efficace mené sur ce présent.
Travailler les textes classiques
ne témoigne pas du tout d'une volonté de s'isoler de l'actualité : peut-être
est-ce plutôt le seul moyen de saisir le présent dans la nouveauté des problèmes qu'il fait surgir et dans la manière dont il invite la réflexion à formuler d'autres concepts.
Ainsi L'Histoire de la folie de Michel Foucault,
par exemple, ne s'est pas contentée de recenser les conceptions anciennes
de la «folie», elle a eu pour conséquence d'ébranler ce qui semblait en
être la conception actuelle, ne serait-ce qu'en montrant combien la définition de la folie est variable, en fonction des contextes culturels.
L'histoire montre en effet comment le présent s'est formé, mais
aussi qu'il n'est que le résultat d'un certain nombre de déterminations, et
qu'en conséquence il serait totalement illusoire de considérer que la version qu'il réalise du monde est «obligatoire», «naturelle»....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓