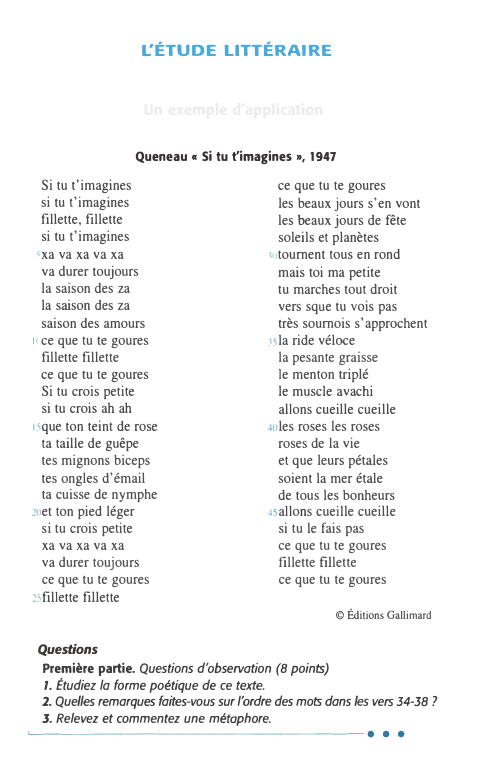L'ÉTUDE LITTÉRAIRE Un exemple d'application Queneau" Si tu t'imagines•• 1947 Si tu t'imagines si tu t'imagines fillette, fillette si tu...
Extrait du document
«
L'ÉTUDE LITTÉRAIRE
Un exemple d'application
Queneau" Si tu t'imagines•• 1947
Si tu t'imagines
si tu t'imagines
fillette, fillette
si tu t'imagines
sxa va xa va xa
va durer toujours
la saison des za
la saison des za
saison des amours
11 ce que tu te goures
fillette fillette
ce que tu te goures
Si tu crois petite
si tu crois ah ah
i;que ton teint de rose
ta taille de guêpe
tes mignons biceps
tes ongles d'émail
ta cuisse de nymphe
211et ton pied léger
si tu crois petite
xa va xa va xa
va durer toujours
ce que tu te goures
isfillette fillette
ce que tu te goures
les beaux jours s'en vont
les beaux jours de fête
soleils et planètes
1otournent tous en rond
mais toi ma petite
tu marches tout droit
vers sque tu vois pas
très sournois s'approchent
.isla ride véloce
la pesante graisse
le menton triplé
le muscle avachi
allons cueille cueille
-1ules roses les roses
roses de la vie
et que leurs pétales
soient la mer étale
de tous les bonheurs
-1sallons cueille cueille
si tu le fais pas
ce que tu te goures
fillette fillette
ce que tu te goures
© Éditions Gallimard
Questions
Première partie.
Questions d'observation (8 points)
1.
Étudiez la forme poétique de ce texte.
2.
Quelles remarques faites-vous sur l'ordre des mots dans les vers 34-38 ?
J.
Relevez et commentez une métaphore.
�--------------------• • ·
•••
Méthode
xième partie.
Questions de commentaire (12 points)
0
uel thème traditionnel du lyrisme est développé dans ce poème ?
ous montrerez avec quelle fantaisie le poète a su renouveler ce thème.
LIRE ET INTERROGER LE TEXTE
• Le thème est la fuite du temps (oppositions jeunesse / vieillesse,
homme mortel / nature éternelle, carpe diem).
• Le genre : un poème.
• Le type : descriptif (beauté / laideur) et argumentatif (conseil).
• La tonalité : lyrisme tempéré par l'humour.
• L'énonciation : un dispositif classique, où le poète s'adresse à une
jeune et belle fille.
Hypothèses (données par les questions de commentaire)
• Queneau s'inscrit dans la tradition d'un grand thème lyrique : la fuite
du temps et le carpe diem.
• Il le renouvelle par son humour et ses jeux poétiques.
ANALYSER LE TEXTE ET RÉPONDRE AUX QUESTIONS
o' OBSERVATION
• Le jeu verbal (orthographe phonétique, mélange des registres).
• Le jeu grammatical (incorrections familières) et la construction du
texte (hypothèses puis impératif).
• Les métaphores sur le corps féminin et le cours de la vie.
• La forme poétique (vers de cinq syllabes, rimes irrégulières,
enjambements, ponctuation absente, refrain).
• La tonalité humoristique (fantaisie, cruauté, jeux verbaux, jeu avec les
clichés).
• L'intertextualité (références à Homère, Horace, Ronsard).
1.
ttudiez la forme poétique de ce texte.
Ce poème est composé de 49 vers de cinq syllabes disposés selon
un jeu très libre : si l'on perçoit un refrain dans la reprise conclusive
de trois vers, en trois occurrences, on constate qu'il ne détermine
pas de strophes, puisque les trois groupes ont respectivement 12, 14
et 25 vers ; de même, la disposition des rimes semble capricieuse, et
tous les vers ne riment pas.
Par ailleurs, la fluidité du poème est
accentuée par l'absence de ponctuation, de majuscules, de
découpage graphique en strophes et par la multiplication des
�---------------------• • ·
• • •----------- Méthode
enjambements: rien n'arrête le mouvement du poème, comme rien
n'arrête celui du temps.
2.
Quelles remarques faites-vous sur l'ordre des mots dans
les vers l4-l8?
!:inversion du quadruple sujet des vers 34-38 (/a ride véloce/ la
pesante graisse/ Je menton triplé/ Je muscle avachi) s'accompagne
de l'antéposition d'un adjectif attribut (très sournois) : ce mouvement,
qui construit la phrase en cadence majeure, traduit la métamorphose
physique qui, au bout du chemin, guette la jeune fille ; il épouse aussi
bien la continuité du temps que le poids des ans.
l.
Relevez et commentez une métaphore.
Le poème métaphorise à la fois la beauté féminine (guêpe, émail,
nymphe) et l'écoulement de la vie (saison, tu marches).
Une image
réunit les deux thèmes, celle de la rose, que l'on retrouve aux vers 15
(ton teint de rose) et 39-41 (cueille/ les roses les roses/ roses de la
vie), métaphore filée par le mot pétales au vers suivant.
Queneau
reprend ici la double symbolique chère à Ronsard : la rose est
l'emblème à la fois de la beauté féminine et de la fragilité de toute
beauté.
DÉGAGER DES AXES DE LECTURE
1.
Quel thème traditionnel du lyrisme est développé dans
ce poème?
• Le thème est la fuite du temps (oppositions, carpe diem).
• Le genre : un poème de la fluidité (vers de cinq syllabes, enjam
bements, ponctuation absente, refrain).
• Le texte est de type argumentatif (conseil) : d la construction du
texte (hypothèses puis impératif).
• La tonalité est lyrique: d les métaphores sur le corps féminin et le
cours de la vie.
• !:énonciation: un dispositif classique, où le poète s'adresse à une
jeune et belle fille : cruauté et conseils.
2.
Vous montrerez avec quelle fantaisie le poète a su
renouveler ce thème.
• Le jeu verbal (orthographe phonétique, mélange des registres).
• Le jeu grammatical (incorrections familières).
• • •------------Méthode
• La forme poétique.
• La tonalité humoristique (fantaisie, cruauté, jeux verbaux, jeu avec
les clichés).
• l'.intertextualité (références à Homère, Horace, Ronsard).
CONSTRUIRE LE DÉVELOPPEMENT
1.
Présentation du thème.
a.
l'.énonciation met en lumière trois contrastes : ignorance / savoir,
jeunesse / vieillesse, homme mortel / nature éternelle.
b.
La forme poétique concrétise le thème de la fuite du temps et de la
fluidité.
c.
Le carpe diem tempère cette cruauté : image de la rose et conseil
épicurien.
2.
Renouvellement du thème.
a.
Le poète joue avec la tradition : l'intertextualité.
b.
Le poète joue avec la langue : registres, orthographe.
c.
Le poète joue avec la tonalité : l'humour.
RÉDIGER LE DÉVELOPPEMENT
[1.] D'Horace à Apollinaire, la fuite du temps est un lieu commun du
lyrisme : Queneau en fait le thème de son poème « Si tu t'imagines »,
et il en développe les motifs et la leçon philosophique.
l'.énonciation choisie est caractéristique de ce traitement : le poème se
présente, comme dans « Mignonne », de Ronsard, comme une adresse
à une jeune beauté.
Il se développe ainsi sur une double opposition :
entre l'ignorance de la jeune femme - ce que tu te goures - et le savoir
du poète ; entre la beauté présente, chantée dans le blason des vers
15-20, et la décrépitude annoncée des vers 34-38.
Non seulement le
temps s'écoule mais il détruit.
La complaisance féroce avec laquelle le
poète joue de la pesante graisse contre la taille de guêpe, des muscles
avachis contre le mignon biceps n'est guère tempérée par un autre
contraste : la précarité de la condition humaine, qui marche tout droit
vers ce qu'elle ne voi[t] pas, est mise en évidence par son opposition
au mouvement éternel de la nature, soleils et planètes qui tournent
tous en rond.
Ce mouvement inexorable, cette fuite insaisissable sont soulignés par
la forme poétique.
La brièveté et le déséquilibre du pentasyllabe, vers
�---------------------• • ·
•••------------Mé�ode
impair, le désordre des rimes, l'omniprésence des enjambements (tu
marches tout droit/ vers sque tu vois pas), soulignée par l'absence non
seulement de ponctuation mais aussi de majuscules en tête de vers,
tout contribue dans le choix de l'écriture poétique à une fluidité
symbolique, que seul vient interrompre le leitmotiv d'un refrain
constat : ce que tu te goures.
Pourtant, comme le veut la tradition lyrique, le poète oppose à ce
constat tragique une forme d'espoir, qui tient en une image et un
conseil.
!'.image est celle de la rose, qui symbolise à la fois la fraîcheur de la
jeune fille, au teint de rose, et les bonheurs de la jeunesse, les roses
roses de la vie.
Cette fleur est l'emblème, popularisé par Ronsard, de la
beauté éphémère.
Elle concrétise ainsi poétiquement le mot d'ordre
épicurien carpe diem, « cueille le jour •, auquel Queneau se réfère
clairement en employant le verbe seul, et répété, au vers 40 : allons
cueille cueille.
Les dix derniers vers, avec leurs impératifs pressants et
le jeu métaphorique qui conduit des roses aux bonheurs,
métamorphosent, comme les sonnets ronsardiens, la méditation sur la
fuite du temps en une invitation à jouir de la vie.
(2.) Queneau, poète savant et malicieux, renouvelle le topos lyrique de
la fuite du temps, en jouant avec la tradition, la langue et la tonalité.
Queneau aime en effet à se souvenir de ses prédécesseurs, d'abord du
plus grand de tous, Homère, à qui il emprunte, en la mettant au
singulier, l'épithète d'Achille aux pieds légers, mais aussi de Ronsard,
qui invitait Hélène à cueill[ir] dès aujourd'hui les roses de la vie, et dont
la Mignonne est rebaptisée fillette.
l'.intertextualité joue ici avec le
thème - tout passe, sauf peut-être des vers, des fragments épars de
beauté littéraire - en même temps que ces clins d'œil établissent une
connivence avec le lecteur cultivé.
Tout passe, tout change et notamment la langue.
Queneau en joue en
virtuose en mélangeant les registres : au langage courant (tu
t'imagines, tu marches tout droit), il mêle des mots plus relevés,
comme nymphe, emprunté à la mythologie, ou l'adjectif étales; mais
surtout il puise dans le registre familier, avec des marques tant lexicales
(tu te goures) que syntaxiques, dans l'exclamation ce que tu te goures
ou les négations sque tu vois pas, si tu le fais pas.
Cet effet d'incongruité est renforcé par l'emploi inattendu de l'écriture
phonétique : les vers 5, 7 et 8 contiennent d'étranges monosyllabes,
résultant d'une contraction (xa pour qu'ça, que ça) ou transcrivant une
liaison, contrairement à l'usage (la saison des za).
Les répétitions des
�---------------------• • ·
• • •------------Méthode
vers 5 à 7 donnent l'impression d'un disque rayé et rappellent que la
langue est matière sonore et ludique.
Mais l'originalité du poème tient surtout aux dissonances introduites
par divers procédés comiques.
Aux images les plus conventionnelles
(ton teint de rose), l'auteur mêle joyeusement des trouvailles
inattendues (ongles d'émoi/) ou cocasses (la ride véloce) ; il joue sur
les mots (les roses roses de la vie) ; il traite enfin sur le mode
humoristique tant la révolution des astres (tourn[ant] tous en rond) que
la beauté féminine aux mignons biceps, allant jusqu'à la caricature pour
évoquer l'horreur de la vieillesse au menton triplé.
Si l'emploi délibéré
de constructions symétriques, de répétitions et surtout du refrain
renforce incontestablement cet humour, ces divers moyens rythmiques
sont aussi destinés à imprimer avec force dans la cervelle d'une jeune
naïve (tu marches tout droit vers sque tu vois pas) le conseil épicurien
qui marque l'aboutissement du poème.
Raymond Queneau traite un sujet grave avec légèreté et fantaisie.
Or
tout porte à croire que ce badinage est plus efficace que le ton
sentencieux, d'autant que le poète s'est ingénié à utiliser le langage de
celle à qui il s'adresse.
LE COMMENTAIRE COMPOSÉ
Un exemple d'application
Chateaubriand,
Mémoires d'outre-tombe, 1, v, 1812
Dans le premier livre des Mémoires d'Outre-tombe, François-René
de Chateaubriand (1768-1848) retrace son enfance bretonne.
Il
évoque ici les jeux inspirés par un camarade espiègle, Gesril, sur la
grève de Saint-Malo.
Nous étions un dimanche sur la grève, à l'éventail de la porte
Saint-Thomas 1 à l'heure de la marée.
Au pied du château et le long
du Sillon 1, de gros pieux enfoncés dans le sable protègent les murs
contre la houle.
Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux
5 pour voir passer au-dessous de nous les premières ondulations du
�---------------------• • ·
• • • ------------Méthode
flux.
Les places étaient prises comme de coutume; plusieurs petites
filles se mêlaient aux petits garçons.
J'étais le plus en pointe vers la
mer, n'ayant devant moi qu'une jolie mignonne, Hervine Magon,
qui riait de plaisir et pleurait de peur.
Gesril se trouvait à l'autre bout
1odu côté de la terre.
Le flot arrivait, il faisait du vent; déjà les bonnes
et les domestiques criaient : « Descendez, Mademoiselle ! descen
dez Monsieur ! » Gesril attend une grosse lame: lorsqu'elJe s'en
gouffre entre les pilotis, il pousse l'enfant assis près de lui ; celui-là
se renverse sur un autre; celui-ci sur un autre: toute la file s'abat
15 comme des moines de cartes2, mais chacun est retenu par son voi
sin; il n'y eut que la petite fille de l'extrémité de la ligne sur
laquelJe je chavirai qui, n'étant appuyée par personne, tomba.
Le
jusant3 l'entraîne; aussitôt mille cris, toutes les bonnes retroussant
Jeurs robes et tripotant dans la mer, chacune saisissant son magot4 et
2olui donnant une tape.
Hervine fut repêchée; mais elle déclara que
François l'avait jetée bas.
Les bonnes fondent sur moi ; je leur
échappe ; je cour me barricader dans la cave de la maison: l'armée
femelJe me pourchasse.
Ma mère et mon père étaient heureusement
sortis.
La Villeneuve5 défend vaillamment la porte et soufflette
,, l'avant-garde ennemie.
Le véritable auteur du mal, Gesril, me prête
secours: il monte chez lui, et avec ses deux sœurs jette par les
fenêtres des potées d'eau et des pommes cuites aux assaillantes.
Elles levèrent le siège à l'entrée de la nuit ; mais cette nouvelle se
répandit dans la viile, et le chevalier de Chateaubriand, âgé de
neuf ans, passa pour un homme atroce, un reste de ces pirates dont
saint Aaron avait purgé son rocher6.
1.11 s'agit desfortificatio11s de Sai111-Malo.
2.
Comme des châteaux de cartes.
3.
Le reflux.
4.
Le ten11e, qui s'applique à u11e sorte de singe, désig11e ici les enfants.
5.
Nourrice de l'auteur.
6.
Ce rocher est une île, face à l'embouchure de la Rance, sur l'actuel site de Sai111Malo: l'ermite Aaro11....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓