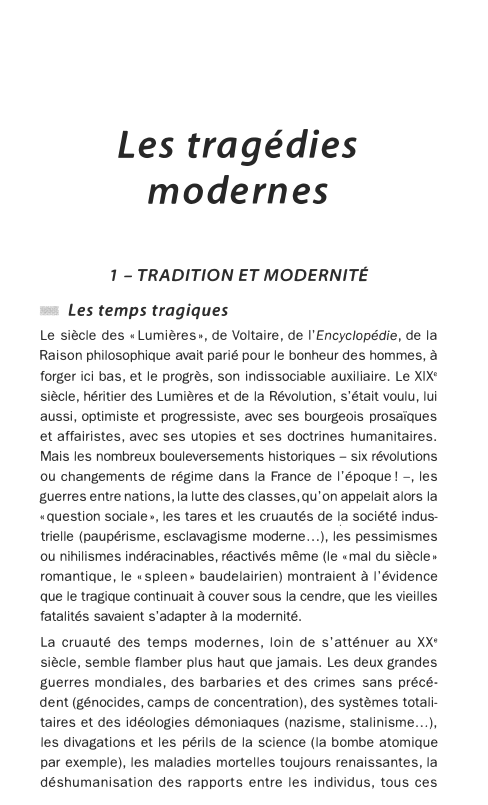Les tragédies modernes 1 - TRADITION ET MODERNITÉ • Les temps tragiques Le siècle des «Lumières», de Voltaire, de I'Encyclopédie,...
Extrait du document
«
Les tragédies
modernes
1 - TRADITION ET MODERNITÉ
• Les temps tragiques
Le siècle des «Lumières», de Voltaire, de I'Encyclopédie, de la
Raison philosophique avait parié pour le bonheur des hommes, à
forger ici bas, et le progrès, son indissociable auxiliaire.
Le XIX'
siècle, héritier des Lumières et de la Révolution, s'était voulu, lui
aussi, optimiste et progressiste, avec ses bourgeois prosaïques
et affairistes, avec ses utopies et ses doctrines humanitaires.
Mais les nombreux bouleversements historiques - six révolutions
ou changements de régime dans la France de l'époque! -, les
guerres entre nations, la lutte des classes, qu'on appelait alors la
«question sociale», les tares et les cruautés de l_a société indus
trielle (paupérisme, esclavagisme moderne ...), les pessimismes
ou nihilismes indéracinables, réactivés même (le «mal du siècle»
romantique, le «spleen» baudelairien) montraient à l'évidence
que le tragique continuait à couver sous la cendre, que les vieilles
fatalités savaient s'adapter à la modernité.
La cruauté des temps modernes, loin de s'atténuer au XX•
siècle, semble flamber plus haut que jamais.
Les deux grandes
guerres mondiales, des barbaries et des crimes sans précé
dent (génocides, camps de concentration), des systèmes totali
taires et des idéologies démoniaques (nazisme, stalinisme ...
),
les divagations et les périls de la science (la bombe atomique
par exemple), les maladies mortelles toujours renaissantes, la
déshumanisation des rapports entre les individus, tous ces
fléaux terrifiants, tous ces monstres menaçants, tous ces
orages et ces déchaînements de !'Histoire ont si bien contredit
les humanismes et les optimismes passés qu'on assiste à un
«retour du tragique" (Jean-Marie Domenach), à la réapparition
d'une conscience tragique.
L'absurde, ou le sentiment de l'ab
surde, se révèle la clé de ce siècle de fer, et « dans l'homme
moderne, contradictoire, déchiré, désormais conscient de l'ambi
guïté de l'homme et de son histoire" Camus n'hésite pas à
reconnaître • l'homme tragique par excellence•.
Certes l'on
n'écrira plus de ,tragédies ..
, mais tout un théâtre tragique, tout
un tragique hors tragédie vont reprendre les vieilles interroga
tions, les éternelles questions sans réponses: Fatalité ou
liberté? Misère ou grandeur de l'homme, etc.
Dans un théâtre
nouveau, volontiers iconoclaste, se retrouveront les principales
couleurs de la palette tragique: la splendeur mythique, les
fastes de la poésie ou de la cérémonie, les paroxysmes de la
cruauté, et même l'esthétique ou plutôt la dramaturgie clas
sique.
Les drames mythologiques
On constate au XX• siècle un retour des mythes antiques au
théâtre, sans parler des mises en scè�e modernes des chefs
d'œuvre de !'Antiquité.
Le mythe d'Œdipe est traité à la fois par
Gide (Œdipe, 1931), qui l'utilise pour débattre de la liberté et de
la prédestination, et par Cocteau, qui donne une image surréa
liste de la fatalité dans La Machine infernale (1934).
Anouilh
s'intéresse à la fille d'Œdipe (Antigone, 1944) qu'il transforme
en figure emblématique de la Résistance à l'occupant allemand.
L'Électre (1937) de Giraudoux est conçue comme un drame de
la justice et de la pureté; et Les Mouches (1943) de Sartre font
d'Oreste le porte-parole de la philosophie «existentialiste"
(l'homme est «condamné à être libre ..
).
Les figures mythiques de
Prométhée, Orphée, Thésée ou Médée reprennent aussi du ser
vice sous la plume des nouveaux dramaturges.
Giraudoux va
même jusqu'à faire revivre tous les protagonistes d'Homère
dans La guerre de Troie n'aura pas fieu (1935) pour dénoncer la
montée des périls dans l'entre-deux-guerres.
Dans ce théâtre à thèse les vieux mythes sont prétextes à des
variations humoristiques ou ironiques, remplies souvent d'ana
chronismes savoureux, sortes de paraboles destinées, selon
les mots de Gide, davantage à «faire réfléchir" qu'à «faire frémir
ou pleurer ...
Au-delà de l'adaptation au monde moderne, le fond
du débat reste l'énigme de la condition humaine, sa marge de
liberté ou son lot de malheur.
• La tentation du classicisme
En plein XX• siècle Montherlant ne répugne pas à écrire des tra
gédies classiques (La Reine morte, 1942; Le Maître de Santiago,
1947; Port-Royal, 1954), drames historiques et chrétiens, dont
la langue cérémonieuse oscille entre la rhétorique classique et
le lyrisme aussi bien antique que romantique.
Ce moderne se
réclame ouvertement de la simplicité racinienne: «J'ai été
charmé, dit-il dans la Préface de sa première œuvre, de fabriquer
une pièce qui n'existait que par son action intérieure; d'éprouver
si elle se suffirait de ne comporter rien qui ne fût nécessaire à
cette action; de la faire simple et presque décharnée...
»
D'autres dramaturges, même s'ils se veulent résolument nova
teurs, n'en appliquent pas moins les recettes de la dramaturgie
classique, privilégiant en particulier des espaces forgés avec la
règle des trois unités.
Dans Huis clos (1944) Sartre emprisonne
trois personnages dans une étrange chambre d'hôtel: ce sont
des morts, accueillis en enfer, pour s'y déchirer...
à perpétuité!
Chacun prisonnier, selon la célèbre formule, du regard des
autres.
Le carcan dramaturgique est tout aussi impitoyable dans
Le Malentendu (1944) de Camus, drame de l'homme exilé dans
un monde qu'il ne comprend pas et au sein duquel il se sent
«étranger ...
Ionesco, l'un des grands du «théâtre de l'absurde"
(Martin Esslin), donne avec Le Roi se meurt (1962) une tragédie
quasi classique, malgré le mélange des tons.
Le flamboyant et
lyrique Genet retrouve, lui aussi, le secret des trois unités, voire
la «pompe" de l'ancienne tragédie, dans ces autres huis clos
meurtriers que sont Les Bonnes (1947) et Haute Survei llance
(1949); du même, Le Balcon (1957) enferme toute une société
dans une étrange maison close pour une cérémonie à la fois bur-
lesque et funèbre.
Quant à Claudel, malgré sa foi, catholique, en
la Providence et la Rédemption, qui le pousse à exorciser le tra
gique, malgré sa dramaturgie qui rompt délibérément avec le
théâtre traditionnel (indifférence totale par exemple à l'unité de
lieu et à celle de temps), il ne conçoit pas autrement ses pièces
que comme de véritables liturgies, parées des splendeurs d'un
verbe incantatoire (ainsi dans le Soulier de satin, 1943).
Une tri
logie, écrite de 1908 à 1916, L'Otage, Le Pain dur, Le Père humi
lié, se situe dans le droit fil du théâtre d'Eschyle, dont Claudel....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓