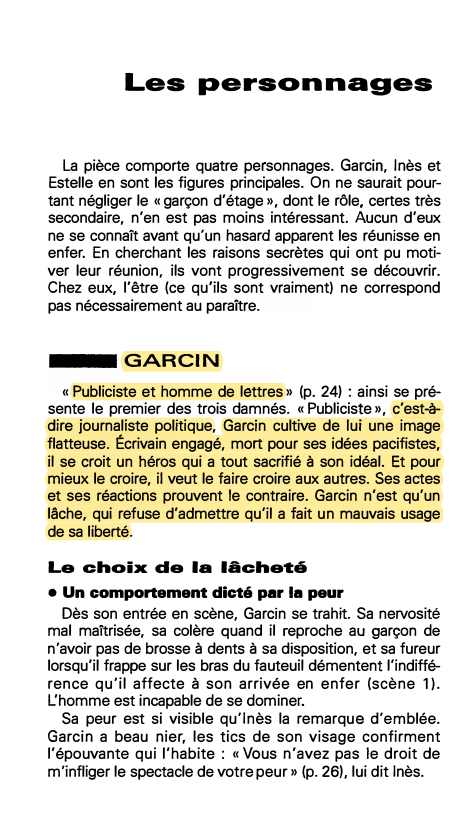Les personnages La pièce comporte quatre personnages. Garein, Inès et Estelle en sont les figures principales. On ne saurait pour...
Extrait du document
«
Les personnages
La pièce comporte quatre personnages.
Garein, Inès et
Estelle en sont les figures principales.
On ne saurait pour
tant négliger le«garçon d'étage», dont le rôle, certes très
secondaire, n'en est pas moins intéressant.
Aucun d'eux
ne se connaît avant qu'un hasard apparent les réunisse en
enfer.
En cherchant les raisons secrètes qui ont pu moti
ver leur réunion, ils vont progressivement se découvrir.
Chez eux, l'être (ce qu'ils sont vraiment) ne correspond
pas nécessairement au paraître.
GARCIN
«Publiciste et homme de lettres» (p.
24) : ainsi se pré
sente le premier des trois damnés.
«Publiciste», c'est-à
dire journaliste politique, Garein cultive de lui une image
flatteuse.
Écrivain engagé, mort pour ses idées pacifistes,
il se croit un héros qui a tout sacrifié à son idéal.
Et pour
mieux le croire, il veut le faire croire aux autres.
Ses actes
et ses réactions prouvent le contraire.
Garein n'est qu'un
lâche, qui refuse d'admettre qu'il a fait un mauvais usage
de sa liberté.
Le choix de la lâcheté
• Un comportement dicté par la peur
Dès son entrée en scène, Garein se trahit.
Sa nervosité
mal maîtrisée, sa colère quand il reproche au garçon de
n'avoir pas de brosse à dents à sa disposition, et sa fureur
lorsqu'il frappe sur les bras du fauteuil démentent l'indiffé
rence qu'il affecte à son arrivée en enfer (scène 1 ).
L'homme est incapable de se dominer.
Sa peur est si visible qu'Inès la remarque d'emblée.
Garein a beau nier, les tics de son visage confirment
l'épouvante qui l'habite : «Vous n'avez pas le droit de
m'infliger le spectacle de votre peur» (p.
26), lui dit Inès.
Tout ce que.
bribe après bribe, Garein révèle de -son
passé corrobore d'ailleurs sa lâcheté.
Il ne s'est pas opposé à la guerre comme d'abord il le prétend (p.
40); il
s'est enfui (p.
80).
Sa fin ne fut pas héroïque comme il
l'espérait.
Victime d'une « défaillance corporelle» (p.
80)
devant le peloton d'exécution, Garein est mort en lâche.
• Le refus de s'anumer
Sa lâcheté ne provient ni d'un naturel peureux, ni d'un
tempérament craintif, ni d'aucune disposition de caractère.
Sartre ne croit en effet pas plus en l'hérédité qu'en la psychologie.
qu'il considère comme des explications trop
commodes.
Libre.
totalement libre (voir ci-dessous, p.
31 ),
l'homme ne naît pas peureux, ni d'ailleurs courageux.
li le
devient.
Comme Sartre l'écrit dans L'Existentia/isme est
un humanisme: « Ce qui fait la lâcheté, c'est l'acte de renoncer ou de céder, un tempérament ce n'est pas un
acte; le lâche est défini à partir de l'acte qu'il a fait 1.»
Or les actes de Garein témoignent de son refus à assumer les situations dans lesquelles il s'est trouvé.
Garein a
opté pour le pacifisme.
Il était libre de faire ce choix comme
il l'aurait été d'en faire un autre.
Mais, après l'avoir fait, il devait s'y tenir une fois pour toutes.
Celui qui prétend choisir
sa vie, doit assumer son choix, y compris jusqu'à la mort.
La liberté telle que la conçoit Sartre s'avère donc d'une
exigence redoutable.
Elle appartient tout entière à
l'homme, et non à Dieu.
C'est la signification même du
mythe des Mouches, où Jupiter admet que toute nécessité morale, politique ou religieuse disparaîtrait si les
hommes « connaissaient le secret douloureux des Dieux
et des rois : c'est que les hommes sont libres i, 2.
Mais cette liberté n'est pas permission de faire n'importe quoi.
De même que nos engagements et nos choix
donnent un sens au monde3 et donc à notre propre vie, de
même ils définissent un type de relations avec autrui.
En
se construisant par ses actes, l'homme participe à la
1.
Sartre, L'Existentialisme est un humanisme (Paris, Nagel, 1946,
p.
60}.
2.
Sartre, Les Mouches (Gallimard, «Folio».
p.
200, acte Il, scène 5).
3.
Selon Sartre, le monde ne possède pas de sens ni de signification a priori puisqu'aucun Dieu n'existe; c'est donc à chaque
homme qu'il appartient de le doter d'un sens.
20
construction du monde.
« Quand nous disons, précisera
d'ailleurs Sartre 1, que l'homme est responsable de luimême, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable
de tous les hommes.
»
Il s'ensuit que l'acte fondateur par lequel un individu décide de justifier son existence doit prendre en compte les
intérêts (moraux ou politiques) de la collectivité.
Les actes
ne possèdent pas tous la même valeur.
A chacun, dans la
situation qui est historiquement la sienne, de témoigner
d'une lucidité intellectuelle suffisante pour ne pas se
tromper2.
A cette exigence première qu'implique la liberté sartrienne s'en ajoute une seconde.
On ne peut changer
d'actes fondateurs selon les circonstances.
Une fois clairement effectué, ce choix est définitif3.
Selon Sartre, Garein
n'était pas libre de fuir.
Non seulement parce qu'il a trahi
ses propres engagements, mais aussi parce qu'en fuyant il
a trahi la cause (le pacifisme) qu'il incarnait.
Il s'est luimême exclu des valeurs que son libre choix avait prétendu
faire siennes.
Il a préféré se soumettre à la nécessité plutôt que de rester jusqu'au bout fidèle à ses idées.
Peutêtre aurait-il été tout de même fusillé, mais en homme
mourant pour ses convictions, non comme un déserteur.
Comme le lui objecte Inès, « seuls les actes décident de
ce qu'on a voulu» (p.
90).
Garein a décidé de sa lâcheté.
Il
est consciemment devenu un peureux.
Un mauvais usage de la liberté
Garein ne peut toutefois admettre cette vérité.
Aussi témoigne-t-il d'une mauvaise foi permanente pour mieux se
la masquer.
1.
Sartre, L'Existentialisme est un humànisme (Paris, Nagel, 1946,
p.
24).
2.
Sartre admet bien que la société peut totalement aliéner la
liberté d'un être et donc sa capacité d'analyse.
Mais Huis clos
n'envisage pas cette situation.
Sartre le fera dans d'autres pièces
comme La Putain respectueuse.
3.
Il n'existe donc pas pour Sartre de libertés successives.
Le
choix, une fois posé (et à condition qu'il soit effectué en fonction
de la responsabilité de l'individu à l'intérieur de la collectivité), a
par la suite valeur d'engagement définitif.
2"'1
• Une mauvaise foi permanente
La conscience de sa lâcheté lui est insupportable.
Garein
ruse en conséquence.
Il s'est construit un monde imaginaire, fait d'excuses et d'alibis.
Lui-même l'avoue presque
ingénument, quand il juge détestable le style du mobilier
de la pièce où le « garçon » vient de l'introduire.
« Après
tout, dit-il, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses; j'adorais ça» (p.
14).
Accepter une situation fausse, c'est se résigner à mentir
et à ruser avec la vérité.
Garein l'accepte d'autant plus facilement qu'il est lui-même une situation fausse : n'affectet-il pas la bravoure pour se cacher sa peur?
• Une fuite hors du réal
Il n'est pourtant pas toujours possible de mentir et de se
mentir à soi-même.
Garein réagit alors violemment.
Il menace Inès, lui ordonne de se taire lorsque celle-ci s'apprête
à dire la vérité, à savoir qu' « on ne damne jamais les gens
pour rien» (p.
40).
Pour échapper aux questions de plus en
plus pressantes de la jeune femme, Garein crie, veut se
faire ouvrir la porte (p.
85).
Son agressivité, verbale et physique, obéit à un désir de
supprimer les obstacles, non de les surmonter.
Comme
s'il suffisait de crier ou de frapper pour faire qu'une vérité
cesse d'être une vérité! Le comportement de Garein s'apparente à ce que Sartre appelle une « conduite magique »
1, c'est-à-dire la croyance illusoire qu'on peut par un tour
de passe-passe modifier le réel.
• Un sadisme compensatoire 2
Comme il ne peut admettre que, par sa tentative de fuite
à l'étranger, il a trahi son idéal pacifiste, Garein a cherché
une compensation à son manque de courage.
À défaut
d'être un héros, il s'est affirmé sur les autres, en les faisant
souffrir et en y prenant un certain plaisir.
Garein a réduit sa
femme en esclavage.
li l'a trompée, ouvertement humiliée,
contrainte de recevoir ses maîtresses (p.
53-54).
Garein
s'est comporté en bourreau, trouvant dans la torture morale
1.
Voir Sartre, Esquisse d'une théorie des émotions (Paris,
Hermann, 1939, p.
43).
Voir ci-dessous, p.
41.
2.
Sadisme : déviation sexuelle consistant à prendre plaisir d'une
cruauté infligée au partenaire.
22
qu'il infligeait à autrui la justification dérisoire de son existence.
Il était enfin le maître.
Un personnage négatif
Le vocabulaire dont use Garein révèle et résume à la fois
sa faillite morale.
Celui-ci passe en effet son temps à dire
non ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas.
La négation est
son mode préféré d'expression.
En voici quelques
exemples:
« Je ne suis pas le bourreau, madame » (p.
27).
« Je ne suis pas très joli» (p.
53).
« Je ne suis pas un petit niais et je ne danse pas le
tango» (p.
73).
«Je ne suis pas un gentilhomme et je n'aurai pas peur de
cogner sur une femme» (p.
75).
Ses tics de langage sont aussi significatifs que les tics
apeurés de son visage.
La lâcheté l'ayant empêché de devenir le héros qu'il rêvait d'être, Garein ne peut se définir
positivement.
En lui habite ce lâche qu'il veut nier et oublier.
L'«enfer», c'est d'abord cet autre qu'il;a été et qu'il
ne reconnaît pas.
Aussi s'affirme-t-il sous forme négative.
ESTELLE
La vie d'Estelle ressemble à celle d'un personnage de
mélodrame 1.
« Orpheline et pauvre» (p.
39), elle a épousé
un homme âgé et riche.
Socialement, son mariage l'a fait
accéder à la bourgeoisie.
Bénéficiant d'une vie aisée qui l'a
éblouie, elle n'accorde d'importance qu'aux apparences
confortables et rassurantes.
Un être superficiel
Comme Garein, Estelle se révèle tout entière dès son
entrée en scène.
Tout se passe comme si son arrivée en
enfer éclairait d'un seul coup sa personnalité.
Celle-ci se
définit par son inconsistance et par sa fausse morale.
l
1.
Un mélodrame est une œuvre de théâtre mettant en scène des
personnages simples, des sentiments violents, avec une volonté
d'apitoyer le spectateur.
23
• Une jeune femme inconsistante
Estelle refuse d'emblée d'affronter la situation infernale
qui est désormais la sienne.
Sa coquetterie en apporte une
première preuve.
La couleur des canapés (p.
28) et la perfection de son maquillage (p.
45) la préoccupent davantage
que sa situation.
Ses précautions verbales témoignent de
sa frivolité.
Ne préconise-t-elle pas l'emploi, pour plus de
correction, pour plus de précaution, du mot « absent » au
lieu de «mort» (p.
31)? Comme si «mort» était une grossièreté indécente entre gens bien élevés ! Ses caprices
montrent enfin qu'elle entend vivre en « enfer» comme
elle a vécu sur terre, c'est-à-dire sans réfléchir ni mesurer
la responsabilité de ses actes : « Je ne peux pas supporter
qu'on attende quelque chose de moi.
Ça me donne tout
de suite envie de faire le contraire» (p.
37).
Aussi est-elle sans épaisseur ni vie intérieure.
« Tout ce qui
se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort» (p.
44).
Sans caractère ni volonté, elle est sans conscience.
Son nom
suggère sa superficialité: Estelle peut s'écrire:« Est-elle?».
• Une fausse morale
Du même coup, elle ne se sent ni coupable ni responsable de quoi que ce soit.
Tout s'explique par la force des
choses.
La nécessité a commandé son mariage : « J'étais
orpheline et pauvre, j'élevais mon frère cadet.
Un vieil
ami de mon père m'a demandé ma main.
Il était riche et
bon, j'ai accepté» (p.
39).
Le coup de foudre, lui-même
présenté comme une fatalité, justifie son adultère : « Il y
a deux ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer.
Nous
nous sommes reconnus tout de suite» (p.
39).
Qu'elle fût libre de ne pas se marier puis de divorcer,
Estelle n'y songe pas un instant.
Elle place sa vie sous le
signe d'un déterminisme, qu'elle colore de surcroît à son
avantage.
N'explique-t-elle pas qu'elle a sacrifié sa «jeunesse
à un vieillard», qu'elle a soigné son frère malade (p.
39)?
Aussi ne se sent-elle responsable de rien.
Pas même de
l'infanticide qu'elle a commis, ni du suicide de son amant.
Sa logique est aussi implacable qu'immorale.
Puisqu'elle
ne voulait pas divorcer, il convenait de cacher l'enfant né
de sa liaison.
De le cacher à le faire disparaître, la nuance
est mince pour Estelle.
À ses yeux, la faute ne réside pas
24
dans l'acte qui l'instaure mais dans le scandale qu'elle provoque.
Or, précise-t-elle.
« personne n'a rien su» (p.
61).
Le suicide de son amant était donc stupide, puisque son
«marine s'est jamais douté de rien» (p.
62).
Estelle évolue dans un monde fondé sur la seule valeur
de l'apparence.
Il s'agit de faire « comme si ...
».
Comme si
elle n'était pas coupable.
Comme si elle ne....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓