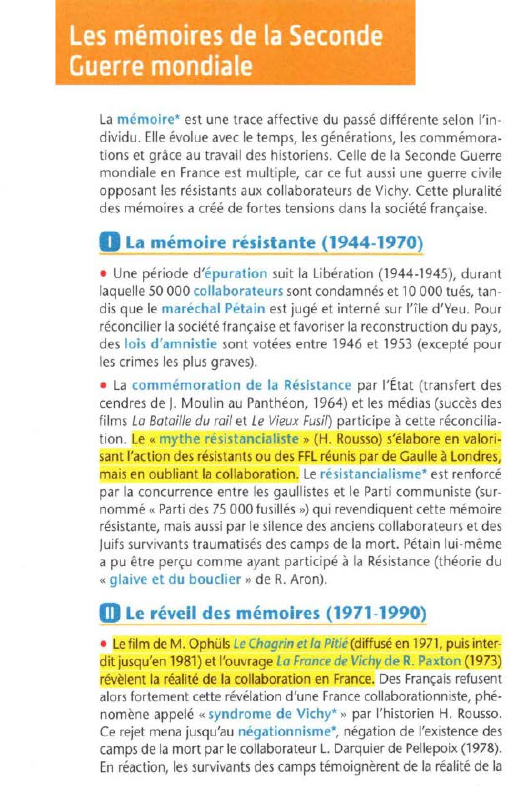Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale La mémoire* est une trace affective du passé différente selon l'individu. Elle évolue...
Extrait du document
«
Les mémoires de la Seconde
Guerre mondiale
La mémoire* est une trace affective du passé différente selon l'individu.
Elle évolue avec le temps, les générations, les commémora tions et grâce au travail des historiens.
Celle de la Seconde Guerre
mondiale en France est multiple, car ce fut aussi une guerre civile
opposant les résistants aux collaborateurs de Vichy.
Cette pluralité
des mémoires a créé de fortes tensions dans la société frança ise.
0
La mémoire résistante (1944-1970)
• Une période d'épuration suit la Libération (1944-1945), durant
laquelle 50 000 collaborateurs sont condamnés et 10 000 tués, tandis que le maréchal Pétain est jugé et interné sur l'île d'Yeu.
Pour
réconcilier la société française et favoriser la reconstruction du pays,
des lois d'amnistie sont votées entre 1946 et 1953 (excepté pour
les crimes les plus graves).
• La commémoration de la Résistance par l'État (transfert des
cendres de J.
Moulin au Panthéon, 1964) et les médias (succès des
fi lms La Bataille du rail et Le Vieux Fusil) participe à cette réconci liation.
Le « mythe résistancialist e » (H.
Rousso) s'élabore en valorisant l'action des résistants ou des FFL réunis par de Gaulle à Londres,
mais en oubliant la collaboration.
Le résistancialisme• est renforcé
par la concurrence entre les gaullistes et le Parti communiste (surnommé « Parti des 75 000 fusillés») qui revend iquent cette mémoire
résistante, mais aussi par le silence des anciens collaborateurs et des
Juifs survivants traumatisés des camps de la mort.
Pétain lui-même
a pu être perçu comme ayant participé à la Résistance (théorie du
« glaive et du bouclier » de R.
Aron).
mLe réveil des mémoires (1971 -1990)
• Le film de M.
Ophüls Le Chagrin et la Pitié (diffusé en 1971, puis inter
dit jusqu'en 1981) et l'ouvrage La France de Vichy de R.
Paxton (1973)
révèlent la réalité de la collaboration en France.
Des Français refusent
alors fortement cette révélation d'une France collaborationniste, phénomène appelé« syndrome de Vichy* » par l'historien H.
Rousse.
Ce rejet mena jusqu'au négat ionnisme*, négation de l'existence des
camps de la mort par le collaborateur L.
Darquier de Pellepoix (1978).
En réaction, les survivants des camps témoignèrent....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓