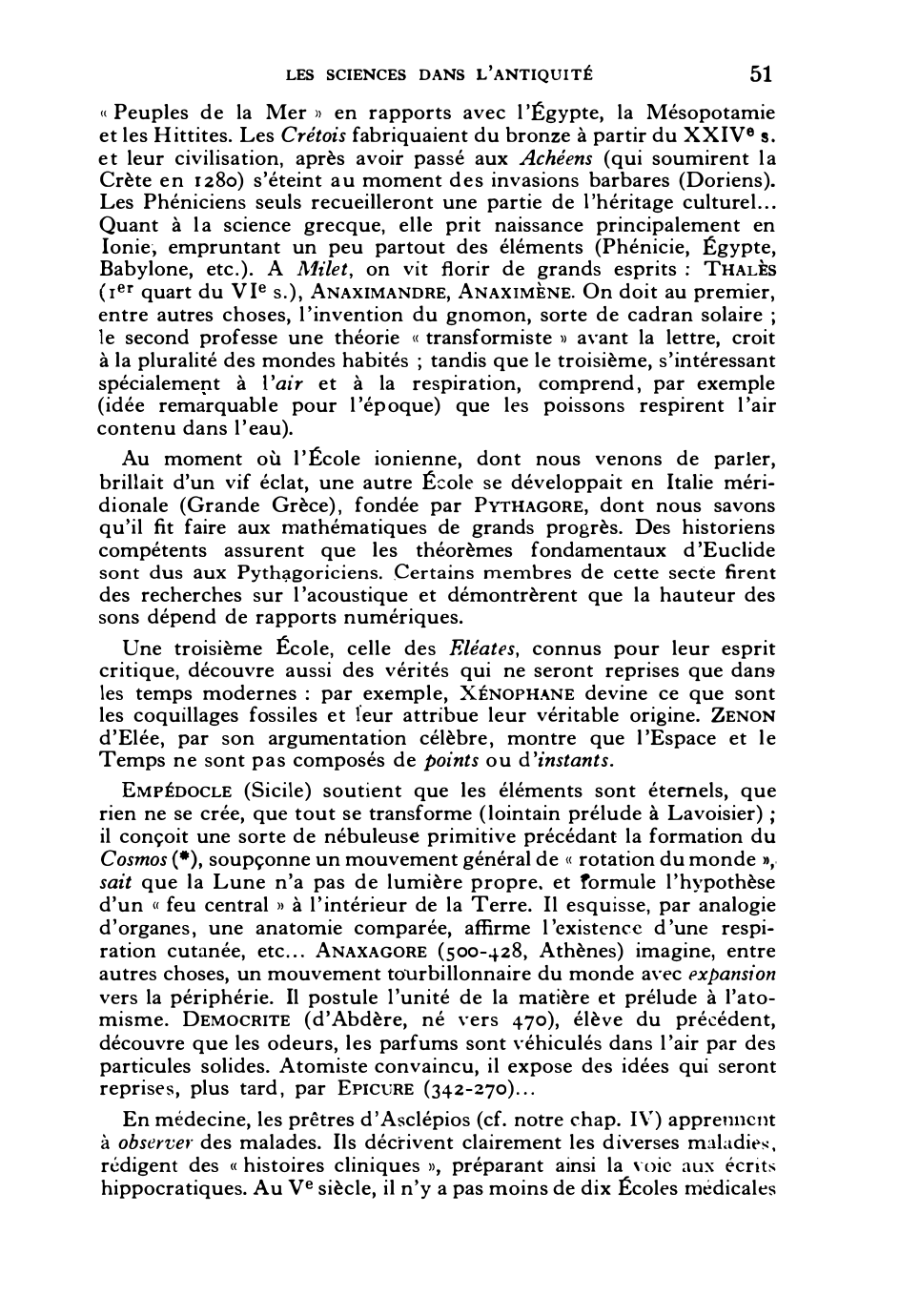Les étapes de la Science.
Publié le 12/11/2016
Extrait du document
« Peuples de la Mer » en rapports avec l’Égypte, la Mésopotamie et les Hittites. Les Crétois fabriquaient du bronze à partir du XXIVe s. et leur civilisation, après avoir passé aux Achéens (qui soumirent la Crète en 1280) s’éteint au moment des invasions barbares (Doriens). Les Phéniciens seuls recueilleront une partie de 1 ’héritage culturel... Quant à la science grecque, elle prit naissance principalement en Ionie, empruntant un peu partout des éléments (Phénicie, Égypte, Babylone, etc.). A Milet, on vit florir de grands esprits : Thalès ( 1er quart du VIe s.), Anaximandre, AnaximÈne. On doit au premier, entre autres choses, l’invention du gnomon, sorte de cadran solaire ; le second professe une théorie « transformiste » avant la lettre, croit à la pluralité des mondes habités ; tandis que le troisième, s’intéressant spécialement à 1 ’air et à la respiration, comprend, par exemple (idée remarquable pour l’époque) que les poissons respirent l’air contenu dans l’eau).
Au moment où l’École ionienne, dont nous venons de parler, brillait d’un vif éclat, une autre École se développait en Italie méridionale (Grande Grèce), fondée par Pythagore, dont nous savons qu’il fit faire aux mathématiques de grands progrès. Des historiens compétents assurent que les théorèmes fondamentaux d’Euclide sont dus aux Pythagoriciens. Certains membres de cette secte firent des recherches sur l’acoustique et démontrèrent que la hauteur des sons dépend de rapports numériques.
Une troisième École, celle des Eléates, connus pour leur esprit critique, découvre aussi des vérités qui ne seront reprises que dans les temps modernes : par exemple, XÉNOPHANE devine ce que sont les coquillages fossiles et leur attribue leur véritable origine. Zenon d’Elée, par son argumentation célèbre, montre que l’Espace et le Temps ne sont pas composés de points ou d'instants.
Empédocle (Sicile) soutient que les éléments sont éternels, que rien ne se crée, que tout se transforme (lointain prélude à Lavoisier) ; il conçoit une sorte de nébuleuse primitive précédant la formation du Cosmos, soupçonne un mouvement général de « rotation du monde »,, sait que la Lune n’a pas de lumière propre. et formule l’hypothèse d’un “ feu central >> à l’intérieur de la Terre. Il esquisse, par analogie d’organes, une anatomie comparée, affirme l’existence d’une respiration cutanée, etc... Anaxagore (500-428, Athènes) imagine, entre autres choses, un mouvement tourbillonnaire du monde avec expansion vers la périphérie. Il postule l’unité de la matière et prélude à l’ato-misme. Democrite (d’Abdère, né vers 470), élève du précédent, découvre que les odeurs, les parfums sont véhiculés dans l’air par des particules solides. Atomiste convaincu, il expose des idées qui seront reprises, plus tard, par Epicure (342-270)...
En médecine, les prêtres d’Asclépios (cf. notre chap. IV) apprennent à observer des malades. Ils décrivent clairement les diverses maladies, rédigent des « histoires cliniques », préparant ainsi la voie aux écrits hippocratiques. Au Ve siècle, il n’y a pas moins de dix Écoles médicales
1. — LES SCIENCES DANS L'ANTIQUITÉ.
Dans l’exposé qui suit, nous avons seulement dessein de tracer les grandes lignes de l’évolution des idées. Il ne saurait donc s’agir d’un « historique » proprement dit, qui nous entraînerait en de trop longs développements, hors de proportion avec les dimensions de notre “ Guide », Nous avons tenu, quand même, à fournir aux étudiants certaines précisions intéressantes, dont on ne trouve la relation que dans des ouvrages spécialisés. Nous pensons que ce n’est pas inutile pour bien comprendre le passage de la Science d’hier à la Science d’aujourd’hui.
1. — L'Egypte.
Ce fut l'une des premières civilisations. L’Inde et la Chine lui sont peut-être antérieures ; mais ce n'est pas certain. A. MoRET place les premières dynasties plus de 42 siècles avant J. C.
Quelles étaient les connaissances scientifiques des anciens Égyptiens ? Bien avant les débuts de la science grecque, on trouve des manuscrits traitant de questions mathématiques (vers i66o av. J. C.). D’autres sont consacrés à la médecine (où se mêle beaucoup de magie), à la pharmacopée. La géométrie, la géodésie surtout, sont soigneusement étudiées. Nous savons pourquoi (bornage des terres après les inondations annuelles du Nil). En astronomie, les Égyptiens sont loin d’égaler les Babyloniens. D’une manière générale, on a beaucoup exagéré la valeur des connaissances scientifiques de ce peuple. Ce qu'ils avaient d'admirable, c’était avant tout, leurs techniques nombreuses- (architecture, constructions navales, tissages, fonte et travail des métaux...).
2. — La Chaldée. Babylone.
C’est, nous l’avons déjà signalé, l'astronomie qui fut spécialement cultivée dans ces contrées. De véritables « observatoires » y étaient construits, atteignant jusqu’à cent mètres de haut. Pour calculer plus commodément, on avait réalisé des tables de multiplication et de division. Si l’astronomie acquit tout son éclat vers le VIIe s. av. J.C., de remarquables techniques existaient dès le XXXe siècle (alliages, émaux, etc...).
3 — La Grèce.
Précédant la civilisation grecque, une grande civilisation s’était antérieurement développée, à partir du XXXe s. Civilisation des
«
LES
SCIENCES DANS L'ANTIQUITÉ
51
" Peuples de la Mer " en rapports avec l'Égypte, la Mésopotamie
et les Hittites.
Les Crétois fabriquaient du bronze à partir du XX IVe s.
et leur civilisation, après avoir passé aux Achéens (qui soumirent la
Crète en r28o) s'éteint au moment des invasions barbares (Doriens).
Les Phéniciens seuls recueilleront une partie de 1 'hér itage cultur el...
Quant à la science grecque, elle prit naissance principalement en
Ionie; empruntant un peu partout des éléments (Phénicie, Égypte,
Babylone, etc.).
A ]',fil et, on vit florir de grands esprits : THALÈS
( rer quart du VI• s.), ANAXIMANDRE, ANAXIMÈNE.
On doit au premier,
entre autres choses, l'invention du gnomon, sorte de cadran solaire ;
le second professe une théorie " transform iste " avant la lettre, croit
à la pluralité des mondes habités ; tandis que le troisième, s'intéressant
spécialement à 1 'air et à la respiration, comprend, par exemple
(idée remarquab le pour l'ép oque) que les poissons respirent l'air
contenu dans l'eau).
Au moment où l'École ionienne, dont nous venons de parler,
brillait d'un vif éclat, une autre École se développait en Italie méri
dio nale (Grande Grèce), fondée par PYTHAGO RE, dont nous savons
qu'il fit faire aux mathématiques de grands progrès.
Des historiens
compétents assurent que les théorèmes fondamentaux d'Euclide
sont dus aux Pythago riciens.
Certains membres de cette secte firent
des recherches sur l'acoustique et démontrèrent que la hauteur des
sons dépend de rapports numériques.
Une troisième École, celle des Eléates, connus pour leur esprit
critique, découvre aussi des vérités qui ne seront reprises que dans
les temps modernes : par exem ple, XÉNOPH .-\NE devine ce que sont
les coquil lages fossiles et feur attribue leur véritable origine.
ZENON
d'E lée, par son argum entation célèbre, montre que l'Espace et le
Temps ne sont pas composés de points ou d'insta nts.
EMPÉ DOCLE (Sicile) soutient que les éléments sont éternels, que
rien ne se crée, que tout se transforme (lointain prélude à Lavoisier) ;
il conçoit une sorte de nébuleuse primitive précédant la formation du
Cosmos (•), soupçonne un mouvement général de " rotation du monde »,,
sait que la Lune n'a pas de lumière propre.
et formule l'hypothèse
d'un "feu central >> à l'intérieur de la Terre.
Il esquisse, par analogie
d'o rgane s, une anatomie comparée, affirme l'existence d'une respi
ration cutanée, etc ..
.
ANAXAGORE (500-428, Athènes) imagine, entre
autres choses, un mouvement tourbi llonnaire du monde avec Pxpansion
vers la périphérie.
Il postule 1 'unité de la matière et prélude à l'ato
misme.
DEMOCRITE (d'Abdère, né vers 470), élève du précédent,
découvre que les odeurs, les parfums sont véhiculés dans l'air par des
particules solides.
Atomiste convaincu, il expose des idées qui seront
repris es, plus tard, par EPICURE (342-270) ...
En médecine, les prêtres d'Asclépios (cf.
notre chap.
IV) apprennent
à observer des malades.
Ils décrivent clair ement les diverses maladit>s ,
rédigent des " histoires cliniques "• préparant ainsi la Hlic aux écrits
hippocratiques.
Au V• siècle, il n'y a pas moins de dix Écoles médicales.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA SCIENCE DE LA LANGUE ET LE STRUCTURALISME
- Peut-on tout attendre de la science ?
- La science ne vise-t-elle que la satisfaction de notre désir de savoir ?
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?
- Exposé philosophique: Science et Technique