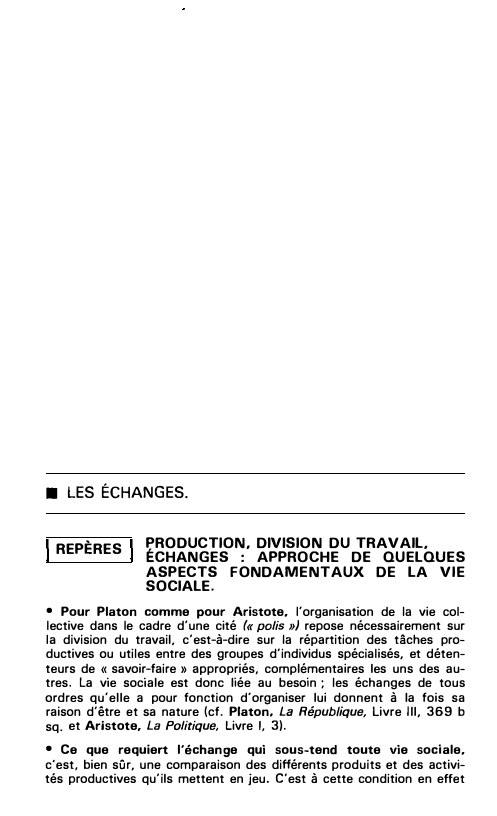■ LES ÉCHANGES. REPÈRES PRODUCTION, DIVISION DU TRAVAIL. ÉCHANGES : APPROCHE DE QUELQUES ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA VIE SOCIALE. •...
Extrait du document
«
■ LES ÉCHANGES.
REPÈRES
PRODUCTION, DIVISION DU TRAVAIL.
ÉCHANGES : APPROCHE DE QUELQUES
ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA VIE
SOCIALE.
• Pour Platon comme pour Aristote, l'organisation de la vie col
lective dans le cadre d'une cité (« polis ») repose nécessairement sur
la division du travail, c'est-à-dire sur la répartition des tâches pro
ductives ou utiles entre des groupes d'individus spécialisés, et déten
teurs de « savoir-faire » appropriés, complémentaires les uns des au
tres.
La vie sociale est donc liée au besoin ; les échanges de tous
ordres qu'elle a pour fonction d'organiser lui donnent à la fois sa
raison d'être et sa nature (cf.
Platon, La République, Livre Ill, 369 b
sq.
et Aristote, La Politique, Livre 1, 3).
• Ce que requiert l'échange qui sous-tend toute vie sociale,
c· est, bien sûr, une comparaison des différents produits et des activi
tés productives qu'ils mettent en jeu.
C'est à cette condition en effet
que les produits peuvent devenir des « marchandises » et concrétiser,
par leur circulation dans l'ensemble du corps social, la complémenta
rité des tâches accomplies par les différents producteurs.
Cf.
Aris
tote, Éthique à Nicomaque, V, s.
1133 :
« On ne fait pas en effet une communauté avec deux méde
cins, mais avec un médecin et un laboureur, et en général
entre des travaux différents et inégaux : et il faut pourtant les
égaliser.
»
• Au-delà de son acception économique.
la notion d'échanges
peut recevoir une signification plus étendue dès qu'on envisage les
relations de tous ordres qui existent entre les hommes : dans le
dialogue rationnel, dans la mutuelle reconnaissance des consciences,
dans l'idée même de communauté humaine, les échanges ont comme
double condition de possibilité la reconnaissance d'une commune ap
partenance à un même groupe et la reconnaissance du « droit à la
différence».
La communication authentique qui peut s'établir entre
les hommes doit en effet nécessairement les supposer membres
d'une même communauté, tout en permettant l'expression de leurs
différences.
Mais ces dernières ne peuvent être exacerbées au point
d'enfermer les individus dans les bornes strictes de leur singularité ce qui rendrait impossible toute communication.
• L'analyse par Aristote du fonctionnement des échanges et de
ses implications l'a conduit à réfléchir sur la distinction entre « les
deux usages» d'une marchandise et sur la genèse de la monnaie.
On
pourra, pour approfondir la réflexion sur ce sujet, reprendre deux
extraits célèbres de l'œuvre d'Aristote ;
La Politique, livre 1, 9 {Êditions Vrin ou Médiations).
On trouve
dans ce passage la fameuse distinction entre les (< deux usages diffé
rents» d'une chose : la consommation pour satisfaire un besoin et
l'échange · « Chacune des choses dont nous sommes propriétaires
est susceptible de deux usages.différents : l'un comme l'autre appar
tiennent à la chose en tant que telle, mais ne lui appartiennent pas
de la même manière.
L'un est l'usage propre de la chose, et l'autre
est étranger à son usage propre...
» (c'est nous qui soulignons).
Cf.
traduction Tricot, Éditions Vrin, pages 56 et 57.
La suite du texte expose la distinction fondamentale entre les
deux formes de la « chrématistique» (mot à mot, en grec : art d'ac
quérir les richesses, du grec « krémata !>, les affaires, l'argent) : éco
nomie domestique (production) et négoce, qui, dit Aristote.
« n'est
pas par nature une partie de la chrématistique» (ce qui signifie qu'il
le devient par convention, comme notre texte l'indique).
- Éthique....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓