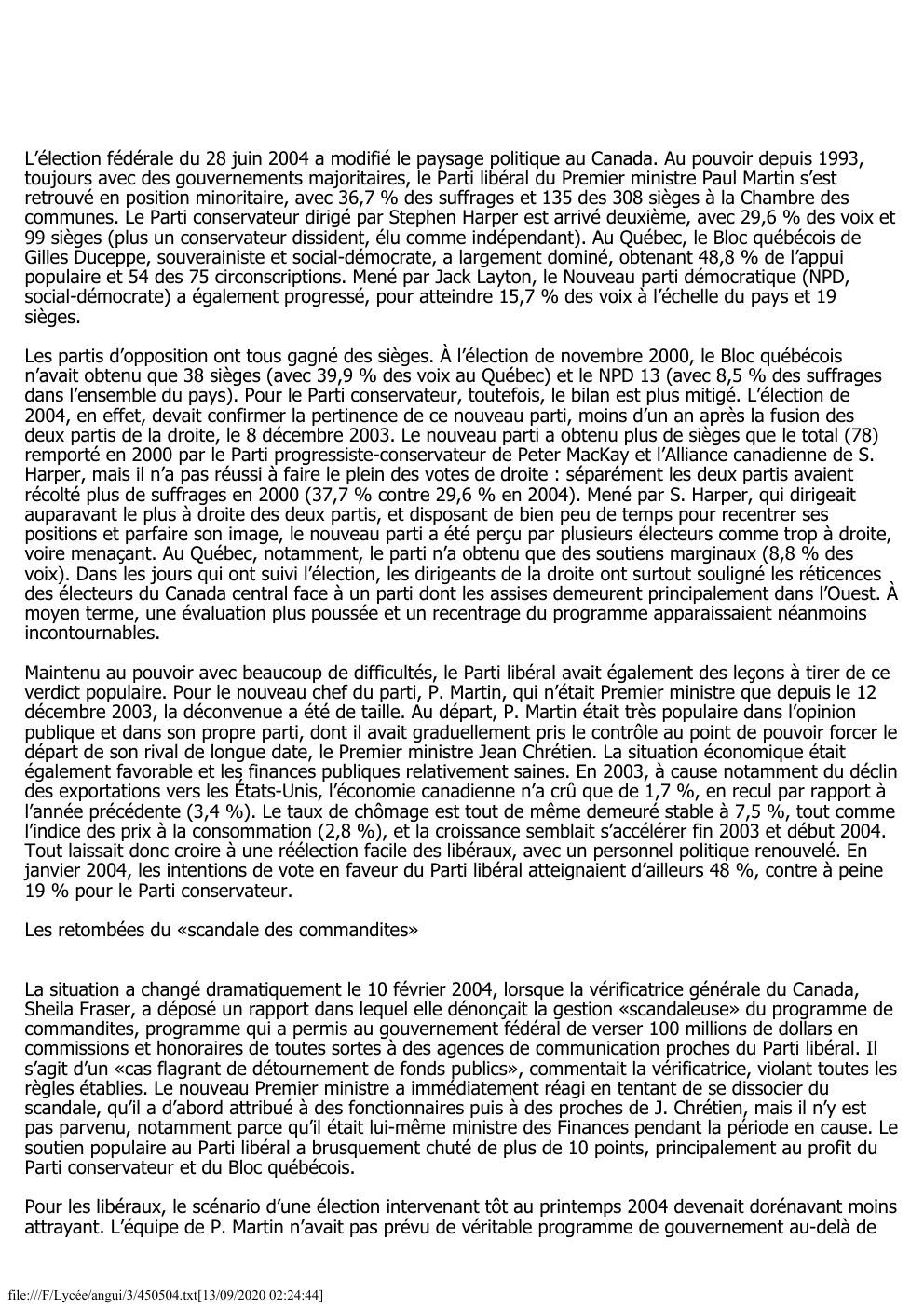L’élection fédérale du 28 juin 2004 a modifié le paysage politique au Canada. Au pouvoir depuis 1993, toujours avec des...
Extrait du document
«
L’élection fédérale du 28 juin 2004 a modifié le paysage politique au Canada.
Au pouvoir depuis 1993,
toujours avec des gouvernements majoritaires, le Parti libéral du Premier ministre Paul Martin s’est
retrouvé en position minoritaire, avec 36,7 % des suffrages et 135 des 308 sièges à la Chambre des
communes.
Le Parti conservateur dirigé par Stephen Harper est arrivé deuxième, avec 29,6 % des voix et
99 sièges (plus un conservateur dissident, élu comme indépendant).
Au Québec, le Bloc québécois de
Gilles Duceppe, souverainiste et social-démocrate, a largement dominé, obtenant 48,8 % de l’appui
populaire et 54 des 75 circonscriptions.
Mené par Jack Layton, le Nouveau parti démocratique (NPD,
social-démocrate) a également progressé, pour atteindre 15,7 % des voix à l’échelle du pays et 19
sièges.
Les partis d’opposition ont tous gagné des sièges.
À l’élection de novembre 2000, le Bloc québécois
n’avait obtenu que 38 sièges (avec 39,9 % des voix au Québec) et le NPD 13 (avec 8,5 % des suffrages
dans l’ensemble du pays).
Pour le Parti conservateur, toutefois, le bilan est plus mitigé.
L’élection de
2004, en effet, devait confirmer la pertinence de ce nouveau parti, moins d’un an après la fusion des
deux partis de la droite, le 8 décembre 2003.
Le nouveau parti a obtenu plus de sièges que le total (78)
remporté en 2000 par le Parti progressiste-conservateur de Peter MacKay et l’Alliance canadienne de S.
Harper, mais il n’a pas réussi à faire le plein des votes de droite : séparément les deux partis avaient
récolté plus de suffrages en 2000 (37,7 % contre 29,6 % en 2004).
Mené par S.
Harper, qui dirigeait
auparavant le plus à droite des deux partis, et disposant de bien peu de temps pour recentrer ses
positions et parfaire son image, le nouveau parti a été perçu par plusieurs électeurs comme trop à droite,
voire menaçant.
Au Québec, notamment, le parti n’a obtenu que des soutiens marginaux (8,8 % des
voix).
Dans les jours qui ont suivi l’élection, les dirigeants de la droite ont surtout souligné les réticences
des électeurs du Canada central face à un parti dont les assises demeurent principalement dans l’Ouest.
À
moyen terme, une évaluation plus poussée et un recentrage du programme apparaissaient néanmoins
incontournables.
Maintenu au pouvoir avec beaucoup de difficultés, le Parti libéral avait également des leçons à tirer de ce
verdict populaire.
Pour le nouveau chef du parti, P.
Martin, qui n’était Premier ministre que depuis le 12
décembre 2003, la déconvenue a été de taille.
Au départ, P.
Martin était très populaire dans l’opinion
publique et dans son propre parti, dont il avait graduellement pris le contrôle au point de pouvoir forcer le
départ de son rival de longue date, le Premier ministre Jean Chrétien.
La situation économique était
également favorable et les finances publiques relativement saines.
En 2003, à cause notamment du déclin
des exportations vers les États-Unis, l’économie canadienne n’a crû que de 1,7 %, en recul par rapport à
l’année précédente (3,4 %).
Le taux de chômage est tout de même demeuré stable à 7,5 %, tout comme
l’indice des prix à la consommation (2,8 %), et la croissance semblait s’accélérer fin 2003 et début 2004.
Tout laissait donc croire à une réélection facile des libéraux, avec un personnel politique renouvelé.
En
janvier 2004, les intentions de vote en faveur du Parti libéral atteignaient d’ailleurs 48 %, contre à peine
19 % pour le Parti conservateur.
Les retombées du «scandale des commandites»
La situation a changé dramatiquement le 10 février 2004, lorsque la vérificatrice générale du Canada,
Sheila Fraser, a déposé un rapport dans lequel elle dénonçait la gestion «scandaleuse» du programme de
commandites, programme qui a permis au gouvernement fédéral de verser 100 millions de dollars en
commissions et honoraires de toutes sortes à des agences de communication proches du Parti libéral.
Il
s’agit d’un «cas flagrant de détournement de fonds publics», commentait la vérificatrice, violant toutes les
règles établies.
Le nouveau Premier ministre a immédiatement réagi en tentant de se dissocier du
scandale, qu’il a d’abord attribué à des fonctionnaires puis à des proches de J.
Chrétien, mais il n’y est
pas parvenu, notamment parce qu’il était lui-même ministre des Finances pendant la période en cause.
Le
soutien populaire au Parti libéral a brusquement chuté de plus de 10 points, principalement au profit du
Parti conservateur et du Bloc québécois.
Pour les libéraux, le scénario d’une élection intervenant tôt au printemps 2004 devenait dorénavant moins
attrayant.
L’équipe de P.
Martin n’avait pas prévu de véritable programme de gouvernement au-delà de
file:///F/Lycée/angui/3/450504.txt[13/09/2020 02:24:44]
quelques mois et anticipait aussi des difficultés accrues à l’automne.
Elle décida donc d’organiser l’élection
au début de l'été, au-delà de la limite traditionnellement associée à la fin de l’année scolaire.
Or, P.
Martin n’a jamais réussi à se défaire du «scandale des commandites», qui a miné sa crédibilité
partout dans le pays, et n’a pas fait une très bonne campagne.
À quelques jours de l’échéance, les
conservateurs voyaient même poindre la possibilité d’une victoire.
En fin de campagne, cependant, les
libéraux ont repris pied, développant un discours très négatif envers S.
Harper et son parti.
Au Québec,
les attaques libérales ont eu moins d’effet puisque le discours du Bloc québécois, qui se présentait comme
un «parti propre au Québec», correspondait assez bien aux attentes des électeurs.
Son chef, G.
Duceppe,
a également fait une excellente campagne, et rehaussé son statut sur la scène politique québécoise.
C’est
donc de justesse, et presque sans le Québec, que les libéraux se sont finalement maintenus....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓