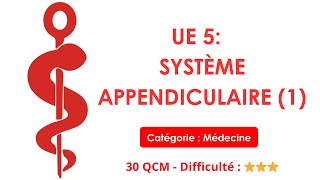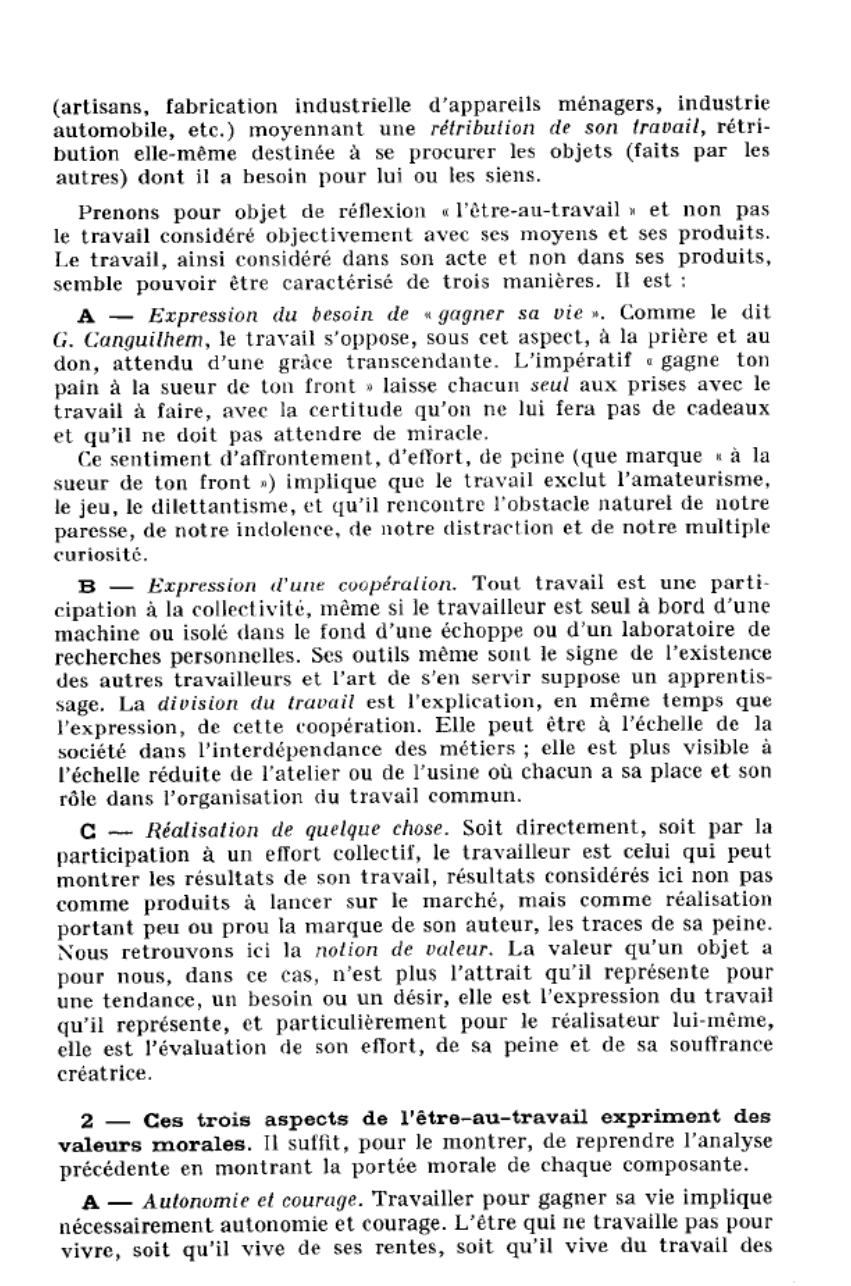autres, soit qu’il ait une vie protégée pour quelque raison (fragilité, maladie, enfant gâté), soit qu’il vive de lu charité publique, est un être dépendant dont l’existence est, plus ou moins valablement et durablement, liée à la stabilité et à la permanence des moyens extrinsèques dont il tire ses ressources.
Que demain la banqueroute, fasse fondre les rentes et les retraites, que les autres cessent de travailler, que le cadre protecteur disparaisse, et voilà notre homme condamné à mourir de misère s'il ne se retrouve pas personnellement comme être-au travail (1). Il ne manque pas d’exemples de nobles chassés, de rois détrônés, d’industriels en faillite, de rentiers ruinés, pour illustrer que travailler signifie autonomie et courage. — Ne pas travailler signifie dépendance et manque de forces ou de courage. C’est là le sens de la formule proverbiale « Le travail, c’est la liberté «.
B — Justice. Il suffit que nous vivions pour que nous utilisions les produits du travail des autres, par le jeu même de la vie en société et de la division du travail, et donc pour que nous profitions du travail d’autrui. Notre travail sera la contre-partie de cette mise à contribution d’autrui, le paiement de notre dette envers la collectivité. Le travail est donc le prix dont nous payons le service social que nous recevons des autres à chaque instant. Travailler est donc un acte de simple justice commutative. L'oisif est injuste parce qu’il est parasite. Le sentiment aigu de l'injustice de l’oisiveté a poussé des auteurs comme Rousseau, ou, de nos jours, Raymond Ruyer (art. « Métaphysique du Travail ») ou Jules Vuillemin (L’Être et le Travail), à contester la légitimité de tout refus de travailler et, par là, à dénoncer comme immorale l’idée même de «loisir ». Cette position est logique seulement dans la mesure où l’on identifie « être » et « travailler Mais le loisir n’est pas l’oisiveté, car « loisir » suppose « travail » dont il est suspension provisoire. A lui s’applique la formule schopenhauerienne du plaisir comme arrêt de la peine. Le véritable loisir est une jouissance esthétique de la vie et de la nature, du mouvement et du talent personnel. C’est ce que ne doivent pas oublier les « organisateurs des loisirs ». En ce sens, le loisir est opposé au loisir tel que le concevait Aristote,pour qui il était libération du travail en vue de l’exercice de la pure réflexion (le loisir devenait le moyen de la pensée philosophique, il était * le temps libre « d’un nouveau service, et justifiait l’esclavage, pour Aristote, puisqu’il fallait bien que d’autres travaillent à produire des choses essentielles à la vie matérielle). C’est d’ailleurs précisément cette conception du travail et du loisir que dénonce Vuillemin.
C — Réalisation d’une œuvre. « L’œuvre qui monte à la réalité par le libre effort de l’homme lui révèle le pouvoir qui l’apparente le plus
LE TRAVAIL
Notre participation sociale s’exprime par le travail, celui-ci étant entendu comme contribution à la vie collective et au bien commun.
L’acceptation du travail est acceptation d’un rôle social, avec tout ce qu’il implique de » comportement prescrit » (ou « comportement technologique ») et (l’obligation. C’est d’ailleurs le refus du travail comme rôle social qui caractérise les diverses iormes de la dissocialité. Il est remarquable en effet qu’en cas de dissocialité active (celle des délinquants et criminels, par opposition à la dissocialité passive des clochards et de certains beatniks et hippies), les individus dissociaux travaillent beaucoup (préparation d'un « coup », répétition, fabrication de fausse monnaie, laboratoires chimiques de fabrication de la drogue, etc.) mais ce travail exclut le rôle social et a pour objectif la main mise délictueuse sur les biens convoités.
Nous étudierons le Travail d’abord du point de vue anthropologique et ensuite du point de vue économique.
— I — Le travail du point de vue anthropologique.
Dès l’apparition de l’espèce humaine, dans les traces laissées par la préhistoire, on constate les signes d'un travail humain : modification de l’environnement écologique, constructions, fabrication d’outils, sépultures, œuvres d’art, etc.
C’est dans le travail et par le travail que les Hommes mesurent leurs possibilités et leurs limites, qu'ils s’affirment en triomphant du réel et des éléments, en modelant et en rectifiant l’environnement. L’Homme se crée lui-même d’une part en contribuant à l'existence des autres dans le cadre social indépassable de son existence, d'autre part en réalisant quelque chose qui n’existait pas avant lui.
Dans « L’Être et le Travail » (1949), Jules Vuillemin écrit : « Le vouloir qui ne veut pas exile l’Homme de son entreprise essentielle : se faire... Si l’Histoire a un sens, c’est à la condition d’emprunter son principe suprême à l’activité par laquelle l’homme crée le destin collectif de son espèce. Je travaille donc je suis ».
1 — L’ètre-au-travail.
L’être qui travaille cherche d’abord à se procurer des objets destinés à satisfaire ses besoins (le cultivateur qui sème, laboure, récolte) ou à satisfaire les besoins des autres
outillage, sont privés, c’est-à-dire appartiennent à des particuliers ; ces particuliers •— les capitalistes — ont la propriété absolue des moyens de production et des produits. Pour passer des moyens de production aux produits fabriqués, il faut le travail. Les capitalistes achètent le travail en louant des travailleurs qu'ils rétribuent (soit par convention personnelle entre eux et les travailleurs, soit conformément aux lois et conventions collectives) en ayant le droit d’embaucher et de licencier en fonction de leurs intérêts.
B — Les méfaits du capitalisme. Sans reprendre ici l’analyse polémique du capitalisme par le marxisme, exposée ailleurs, nous soulignerons ses effets principaux :
Il freine la rétribution du travail, ce qui est logique dans un système qui vise le profit capitaliste, et, par là, est responsable d’une distance économique croissante entre le petit groupe qui a les profits, et la masse des travailleurs qui ont le minimum vital, aboutissant ainsi à la séparation des classes,
Il est responsable du chômage. Pour accroître ses prolits en diminuant la somme globale des salaires, le capitalisme augmente le machinisme et diminue le personnel ouvrier. Par là « il cherche à transformer les salaires en dividendes « (Schuhl, « Machinisme et Philosophie », 1938). Le licenciement des ouvriers aboutit au chômage, plaie sociale et plaie morale.
Il est responsable de crises économiques dont le premier genre est la crise de surproduction. On aboutit en effet à ce paradoxe douloureux de voir l’abondance de la production, et sa non-consommation par suite de la misère du plus grand nombre. Le second genre de crise est la ruine et la disparition des petites et moyennes entreprises, la faillite des « classes moyennes » prises entre les « trusts » (ou associations de capitalistes pour s’emparer des marchés) et le prolétariat.
Il aboutit à l’impérialisme capitaliste. Les produits de la surproduction n’étant pas consommés et les prix devant être maintenus pour maintenir le profit, le capitalisme se lance à la conquête des marchés étrangers. Il doit, pour cela, faire de l’État son complice et orienter la politique, la diplomatie, voire l’intervention militaire.
C — Les transformations du capitalisme. Depuis un quart de siècle, le capitalisme évolue et il est maintenant sensiblement différent du capitalisme du xixe siècle décrit par Karl Marx.
Les limitations de la liberté capitaliste. Toute une série de réformes et de droits nouveaux sont nés de la protestation contre les méfaits du capitalisme. Déjà de 1864 à 1910, les travailleurs obtenaient le droit de grève et le Code du travail; en 1936, la limitation du temps de travail (semaine légale de 40 heures) et les garanties des contrats collectifs (congés annuels, congés payés) ; en 1946, la sécurité sociale et les allocations familiales; enfin le salaire minimum de base fait l’objet d’une convention collective qui met le salaire en rapport constant avec le coût de la vie (échelle mobile des salaires). De 1946