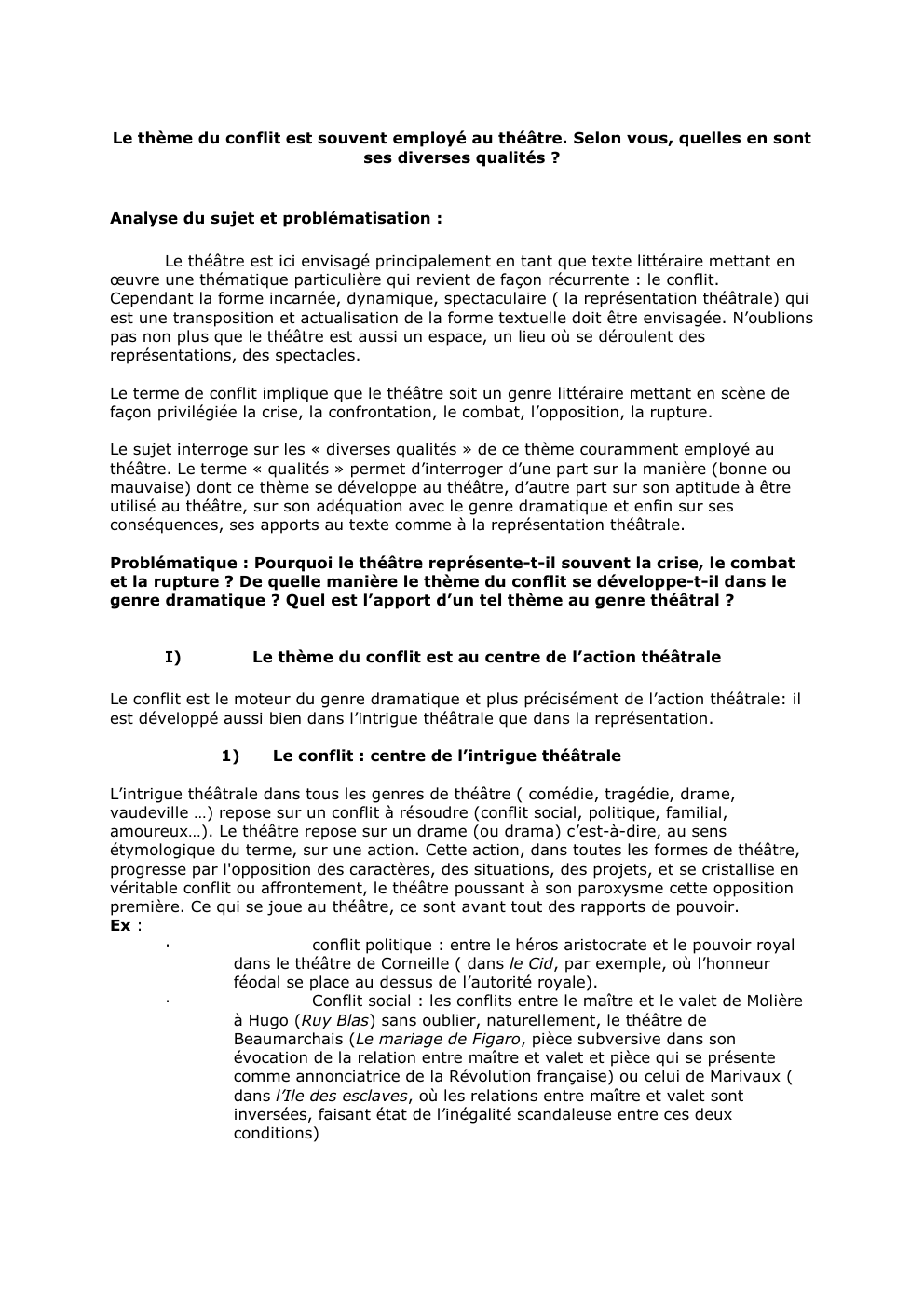Le thème du conflit est souvent employé au théâtre. Selon vous, quelles en sont ses diverses qualités ? Analyse du...
Extrait du document
«
Le thème du conflit est souvent employé au théâtre.
Selon vous, quelles en sont
ses diverses qualités ?
Analyse du sujet et problématisation :
Le théâtre est ici envisagé principalement en tant que texte littéraire mettant en
œuvre une thématique particulière qui revient de façon récurrente : le conflit.
Cependant la forme incarnée, dynamique, spectaculaire ( la représentation théâtrale) qui
est une transposition et actualisation de la forme textuelle doit être envisagée.
N’oublions
pas non plus que le théâtre est aussi un espace, un lieu où se déroulent des
représentations, des spectacles.
Le terme de conflit implique que le théâtre soit un genre littéraire mettant en scène de
façon privilégiée la crise, la confrontation, le combat, l’opposition, la rupture.
Le sujet interroge sur les « diverses qualités » de ce thème couramment employé au
théâtre.
Le terme « qualités » permet d’interroger d’une part sur la manière (bonne ou
mauvaise) dont ce thème se développe au théâtre, d’autre part sur son aptitude à être
utilisé au théâtre, sur son adéquation avec le genre dramatique et enfin sur ses
conséquences, ses apports au texte comme à la représentation théâtrale.
Problématique : Pourquoi le théâtre représente-t-il souvent la crise, le combat
et la rupture ? De quelle manière le thème du conflit se développe-t-il dans le
genre dramatique ? Quel est l’apport d’un tel thème au genre théâtral ?
I)
Le thème du conflit est au centre de l’action théâtrale
Le conflit est le moteur du genre dramatique et plus précisément de l’action théâtrale: il
est développé aussi bien dans l’intrigue théâtrale que dans la représentation.
1)
Le conflit : centre de l’intrigue théâtrale
L’intrigue théâtrale dans tous les genres de théâtre ( comédie, tragédie, drame,
vaudeville …) repose sur un conflit à résoudre (conflit social, politique, familial,
amoureux…).
Le théâtre repose sur un drame (ou drama) c’est-à-dire, au sens
étymologique du terme, sur une action.
Cette action, dans toutes les formes de théâtre,
progresse par l'opposition des caractères, des situations, des projets, et se cristallise en
véritable conflit ou affrontement, le théâtre poussant à son paroxysme cette opposition
première.
Ce qui se joue au théâtre, ce sont avant tout des rapports de pouvoir.
Ex :
·
conflit politique : entre le héros aristocrate et le pouvoir royal
dans le théâtre de Corneille ( dans le Cid, par exemple, où l’honneur
féodal se place au dessus de l’autorité royale).
·
Conflit social : les conflits entre le maître et le valet de Molière
à Hugo (Ruy Blas) sans oublier, naturellement, le théâtre de
Beaumarchais (Le mariage de Figaro, pièce subversive dans son
évocation de la relation entre maître et valet et pièce qui se présente
comme annonciatrice de la Révolution française) ou celui de Marivaux (
dans l’Ile des esclaves, où les relations entre maître et valet sont
inversées, faisant état de l’inégalité scandaleuse entre ces deux
conditions)
·
Conflit amoureux : le cercle infernal de la passion amoureuse
dans les tragédie de Racine où l’amour est toujours en crise car non
partagé.
2)
Le dialogue conflictuel au théâtre
Le théâtre est un genre littéraire fondé sur la parole.
L'action est transposée dans la
parole notamment par le dialogue.
Cette dimension dialogique permet au théâtre une
confrontation de thèses et d’opinions.
Le conflit théâtral est donc avant tout dialogique,
intellectuel : c’est un affrontement par le Verbe soulignant souvent un combat existentiel.
Ex par excellence de ce conflit dialogique et verbal : la scène d’agôn qui présente
l’affrontement de deux héros par le combat et/ou par la parole.
Cf.
Œdipe Roi de
Sophocle : la scène d’affrontement entre Œdipe et Créon ( face à face prenant la forme
d’un débat judiciaire à montrer quels outils littéraires et dialogiques créent cet effet
d’affrontement.)
3)
La représentation théâtrale : une actualisation du conflit
La représentation figure, actualise le conflit mis en place dans l’intrigue et accentue
son ampleur.
Le conflit n’est plus seulement littéraire et dialogique : il est présenté
concrètement sur la scène du théâtre et n’échappe pas à un certain effet de réel, même si
le spectateur sait bien que la représentation théâtrale est un artifice ne pouvant se
confondre avec la réalité.
Dans tous les cas, s’il n’y a pas effet de réel dans la
représentation théâtrale, il y a du moins un effet d’image, de figuration qui marque l’esprit
du spectateur du fait de son aspect visuel.
Ex :
·
Figuration sur la scène du crime (aboutissement irréversible du
conflit)dans nombre de pièces de Jean Genet : cf.
Les Bonnes ou Haute
Surveillance ( violence du crime à chaque fois) à expliquer la façon dont
la mise en acte des didascalies permet une figuration des affrontements
sur scène qui a un impact fort sur le spectateur.
II)
La thématique du conflit dans le texte dramatique : une
figuration du conflit scène/salle ou représentation/public
Le théâtre apparaît comme lieu de rupture à travers un affrontement qui se joue
entre la scène et les spectateurs.
Le thème du conflit est donc présent dans la matérialité
même de la salle de théâtre.
Le thème du conflit actualise donc la rupture fondamentale
entre le public et la représentation théâtrale.
1)
Le rapport frontal entre scène et salle
Le rapport frontal, le vis à vis entre les comédiens sur la scène et le public dans la
salle peut se présenter comme un rapport d’affrontement et de rupture.
»).
Cette rupture
est marquée de façon symbolique par la ligne imaginaire séparant la salle de la scène.
Cette ligne imaginaire témoigne de la nécessité pour le spectateur de prendre conscience
de la rupture entre ce qui est représenté sur scène et sa propre vie.
Elle sert souvent à
désamorcer l’illusion scénique.
Même lorsque cette rupture semble désamorcée, par des
répliques adressées au public notamment ( apartés), elle témoigne de l’affrontement à
l’œuvre et de la séparation entre le public et la scène, rappelant de façon brutale, voire
agressive au spectateur qu’il n’est justement qu’un spectateur.
Ex : La tirade finale d’Irma dans Le Balcon de Jean Genet, tirade adressée aux
spectateurs leur révélant de façon brutale leur véritable fonction et désamorçant tout
processus d’illusion scénique, renvoyant ainsi la salle et la scène dos à dos.
2)
Le « viol » du spectateur
La représentation théâtrale peut agir comme un véritable « viol....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓