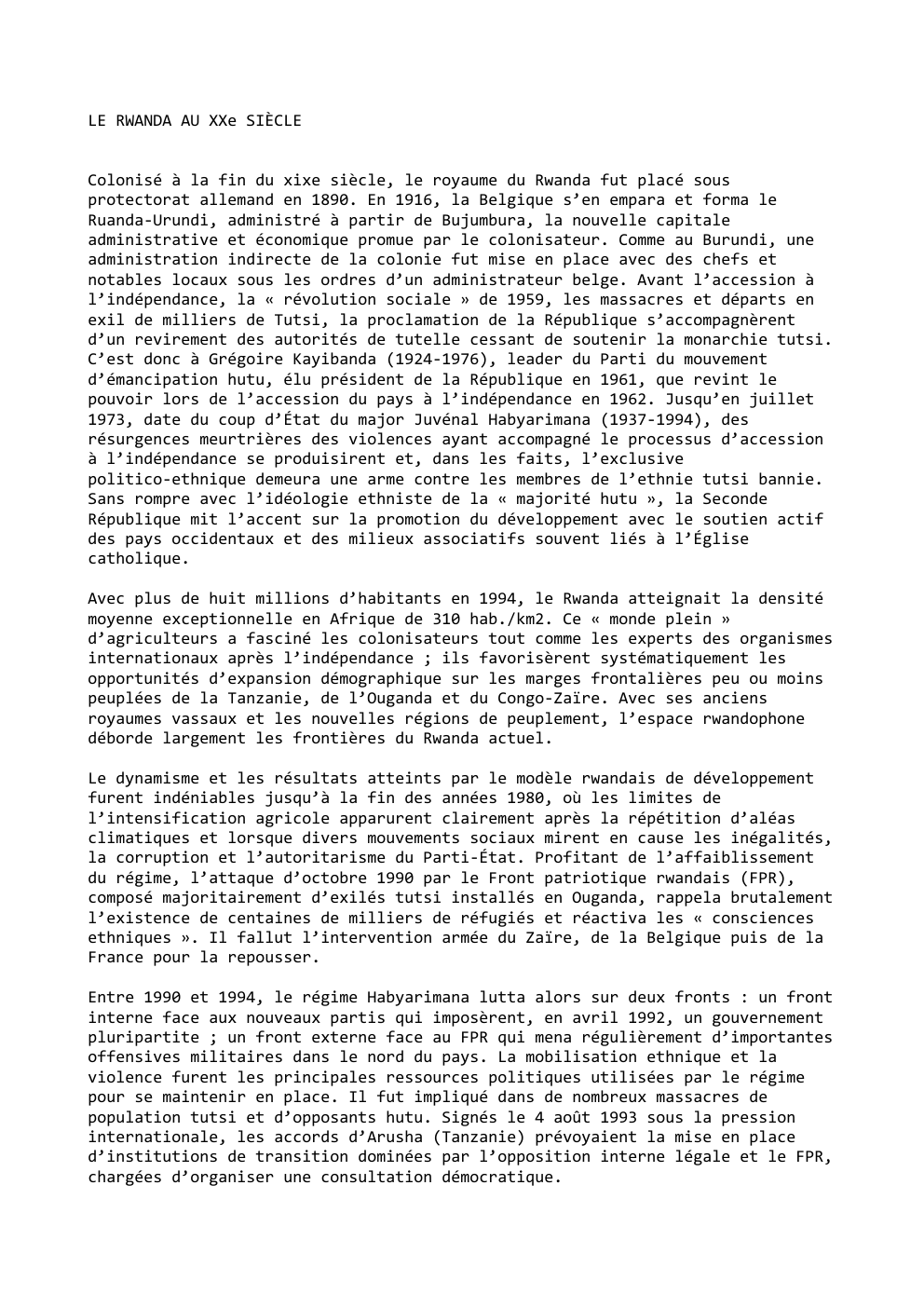LE RWANDA AU XXe SIÈCLE Colonisé à la fin du xixe siècle, le royaume du Rwanda fut placé sous protectorat...
Extrait du document
«
LE RWANDA AU XXe SIÈCLE
Colonisé à la fin du xixe siècle, le royaume du Rwanda fut placé sous
protectorat allemand en 1890.
En 1916, la Belgique s’en empara et forma le
Ruanda-Urundi, administré à partir de Bujumbura, la nouvelle capitale
administrative et économique promue par le colonisateur.
Comme au Burundi, une
administration indirecte de la colonie fut mise en place avec des chefs et
notables locaux sous les ordres d’un administrateur belge.
Avant l’accession à
l’indépendance, la « révolution sociale » de 1959, les massacres et départs en
exil de milliers de Tutsi, la proclamation de la République s’accompagnèrent
d’un revirement des autorités de tutelle cessant de soutenir la monarchie tutsi.
C’est donc à Grégoire Kayibanda (1924-1976), leader du Parti du mouvement
d’émancipation hutu, élu président de la République en 1961, que revint le
pouvoir lors de l’accession du pays à l’indépendance en 1962.
Jusqu’en juillet
1973, date du coup d’État du major Juvénal Habyarimana (1937-1994), des
résurgences meurtrières des violences ayant accompagné le processus d’accession
à l’indépendance se produisirent et, dans les faits, l’exclusive
politico-ethnique demeura une arme contre les membres de l’ethnie tutsi bannie.
Sans rompre avec l’idéologie ethniste de la « majorité hutu », la Seconde
République mit l’accent sur la promotion du développement avec le soutien actif
des pays occidentaux et des milieux associatifs souvent liés à l’Église
catholique.
Avec plus de huit millions d’habitants en 1994, le Rwanda atteignait la densité
moyenne exceptionnelle en Afrique de 310 hab./km2.
Ce « monde plein »
d’agriculteurs a fasciné les colonisateurs tout comme les experts des organismes
internationaux après l’indépendance ; ils favorisèrent systématiquement les
opportunités d’expansion démographique sur les marges frontalières peu ou moins
peuplées de la Tanzanie, de l’Ouganda et du Congo-Zaïre.
Avec ses anciens
royaumes vassaux et les nouvelles régions de peuplement, l’espace rwandophone
déborde largement les frontières du Rwanda actuel.
Le dynamisme et les résultats atteints par le modèle rwandais de développement
furent indéniables jusqu’à la fin des années 1980, où les limites de
l’intensification agricole apparurent clairement après la répétition d’aléas
climatiques et lorsque divers mouvements sociaux mirent en cause les inégalités,
la corruption et l’autoritarisme du Parti-État.
Profitant de l’affaiblissement
du régime, l’attaque d’octobre 1990 par le Front patriotique rwandais (FPR),
composé majoritairement d’exilés tutsi installés en Ouganda, rappela brutalement
l’existence de centaines de milliers de réfugiés et réactiva les « consciences
ethniques ».
Il fallut l’intervention armée du Zaïre, de la Belgique puis de la
France pour la repousser.
Entre 1990 et 1994, le régime Habyarimana lutta alors sur deux fronts : un front
interne face aux nouveaux partis qui imposèrent, en avril 1992, un gouvernement
pluripartite ; un front externe face au FPR qui mena régulièrement d’importantes
offensives militaires dans le nord du pays.
La mobilisation ethnique et la
violence furent les principales ressources politiques utilisées par le régime
pour se maintenir en place.
Il fut impliqué dans de nombreux massacres de
population tutsi et d’opposants hutu.
Signés le 4 août 1993 sous la pression
internationale, les accords d’Arusha (Tanzanie) prévoyaient....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓