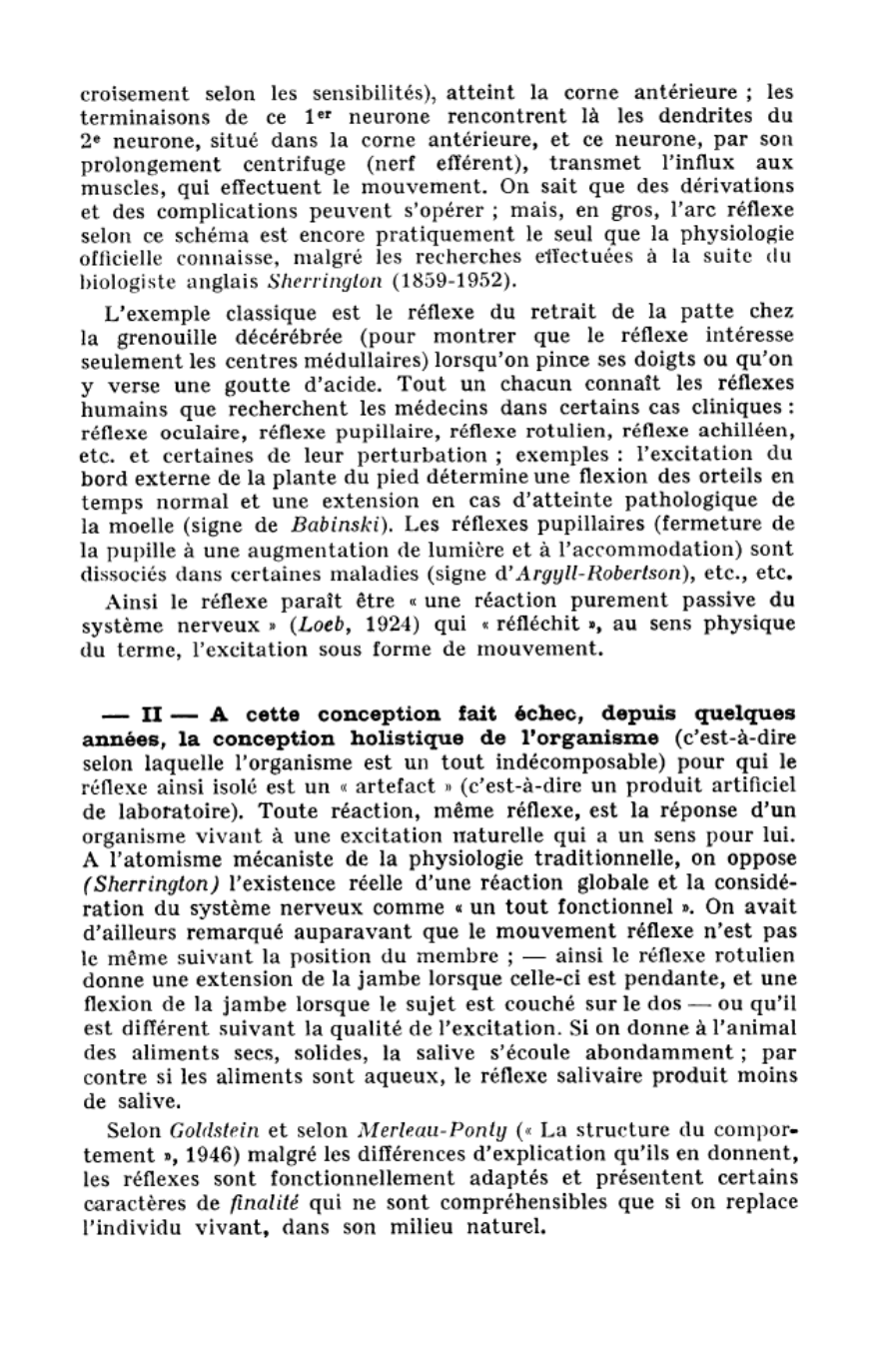LE REFLEXE (cours de philo)
Publié le 03/11/2016
Extrait du document
L’exemple classique est le réflexe du retrait de la patte chez la grenouille décérébrée (pour montrer que le réflexe intéresse seulement les centres médullaires) lorsqu’on pince ses doigts ou qu’on y verse une goutte d’acide. Tout un chacun connaît les réflexes humains que recherchent les médecins dans certains cas cliniques : réflexe oculaire, réflexe pupillaire, réflexe rotulien, réflexe achilléen, etc. et certaines de leur perturbation ; exemples : l’excitation du bord externe de la plante du pied détermine une flexion des orteils en temps normal et une extension en cas d’atteinte pathologique de la moelle (signe de Babinski). Les réflexes pupillaires (fermeture de la pupille à une augmentation de lumière et à l’accommodation) sont dissociés dans certaines maladies (signe d’Argyll-Robertson), etc., etc.
Ainsi le réflexe paraît être « une réaction purement passive du système nerveux » (Loeb, 1924) qui « réfléchit », au sens physique du terme, l’excitation sous forme de mouvement.
— II — A cette conception fait échec, depuis quelques années, la conception holistique de l'organisme (c’est-à-dire selon laquelle l’organisme est un tout indécomposable) pour qui le réflexe ainsi isolé est un « artefact » (c’est-à-dire un produit artificiel de laboratoire). Toute réaction, même réflexe, est la réponse d’un organisme vivant à une excitation naturelle qui a un sens pour lui. A l’atomisme mécaniste de la physiologie traditionnelle, on oppose (Sherrington) l’existence réelle d’une réaction globale et la considération du système nerveux comme « un tout fonctionnel ». On avait d’ailleurs remarqué auparavant que le mouvement réflexe n’est pas le même suivant la position du membre ; — ainsi le réflexe rotulien donne une extension de la jambe lorsque celle-ci est pendante, et une flexion de la jambe lorsque le sujet est couché sur le dos — ou qu’il est différent suivant la qualité de l’excitation. Si on donne à l’animal des aliments secs, solides, la salive s’écoule abondamment ; par contre si les aliments sont aqueux, le réflexe salivaire produit moins de salive.
Selon Goldstein et selon Merleau-Ponty (« La structure du comportement », 1946) malgré les différences d’explication qu’ils en donnent, les réflexes sont fonctionnellement adaptés et présentent certains caractères de finalité qui ne sont compréhensibles que si on replace l’individu vivant, dans son milieu naturel.
voulait se détacher, grattait le plancher, rongeait l’établi etc. il résultait de ce travail, de la dyspnée et une salivation continue; il devenait tout à fait inutilisable... et Pavlov interprète cette conduite comme « un réflexe de la liberté » ! Mais le mot de réflexe n’a plus de sens s’il ne désigne une réaction spécifique à certains excitants déterminés ; or, la réaction dont il s’agit est un refus indéterminé de répondre aux stimuli. Cette inhibition générale n’est pas construite selon les lois mécaniques du conditionnement ; elle exprime une loi d’un nouveau genre : l’orientation de l’organisme vers des comportements qui aient un sens biologique, vers des situations naturelles, c'est-à-dire un a priori de l’organisme ».
«
croisement selon les sensibilités), atteint la corne antérieure ; les
terminaisons de ce 1•• neuron e rencontrent là les dendrites du 2• neurone, situé dans la corne antérieure, et ce neurone, par son
prolongement centrifuge (nerf efférent), transmet l'influx aux muscles, qui effectuent le mouvement.
On sait que des dérivations et des complications peuvent s'opérer ; mais, en gros, l'arc réflexe
selon ce schéma est encore pratiquement le seul que la physiologie
off1cielle connaisse, malgré le s recherches etTectuécs à la su ite du biologiste anglais Sherrington (1859-1952).
L'exemple classique est le réflexe du retrait de la patte chez la grenouille décérébrée (pour montrer que le ré flexe intéresse
seulement les centres médullaires) lorsqu'on pince ses doigts ou qu'on y verse une goutte d'acide.
Tout un chacun connatt les réflexes humains que recherchent les médecins dans certai.ns cas cliniques :
réflexe oculaire, réflexe pupillaire, réflexe rotulien, réfle xe achill éen,
etc.
et certaines de leur perturbation ; exemples : l'excitation du bord externe de la plante du pied détermine une flexion des orte ils en temps normal et une extension en cas d'atteinte pathologique de la moelle (signe de Babinski).
Les réflexes pupillaires (fermeture de la pupille à une augmentation de lumière et à l'acco mmo dat ion) sont dissociés dans certaines maladies (signe d' Argyii-Hoberlson), etc., etc .
Ainsi le réfl exe parait être • une réaction purement passive du système nerveux • (Loeb, 1924) qui • réfléchi t •, au sens physique du terme, l'excitation sous forme de mouvement.
- Il - A cette conception fait échec, d·epuis quelques années, la conception holistique de l'organisme (c'est-à-dire
selon laquelle l'organisme est un tout indécomposable) pour qui le
réflexe ainsi isolé est un • artef act'' (c'est -à-dire un produit artificiel
de laboratoire) .
Toute réaction, même réflexe, est la réponse d'un organisme vivant à une excitatio n naturelle qui a un sens pou r lui.
A l 'atom isme mécaniste de la phys iologie traditionnelle, on oppo se (Sherrington) l'existence réelle d'une réa ction globale et la considé ration du système nerveux comme • un tout fonctionnel •.
On avait d'ailleurs r emarqué auparavant que le mouvement réflexe n'est pas le même su ivant la position du membre ; - ainsi le réflexe rotulien
d o nne une extension de la jambe lorsque celle- ci est penda nte, et une flexion de la jambe lorsque le sujet est couché sur le dos -ou qu'il est difTérent suivant la qualité de l'excitation.
Si on donne à l'animal des aliments secs, solides, la salive s'écoule abondamment ; par contre si les aliments sont aqueux, le réflexe salivaire produit moins
de salive.
Selon
Go/rlst e in et selon J'vler/eau - Ponly (• La structure du compor tement •, 1946) malgré les différences d'explication qu'ils en d onn ent ,
l es réflexes sont fonct ionnellement ad aptés et présentent certains caractères de finalité qui ne sont compr éhensibl es que si on replace
l'individu vivant, dans son milieu naturel..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- vérité - cours de philo
- Qu’est-ce qui rend le langage humain ? (cours de philo)
- cours philo Descartes contre Freud
- Cours de philo sur la culture
- cours de philo