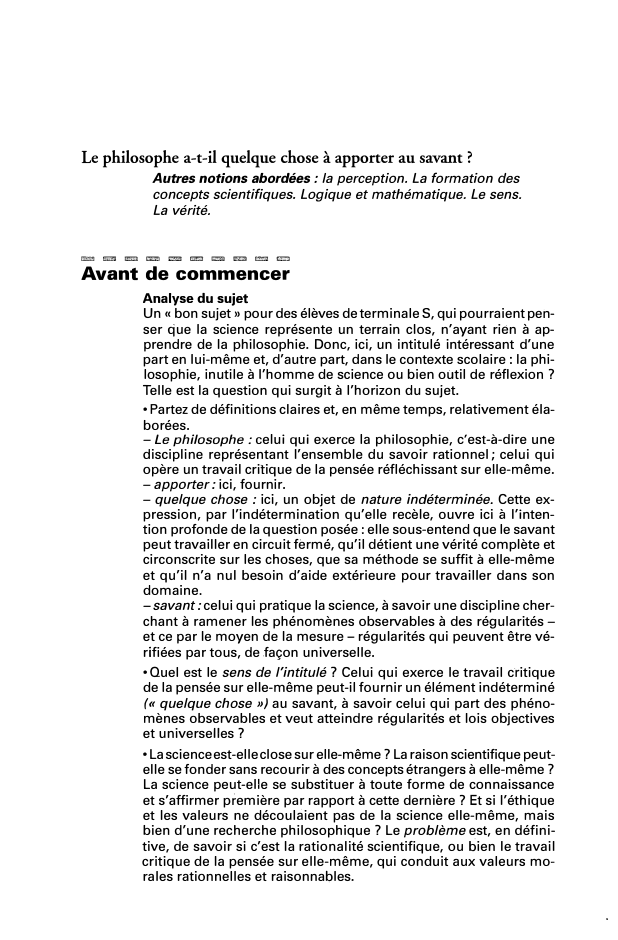Le philosophe a-t-il quelque chose à apporter au savant? Autres notions abordées : la perception. La formation des concepts scientifiques....
Extrait du document
«
Le philosophe a-t-il quelque chose à apporter au savant?
Autres notions abordées : la perception.
La formation des
concepts scientifiques.
Logique et mathématique.
Le sens.
La vérité.
mllŒl!lllœ1B!lllllll!EŒlll!llillllllmllmlll!l!milll!Emlllli!lm
Avant de commencer
Analyse du sujet
Un« bon sujet» pour des élèves de terminale S, qui pourraient pen
ser tjue la science représente un terrain clos, n'ayant rién à ap
prendre de la philosophie.
Donc, ici, un intitulé intéressant d'une
part en lui-même et, d'autre part, dans le contexte scolaire: la phi
losophie, inutile à l'homme de science ou bien outil de réflexion ?
Telle est la question qui surgit à l'horizon du sujet.
• Partez de définitions claires et, en même temps, relativement éla
borées.
- Le philosophe: celui qui exerce la philosophie, c'est-à-dire une
discipline représentant l'ensemble du savoir rationnel; celui qui
opère un travail critique de la pensée réfléchissant sur elle-même.
- apporter: ici, fournir.
- quelque chose : ici, un objet de nature indéterminée.
Cette expression, par l'indétermination qu'elle recèle, ouvre ici à l'inten
tion profonde de la question posée: elle sous-entend que le savant
peut travailler en circuit fermé, qu'il détient une vérité complète et
circonscrite sur les choses, que sa méthode se suffit à elle-même
et qu'il n'a nul besoin d'aide extérieure pour travailler dans son
domaine.
-savant: celui qui pratique la science, à savoir une discipline cher
chant à ramener les phénomènes observables à des régularités et ce par le moyen de la mesure - régularités qui peuvent être vé
rifiées par tous, de .façon universelle.
• Quel est le sens de l'intitulé? Celui qui exerce le travail critique
de la pensée sur elle-même peut-il fournir un élément indéterminé
(« quelque chose») au savant, à savoir celui qui part des phéno
mènes observables et veut atteindre régularités et lois objectives
et universelles?
• La science est-elle close sur elle-même? La raison scientifique peut
elle se fonder sans recourir à des concepts étrangers à elle-même?
La science peut-elle se substituer à toute forme de connaissance
et s'affirmer première par rapport à cette dernière? Et si l'éthique
et les valeurs ne découlaient pas de la science elle-même, mais
bien d'une recherche philosophique? Le problème est, en défini
tive, de savoir si c'est la rationalité scientifique, ou bien le travail
critique de la pensée sur elle-même, qui conduit aux valeurs mo
rales rationnelles et raisonnables.
t.: enjeu? La science doit-elle devenir une nouvelle religion ? Le
culte que nous lui vouons est-il bien fondé? Nous gagnons, selon
la réponse apportée à l'intitulé, un type d'approche concernant la
légitimité du projet scientifique qui est souvent nôtre.
Plan
Quel plan sera adopté ? Un plan progressif, avec approfondisse
ment des concepts.
A) Le philosophe n'a rien à apporter au savant.
(position scientiste)
B) Le philosophe apporte au savant synthèse des sciences et ré
flexion sur la méthode.
C) Le philosophe apporte au savant une réflexion sur les valeurs
morales relatives aux données scientifiques nouvelles.
Bibliographie
HUSSERL, La Crise de la science européenne et la phénoménologie
transcendantale, Gallimard (l'élève peut tenter de lire les vingt
premières pages.
Fondamental pour le sujet, mais difficile).
JANICAUD, La Puissance du rationnel, Gallimard, p.
228 sq.
(difficile).
MONOD, Pour une éthique de la connaissance, La Découverte.
MORIN, La Méthode.
1.
La nature de la nature, Seuil (rééd.
en poche).
Russ, La Pensée éthique contemporaine, PUF, coll.
« Que sais-je? ».
1) Introduction
Le philosophe, à savoir celui qui exerce le travail critique de la pensée sur elle
même, a-t-il « quelque chose », à savoir une réalité indéterminée, un « quel
conque objet » à fournir au savant, à savoir celui qui sonde la réalité par des
méthodes expérimentales, celui qui établit des lois entre les phénomènes et ras
semble dans des théories ces relations ou lois ? Tel est le sens de l'intitulé.
La science est-elle ou non close sur elle-même ? Peut-elle affirmer sa primauté
par rapport à toute forme de connaissance ? Léthique et les valeurs peuvent
elles découler de la science elle-même ? Est-ce la rationalité scientifique ou le
travail critique de la pensée sur elle-même qui construit les valeurs morales
concernant les données scientifiques ? Tel est le problème.
L enjeu ? La science doit-elle devenir une nouvelle religion ? Nous gagnons,
selon la réponse apportée, un type d'approche relatif aux projets et pratiques
des savants en cette fin de siècle, d'où un gain spéculatif et existentiel, concer
nant l'action.
2) Discussion
A.
Le philosophe n'a rien à apporter au savant, qui a une entière
confiance envers les méthodes et résultats de la science
Pourquoi la philosophie apporterait-elle« quelque chose» au savant? La connais
sance et le savoir humain ne se sont-ils pas édifiés de manière constructive et
· positive à partir des lois scientifiques ? Le savant, en élaborant des lois, en éta
blissant des relations invariables et nécessaires entre les choses, aboutit à un
, univers caractérisé par une immense fécondité technologique.
En un mot, non
: seulement la loi scientifique semble universelle et vraie, mais elle apporte à
'l'homme une réponse pratique à ses questions, réponse qui se suffit, paraît-il,
, à elle-même.
La formule théorique (vraie) devient appareillage utile et se conver
; tit en un pouvoir sur le réel.
Donc le savant n'a pas besoin du philosophe: il
, « réussit », il est efficace, il ouvre la pensée à un mode instrumental et opéra
i tionnel où la science met entre parenthèses la discipline exerçant un travail critique de la pensée sur elle-même, Ainsi la science tend-elle à se constituer comme
'· le seul mode authentique de rapport au monde.
Toute notre connaissance se fondant sur l'expérience, les lois scientifiques organisant cette dernière, le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓