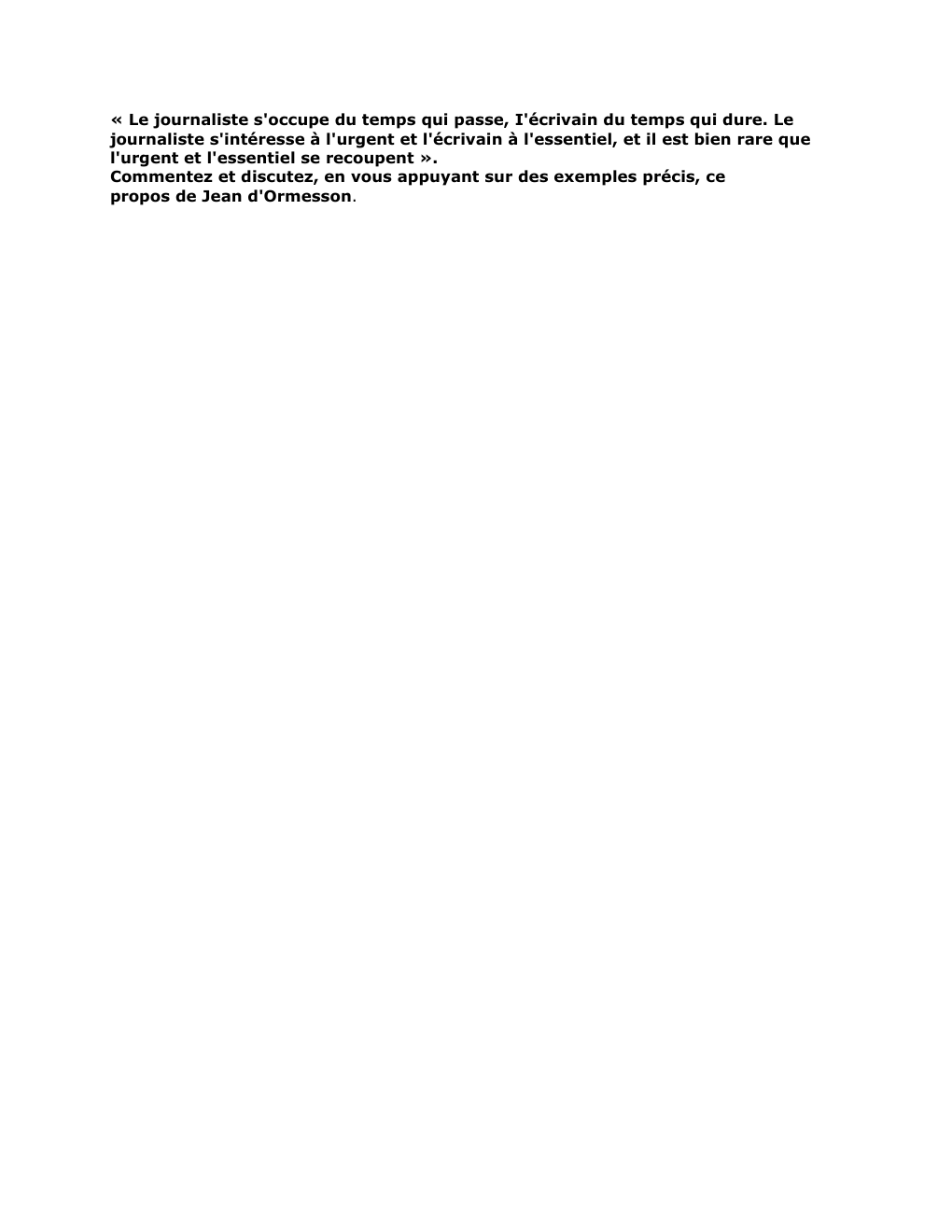« Le journaliste s'occupe du temps qui passe, I'écrivain du temps qui dure. Le journaliste s'intéresse à l'urgent et l'écrivain...
Extrait du document
«
« Le journaliste s'occupe du temps qui passe, I'écrivain du temps qui dure.
Le
journaliste s'intéresse à l'urgent et l'écrivain à l'essentiel, et il est bien rare que
l'urgent et l'essentiel se recoupent ».
Commentez et discutez, en vous appuyant sur des exemples précis, ce
propos de Jean d'Ormesson.
« Le journaliste s'occupe du temps qui passe, I'écrivain du temps qui dure.
Le
journaliste s'intéresse à l'urgent et l'écrivain à l'essentiel, et il est bien rare que
l'urgent et l'essentiel se recoupent ».
Commentez et discutez, en vous appuyant sur des exemples précis, ce
propos de Jean d'Ormesson.
La littérature ne pourrait pas vraiment évoquer le réel, le quotidien > l’urgent.
I- Deux métiers
A- Le journaliste : l’urgent
• Le journaliste travaille « à chaud » => parle, évoque la réalité, le quotidien, l’instantané.
Ex : une nouvelle loi, une décision politique, un fait divers…
• Travaillant sur l’urgent => le journaliste a moins de temps pour la réflexion (il est
toujours dur de réfléchir sur l’immédiat > pas de recul).
Ex : émotion devant un fait divers
> émotion qui peut influer sur le commentaire, la réflexion.
• Normalement, le journaliste doit être objectif (NB : problème des journalistes engagés.
Cf.
Libération, L’Humanité).
Le journaliste doit le moins possible commenter => doit
raconter les faits.
B- L’écrivain : la réflexion
• Normalement, le livre, le roman… => art.
Peut être complètement coupé du réel.
Cf.
l’art
gratuit prôné par Gautier.
Cf.
aussi le roman, la fiction…
• L’écrivain peut aussi s’engager sur de grandes causes => cf.
Les Lumières, Camus,
Sartre, Hugo…
=> Les œuvres de ces auteurs parlent du monde qui les entoure.
Mais : temps de la réflexion, temps de l’écriture du livre (+ long à écrire qu’un article de
journal) => réflexion.
L’écrivain VS le journaliste, ne travaille pas dans l’urgence.
• L’écrivain écrit et revendique sa subjectivité.
• Ex : Montaigne qui dans les « Cannibales », montre que les Européens sont eux aussi
des cannibales > cf.
le guerre de religion qui dévaste la France au XVIe siècle.
C- Un retour en arrière
• L’écrivain peut évoquer des faits qui sont passés > présente des événements tels qu’il
les a perçus, en présentant son opinion comme la vérité et en leur donnant une valeur
symbolique.
Cf.
la description de la prise de la Bastille par Chateaubriand dans les
Mémoires d’Outre-tombe.
Il démolit totalement le mythe de cet événement, présenté
comme un non événement.
Chateaubriand, dans ses Mémoires, évoque les épisodes de la
Révolution en insistant sur la violence et l’incohérence des révolutionnaires => la
Révolution a mis fin à « son » monde, celui de l’Ancien Régime : il ne peut donc que
présenter cela sous l’angle le plus négatif.
• Le journaliste est normalement tenu par l’urgence, doit travailler, évoquer l’actuel.
Toutefois, son travail lui permet aussi d’enquêter sur un sujet => ne se limite pas l’urgence
> peut vouloir connaître, découvrir les causes, les raisons d’une actualité.
Travail
d’investigation du journaliste qui ne se limite pas à l’urgence.
II- Lorsque l’écrivain s’engage
A- S’engager, réfléchir sur des sujets existentiels
• L’écrivain peut dénoncer des problèmes inhérents à l’homme => VS le journaliste, ne
travaille pas sur l’urgent mais sur « l’éternel ».
• Garantir la liberté : de nombreux écrivains ont lutté pour la liberté d’expression.
Voltaire :
« Je désapprouve ce que vous venez de dire, mais je défendrai jusqu’à ma mort votre droit
à le dire ».
• Cf.
Molière qui écrivait ses comédies afin de faire prendre conscience au spectateur de
ses défauts : l’avarice, l’hypocrisie, l’hypocondrie….
Moraliste.
Ex.
L’Avare > le spectateur
qui voit Harpagon et son argent, son « cher ami » prend conscience du défaut de l’avare,
réalise qu’il est lui-même avare et donc décide de ne plus l’être.
Molière veut corriger les
vices des hommes par le rire => Molière ne travaille pas sur l’urgence, mais plus
l’essentiel…
• Cf.
aussi Hugo qui dénonce la pauvreté dans Les Misérables, ou La Bruyère qui critique
l’hypocrisie…
• Le Dernier jour d’un condamné : le narrateur est celui qui va se faire guillotiner => le
lecteur se sent proche de lui, compatit (et presque se met à sa place) => le lecteur sent
donc toute l’atrocité de la peine de mort – surtout à la fin puisque le récit s’arrête avec la
vit du condamné.
Hugo lutte ainsi efficacement contre la peine de mort.
B- S’engager dans l’urgence
• Toutefois, les écrivains peut parler de l’urgence, peuvent s’engager dans l’immédiat et
en parler.
Cf.
Candide, qui a été écrit après le tremblement de terre de Lisbonne (évidemment, ce
n’est pas comme le reportage télévisé, il ne s’est pas rendu sur place, n’a pas pris de notes,
etc.
mais c’est l’évènement qui l’a fait écrire).
• Cf.
Manifeste d’Eluard => préface du recueil L’Honneur des poètes (1943, Éditions de
Minuit –maison d’édition clandestine).
Plaidoyer pour la poésie engagée, comme arme ;
mission qu’il confère à la poésie : elle « crie, accuse, espère ».
• Engagement politique.
Hugo => voulait « réveiller » le peuple.
De son exil, dès le
rétablissement....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓