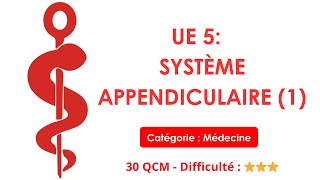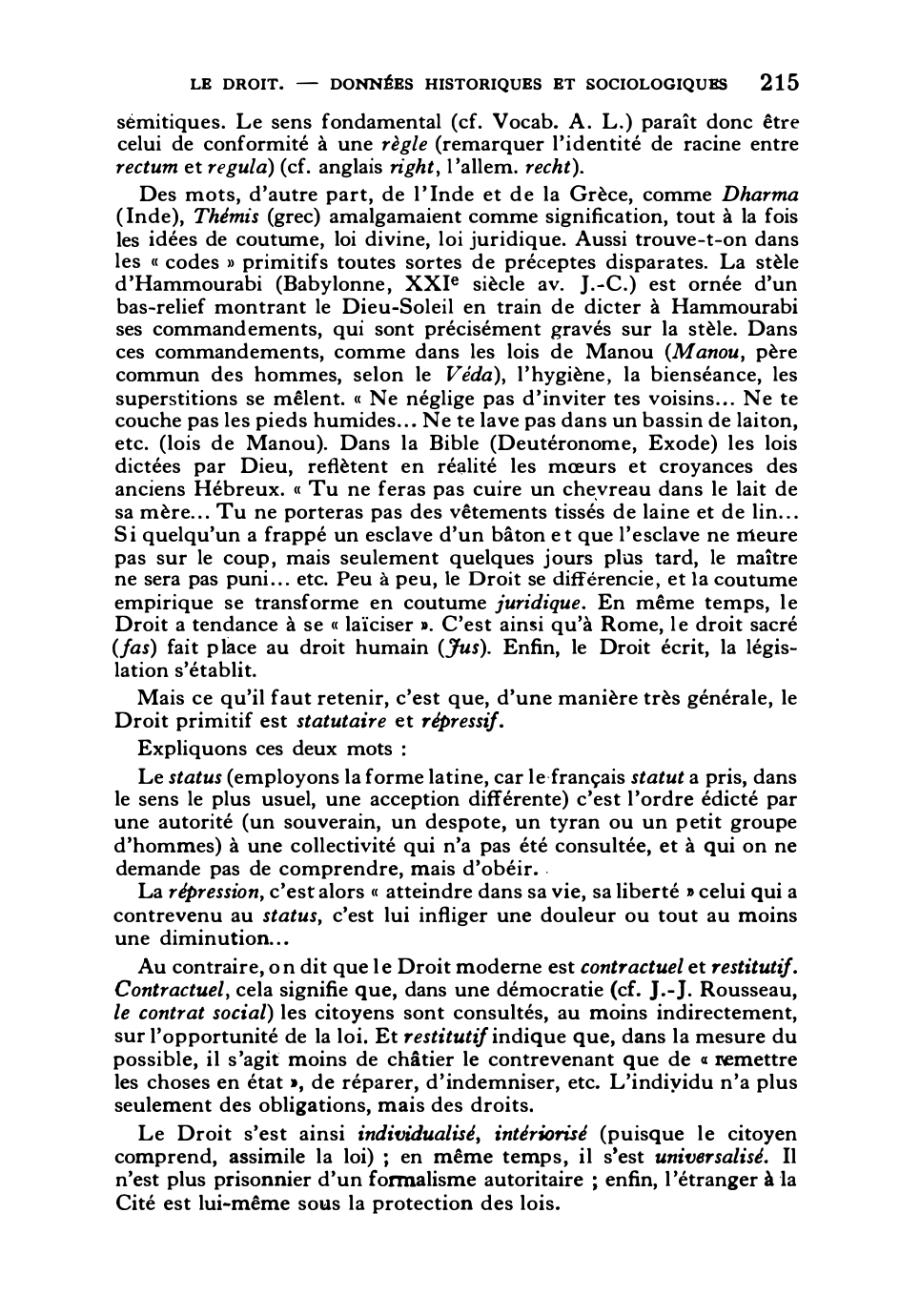Le Droit. Cours de philo
Publié le 12/11/2016
Extrait du document

III. -LES SOURCES DU DROIT DANS LES TEMPS MODERNES.
Le Droit, suivant les époques, et parfois à la même époque, peut se présenter sous forme de coutumes, de lois écrites, d’ouvrages de doctrine (ouvrages de juristes qui auront une influence sur l’interprétation de la loi) de décisions judiciaires... Des usages souvent incertains, des décisions d’arbitres, des conventions et même de simples déclarations unilatérales, voilà les sources du Droit... Puis, les décisions rendues deviennent des usages acceptés ; les coutumes se constatent un jour par écrit (La rédaction française de 1453 fut la compilation des coutumes du Moyen Age). On arrive à la loi proprement dite, règle édictée par l’autorité souveraine d’un pays. Lorsque des lois écrites relatives à un même objet, présentent une certaine étendue, on leur donne le nom de Code. La codification a trouvé des adversaires (en particulier Savigny, Allemagne, début du XIXe siècle), qui voyaient dans les codes un obstacle au libre développement du Droit. Thibaut (Allemagne, également) approuvait au contraire la rédaction officielle de la loi, garantie nécessaire contre l'incertitude des « usages ». Depuis longtemps, la question ne se discute plus. On s'accorde à reconnaître que les avantages de la codification l’emportent de beaucoup sur les inconvénients. Au surplus, un code. n’est pas forcément immuable. Il peut être soumis à des révisions (abrogations, lois nouvelles). Enfin, la jurisprudence (ensemble des décisions rendues par les tribunaux) interprète la loi, l’adapte à l'évolution des idées et des mœurs. Expliquons-nous, à ce sujet : En principe, l’autorité d’une décision judiciaire se limite au seul cas envisagé par le tribunal qui a rendu cette décision. Un tribunal n’est donc lié ni par ses décisions antérieures, ni, à plus forte raison, par celle des autres tribunaux. Cependant, la logique même veut que leur conduite d'aujourd’hui soit en conformité avec leur conduite d’hier. En second lieu, l’autorité conférée à la Cour de Cassation tend à constituer une unité de jurisprudence. Ses arrêts prennent une autorité prépondérante. On s’explique donc que la jurisprudence se fixe et s’unifie, et devienne une source complémentaire du Droit.
En résumé, la loi écrite n’est pas à elle seule tout le Droit.
IV. — NATURE ET FONDEMENT DU DROIT.
Plusieurs thèses sont à considérer sur la nature et le fondement du Droit :
1. — Conception rationaliste et idéaliste.
Le Droit serait fondé sur la nature raisonnable et libre de l’Homme (Grotius, Descartes, J.-J. Rousseau, Kant, Hauriou, etc.). C’est
Le Droit.
I. — ASPECT OBJECTIF ET ASPECT SUBJECTIF DE LA
NOTION DE DROIT.
Il y a un aspect objectif et un aspect subjectif de la notion de Droit :
Aspect objectif : c’est l’ensemble des lois existantes (ce que l’on appelle souvent le Droit positif). Règles obligatoires, bien définies, presque toujours écrites, imposables par la force, faisant l’objet de sanctions organisées.
Aspect subjectif : on présente souvent cet aspect subjectif en disant que c’est le sentiment intérieur de ce qui est juste, légitime ; mais nous préférons le définir comme la compréhension du bien-fondé de la loi : nous en comprenons les motifs.
Quant au sentiment de ce qui est juste, cela dépend plutôt de la Morale. Et nous avons déjà eu l’occasion d’exposer que les progrès du Droit (moderne) se caractérisent par l’inscription dans un Code (vote d’une loi nouvelle) de ce qui, antérieurement était une simple exigence morale, le passage de l’équitable au légal (ex. : les lois sociales). Parallèlement, on passe des sanctions diffuses aux sanctions organisées.
Inversement, quand une loi ancienne ne s’accorde plus avec des conceptions actuelles, il y a pression sur le pouvoir législatif pour obtenir l’abrogation de cette loi.
II. — DONNÉES HISTORIQUES ET SOCIOLOGIQUES.
Au stade primitif, le Droit ne se distingue pas de la Religion (au sens très général de ce terme : notion du « sacré » ; choses prescrites ; choses interdites).
Ce droit primitif — si l'on peut parler de droit en ces temps lointains — se présente souvent, sinon toujours, comme dicté, ordonné par la divinité. Il ne se distingue guère, d’ailleurs, des coutumes, des mœurs.
Ouvrons une parenthèse pour quelques explications étymologiques qui ne sont pas sans intérêt touchant le fond même de la question. Droit est une métaphore qui se retrouve en grec (orthos), en latin, dans les langues romanes, dans les langues germaniques et dans les langues
l’équivalent des thèses nativistes ou aprioristes de la conscience morale. Cette conception du Droit est sociologiquement inexacte, puisque, nous l’avons vu, ce n’est pas ainsi que le Droit s'est formé.
2. — Identification du Droit et de la force.
Ne pas faire de contre-sens sur cette thèse (elle est souvent mal exposée, mal comprise). Il ne s’agit pas de la formule brutale du « droit du plus fort (le Faustrecht, de Bismarck) qui, étant la négation du Droit, ne saurait en être le fondement ; mais d’une thèse moitié métaphysique, moitié religieuse, selon laquelle Dieu donne la force à celui qui la mérite et qui, légitimement peut ainsi faire la loi.
3. — Le Droit fondé sur l’utilité sociale.
Cette thèse présente certaines variétés. D’abord, thèse de Hobbes (1588-1679). L’homme est un loup pour l’homme (Homo homini lupus)... D’où nécessité d’un pacte. Helvétius, Beccaria, et, naturellement, les utilitaristes (Bentham, Mill) voient dans le Droit une conséquence indirecte du délit.
Jhering (1818-1892) n’est ordinairement classé dans ce groupe que par simple corrunodité d’exposition. Il admet l'égoïsme à la base : le Droit n’est que l’égoïsme sous sa forme la plus haute (Ex. : le peuple romain, égoïste et créateur du Droit)... Mais, chez Jhering, cela entraîne une méconnaissance de la valeur idéale du Droit, si bien que, dans, sa théorie, le Droit paraît se fonder sur la force (au sens du Faustrecht)... Les adversaires de cette doctrine objectent, en outre, que l’égoïsme n'est pas le seul sentiment primitif, et surtout que le Droit n’est pas, historiquement, de création artificielle.
Certains auteurs semblent n’avoir retenu de Jhering que sa vigoureuse critique du Droit subjectif. Il n’y aurait pas même, à les en croire, de droits individuels : seule compterait la Société. Selon Duguit, la Société, la solidarité sont des faits, et le Droit serait un état de fait résultant de cette interdépendance ; le droit privé reposerait sur la notion de fonction sociale assumée par chaque individu ; le droit public, sur la notion de services publics gérés par le Gouvernement...
Georges Davy a protesté contre cette exagération : sans doute, le Droit n’est pas de formation artificielle, volontaire, à l'origine. Il n’en est pas moins vrai que, au cours des âges, une conception idéale du Droit s’est progressivement dégagée, a évolué... Ces valeurs idéales sont des conquêtes de la conscience civilisée... Par là se concilieraient l’idéalisme et le réalisme juridiques.

«
LE
DROIT.
-DONNéES HISTORIQUES ET SOCIOLOGIQUES
215
sémitiq ues.
Le sens fondamental (cf.
Vocab.
A.
L.) paraît donc être
celui de conformité à une règle (remarquer l'identité de racine entre
rectum et regula) (cf.
anglais right, 1 'allem.
recht).
Des mots, d'autre part, de l'Inde et de la Grèce, comme Dharma
(I nde), Thémis (grec) amalgamaient comme signification, tout à la fois
les idées de coutu me, loi divine, loi juridique.
Aussi trouve -t-on dans
les « codes » primitifs toutes sortes de préceptes disparates.
La stèle
d' Hammourabi (Babylonne, XXIe siècle av.
J.-C.) est ornée d'un
bas-relief montrant le Dieu-Soleil en train de dicter à Hammourabi
ses command ements, qui sont précisément gravés sur la stèle.
Dans
ces command ements, comme dans les lois de Manou (Manou, père
commun des hommes, selon le Véd a), l'hygiène , la bienséance, les
superstitions se mêlent.
« Ne néglige pas d'inviter tes voisins ...
Ne te
couche pas les pieds humides ...
Ne te lave pas dans un bassin de laiton,
etc.
(lois de Manou).
Dans la Bible (Deutérono me, Exode) les lois
dictées par Dieu, reflètent en réalité les mœurs et croyances des
anciens Hébreux.
« Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de
sa mère ...
Tu ne porteras pas des vêtements tissés de laine et de lin ...
Si quelqu'un a frappé un esclave d'un bâton et que l'esclave ne meure
pas sur le coup , mais seulement quelques jours plus tard, le maître
ne sera pas puni ...
etc.
Peu à peu, le Droit se différenci e, et la coutume
empirique se transforme en coutume juridique.
En même temps, le
Droit a tendance à se «laïciser ».
C'est ainsi qu'à Rome, le droit sacré
(f as) fait place au droit humain (Jus).
Enfin, le Droit écrit, la légis
lation s'établit.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, d'une manière très générale, le
Droit primitif est statutaire et répressif.
Expliquons ces deux mots :
Le status (employons la forme latine, car le·français statut a pris, dans
le sens le plus usuel, une acception différente) c'est l'ordre édicté par
une autorité (un souverain, un despote, un tyran ou un petit groupe
d' hommes) à une collectivité qui n'a pas été consultée, et à qui on ne
demande pas de comprendre, mais d'obéir ..
La répressi on, c'est alors « atteindre dans sa vie, sa liberté • celui qui a
contrevenu au status, c'est lui infliger une douleur ou tout au moins
une diminution ...
Au contra ire, on dit que le Droit moderne est contractuel et restitutif.
Contractuel , cela signifie que, dans une démocratie (cf.
J.-J.
Rousseau,
le contrat social) les citoyens sont consultés, au moins indirectement,
sur l'opp ortunité de la loi.
Et restitutif indique que, dans la mesure du
possible, il s'agit moins de châtier le contrevenant que de • remettre
les choses en état •, de réparer, d'indemniser, etc.
L'indiyidu n'a plus
seulement des obligations, mais des droits.
Le Droit s'est ainsi individ ualisé, intériorisé (puisque le citoyen
comp rend, assimile la loi) ; en même temps, il s'est universalisé.
Il
n'est plus prisonnier d'un formalisme autoritaire ; enfin, l'étranger à la
Cité est lui-même sous la protection des lois..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- cours philo justice et droit
- Fiche de cours en philo : LE DROIT .
- LE DROIT LA JUSTICE (cours de philo complet)
- LE DROIT (cours de philo complet)
- Cours de philo: Le droit