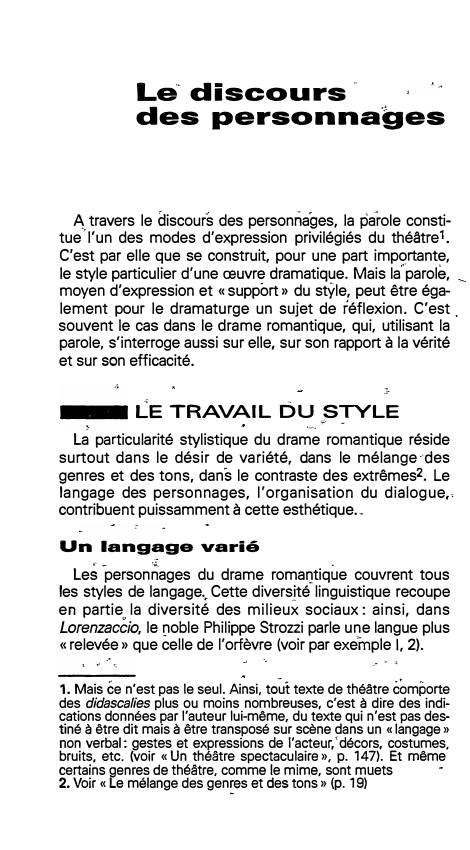Le· discours des personnages A travers le discours des personnages, la pârole consti tue'l'un des modes d'expression privilégiés du théâtre1....
Extrait du document
«
Le· discours des personnages
A travers le discours des personnages, la pârole consti
tue'l'un des modes d'expression privilégiés du théâtre1.
C'est par elle que se construit, pour une part importante,
le style particulier d'une œuvre dramatique.
Mais la'parolè,
moyen d'expression et «support» du style, peut être éga
lement pour le dramaturge un sujet de réflexion.
C'est
souvent le cas dans le drame romantique, qui, utilisant la ·
parole, s'interroge aussi sur elle, sur son rapport à la vérité
et sur son efficacité.
LE TRAVAIL DU ,,STYLE
-
La particularité stylistique du drame romantique réside
surtout dans le désir de variété, dans le mélange-des
genres et des tons, dans le contraste des extrêmes2 .
Le
langage des personnages, l'organisation du dialogue,,
contribuent puissamment à cette esthétique._
Un langage varié
Les -person�ages du drame romantique couvrent tous
les styles de langage.• Cette diversJté- linguistique recoupe
en partie la diversité des milieux sociaux: ainsi, dans
Lorenzaccio, le noble Philippe Strozzi parle une langue plus
«relevée» que ëelle de l'orfèvre (voir par exemple 1, 2).
"
·-
,- ,.
.-,;
1.
Mais ée n'est pas le seul.
Ainsi, to�t texte de théâtre éomporte
des didascalies plus ou moins nombreuses, c'est à dire des indi
cations données par l'auteur lui-même, du texte qui n'est pas des
tiné à être dit mais à être transposé sur scène dans un « langage »
non verbal: gestes et expressions de l'acteur,'décors, costumes.
bruits, etc.
(voir « Un théâtre spectaculaire».
p.
147).
Et même
certains genres de théâtre.
comme le mime, sont muets
2.
Voir « Le mélange des gen�es et des tons» (p.
19)
Mais une telle répartition sociale des styles n'a rien de
systématique.
Elle peut même parfois être inversée; la
censure s'est ind_ignée.
que, dans Hernani, « le roi s'exprime
souvent comme un bandit».
D'ailleurs un même personnage
peut utiliser tour à tour tous les niveaux de langue, depuis
le plus sublime jusqu'au plus vulgaire.
Ainsi Lorenzaccio
emploie dans la même scène (Ill, 3) des tournures quasi
ordurières («je suis vraiment un ruffian 1 ») et des tournures élevées jusqu'à l'emphase (« dans deux jours les
hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté»).
Cette çliversité de style provoque parfois de brutales ruptures dé"ton et d'atmosphère.
Le roi don Carlos, dans
Hernani, est coutumier du fait.
Il interrompt le duo lyrique
des amoureux en sortant brutalement de l'armoire dans laquelle il se cachait et en s'écriant: « Quand aurez-vous fini de
conter votre histoire? »·o, 2, V.
171 ).
Et il répond à la grande
tirade héroïque de don Ruy Gomez par des plaisanteries d'un
goût douteux sur la calvitie du vieillard {li 1, 6, v.
1192-1196).
Entre ces extrêmes, le langage du drame romantique ne
dédaigne pas le style moyen.
Il intègre ainsi des expressions et des réalités banales, même dans les situations
les plus poétiques.
Ainsi le duo d'amour entre Hernani et
dona Sol, au premier acte du drame, s'accommode fort bien
des attentions simples de la jeune femme, exprimées avec
la plus grand naturel: « votre manteau ruisselle! il pleut
donc bien?» (1, 2, v.
41 ).
Or à cette époque, les auteurs de
tragédies, par un souci de « beau langage», appelaient des
espions des « mortels dont l'état gage la vigilance», ou un
fiacre un « char numéroté».
Cette expression souvent
simple et directe fut alors sentie comme une innovation
stylistique majeure du drame romantique.
'
L'organisation d~ discours
L'organisation du discours est, elle aussi, variée et contrastée.
On passe de dialogues particulièrement vifs, constitués de répliques d'une seule phrase, voire d'un seul mot
(CM, Il, 1 ; L, 11, 2; H, 1, 1 ; RB, IV, 3; etc.), à d'immenses tirades (L; Ill, 3; RB, 111, 2) ou monologues (L, IV, 9; H,_IV, 2).
1.
Mot injurieux qui signifie « souteneur», «entremetteur»,
«proxénète».
Il faut aussi noter le cas, assez fréquent, où le dialogue·
s'éparpille entre plusieurs couples ou groupes d'interlocu
teurs.
Ainsi dans Ruy Blas, la scène du conseil royal (Ill, 1)
commence par un dialogue entre deux, puis trois conseillers.
Pendant ce temps d'autres groupes poursuivent des conver
sations particulières que l'on n'entend pas.
Les nombreuses
scènes de rues de Lorenzaccio sont construites selon un
procédé similaire: le spectateur entend une conversation
isolée, l'espace de quelques répliques, puis on passe à un
autre dialogue entre d'autres personnages (1, 2; 1, 5; etc.)
Pour employer un langage cinématographique, on a là une
sorte d'effet de«zoom»: la «caméra» s'approche un mo
ment d'un groupe avant de passer à un autre..
Ce type
d'organisation du dialogue théâtral permet de' représenter
toute la société de Florence dans ses diverses compo
santes.
Une parole poétique
Voir« Poésie du drame romantique» (p.
139).
Les effets de rupture du dialogue
Il arrive parfois que le dialogue s'avère difficile, voire
impossible.
La parole du personnage semble alors inca
pable de remplir sa fonction habituelle de communicat1on,
d'échange vérbal.
Par ce procédé, l'auteur peut rendre par
ticulièrement sensible le désarroiïntime d'un personnage.
Il peut également montrer le «blocage» d'une situation:
c'est un moment tragique où plus aucune parole ne peut
changer l'état des choses.
Plus généralement, ces rup
tures du dialogue peuvent exprimer le doute qu'éprouvent
les Romantiques sur la capacité de la parole à permettre
une communication authentique entre les hommes.
Ainsi les immenses tirades constituent souvent un
grand moment poétique.
Mais dans de tels moments, la
parole du personnage s'emballe parfois, au point qu'elle
ne semble plus attendre aucune réponse de l'interlocuteur
(par exemple H, Ill, 4).
Ces discours démesurés, souyent
proches du délire 1, disent le désarroi du personnage.
1.
Voir « Complexité psychologique des personnages » (p.
68-69)
Paradoxalement, s'il parle tant de lui-même, c'est qu'il
éprouve alors la plus grande difficulté à se comprendre, et,
une difficulté plus grande encore à communiquer avec
l'autre ..
Pour reprendre les expressions de la critique Anne
Ubersfeld, la « parole-fleuve», dans le drame romantique
et surtout chez Hugo, est souvent aussi une « parole ma-.
lade »,, dans 1~ mesure .où elle exprime le malaise du personnage.-·
Même hors de ces moments de « parole-fleuve »,
l'échange verbal peut s'avérer difficile, voire impossible.
C'est le cas notamment lorsqu'un personnage, sous le
coup d'une violente émotion, refuse cet échange.
Ainsi
Lorenzaccio; tout à son extase après le meurtre du duc,
parle pour lui-même, et son compagnon ne parvient pas à
« entrer en communication » avec lui (IV, 11).
,L'échange verbal peut être également perturbé quand.
il y a méprise sur l'identité de l'interlocuteur.
C'est la situa- tion du quiproquo.
Dans le quatrième acte de Ruy Blas,
deux messagers successifs s'adressent au vrai don César
- lequel n'y comprend goutte-, mâis c'est à Ruy Blas, qui
a pris l'identité de don César, qu'ils croient parler.
Dans
Les Caprices de Marianne, l'héroïne, à la faveur de la nuit,:
croit parler à Octave, alors que c'est à Cœlio qu'elle
s'adresse (Il, 5).
'
Évoquons enfin un exemple particulièrement radical
d'échange impossible.
Quand Lorenzaccio tente de prévenir les républicains du meurtre qu'il va commettre, le soir
sur la personne du duc, il s'aperçoit qu'il n'y a
aucun moyen pour lui d'être.
cru (IV, 7): « Peut-être que j'ai
tort de leur dire que c'est inoi qui tuerai Alexandre, car
tout le monde refuse de me croire.
» Mais, après avoir annoncé la nouvelle sans dire son nom, il constate: « Il est
clair que si je ne dis pas que c'est moi, on me croira encore bien moins.
» La situatiorf est ici telle que la parole se
trouve dans une impasse.
Et l'impuissance de la parole exprif!le le tragique de la situation.
"
même:
PAROLE ET VÉRITÉ
Le langage humain possède un pouvoir spécifique: celui
de mentir.
Cette possibilité constante du mensonge est
particulièrement sensible dans le texte théâtral.
Celui-ci
est en effet dépourvu de narrateur et donc d'instance su
périeure de vérité; il n'est constitué que de paroles d'ori
gines diverses qui, toutes, peuvent être mensongères.
Une stratégie
de la parole mensongère
Le mensonge peut constituer la stratégie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓