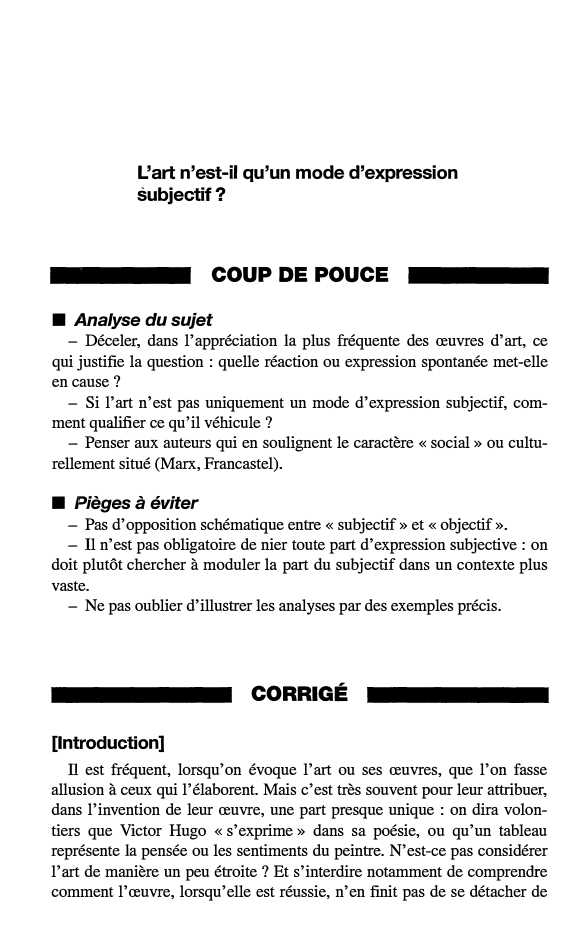L'art n'est-il qu'un mode d'expression subjectif? COUP DE POUCE ■ Analyse du sujet - Déceler, dans l'appréciation la plus fréquente...
Extrait du document
«
L'art n'est-il qu'un mode d'expression
subjectif?
COUP DE POUCE
■ Analyse du sujet
- Déceler, dans l'appréciation la plus fréquente des œuvres d'art, ce
qui justifie la question : quelle réaction ou expression spontanée met-elle
en cause?
- Si l'art n'est pas uniquement un mode d'expression subjectif, com
ment qualifier ce qu'il véhicule?
- Penser aux auteurs qui en soulignent le caractère «social» ou cultu
rellement situé (Marx, Francastel).
■
Pièges à éviter
- Pas d'opposition schématique entre«subjectif» et«objectif».
- Il n'est pas obligatoire de nier toute part d'expression subjective: on
doit plutôt chercher à moduler la part du subjectif dans un contexte plus
vaste.
- Ne pas oublier d'illustrer les analyses par des exemples précis.
CORRIGÉ
[Introduction]
Il est fréquent, lorsqu'on évoque l'art ou ses œuvres, que l'on fasse
allusion à ceux qui l'élaborent.
Mais c'est très souvent pour leur attribuer,
dans l'invention de leur œuvre, une part presque unique : on dira volon
tiers que Victor Hugo «s'exprime» dans sa poésie, ou qu'un tableau
représente la pensée ou les sentiments du peintre.
N'est-ce pas considérer
l'art de manière un peu étroite? Et s'interdire notamment de comprendre
comment l'œuvre, lorsqu'elle est réussie, n'en finit pas de se détacher de
son créateur, pour «dire» éventuellement autre chose que ce qu'il pré
voyait? Si l'art n'était qu'un mode d'expression subjectif, comment pour
rait-il nous concerner, alors même que nous ne vivons pas les mêmes sen
timents que celui qui en fut le responsable, ou que notre monde n'a plus
grand-chose de commun avec le sien?
[I.
Le nom de l'artiste]
Nous sommes généralement habitués à ce que les œuvres nous parvien
nent avec une signature, même si cette dernière - c'est notamment le cas
pour Homère ou Shakespeare, dont les textes ne sont pourtant pas négli
geables t - renvoie à une identité difficile à cerner.
Sans doute ce phéno
mène influence-t-il fréquemment la façon d'apprécier l'art, ou de saisir sa
nature même.
Car on croit pouvoir en«déduire» qu'une œuvre ne serait
finalement pas autre chose, ou peu s'en faut, que l'expression la plus
accomplie de la subjectivité de l'artiste qui l'a inventée ou mise au point.
Ainsi lira-t-on un sonnet de Ronsard en y cherchant une vérité de ses sen
timents, de ses relations amoureuses, de son«vécu», comme si le texte,
avec son élaboration complexe, n'avait pas d'autre but que de faire
connaître aux lecteurs (quelle que soit leur époque) les sentiments de l'in
dividu nommé Ronsard.
De même, on considère volontiers qu'un tableau
de Monet figure sa vision personnelle de la cathédrale de Rouen ou de
meules de foin (et l'on rejoint ainsi quelques critiques de son époque qui
trouvaient que, pour peindre de façon aussi confuse, il devait avoir une
bien mauvaise vue ...).
Une telle façon de considérer l'art, tout en prétendant rendre hommage
à ceux qui le font, n'est pas sans ambiguïté: on fait de l'artiste un être à la
sensibilité d'exception, doté de capacités d'expression hors du commun
(inutile donc de prétendre rivaliser avec lui), mais du même coup, on s'au
torise, le cas échéant, à «ne p�s comprendre» son travail, puisqu'un
excès de subjectivité rend en effet la lecture étrangère impossible: on peut
alors ne pas très bien savoir ce qu'il «voulait dire», ou trouver que son
travail ne saurait nous intéresser, puisque nul n'est obligé d'écouter des
confidences...
De plus, on rencontre des difficultés pour apprécier des œuvres non
signées.
Tandis que la signature fait usage de fétiche et a des retombées
économiques, son absence oblige à attribuer les œuvres à une ethnie (cas
de l'art africain) sinon à une culture peu perméable (cas des œuvres orien
tales, signées, mais....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓