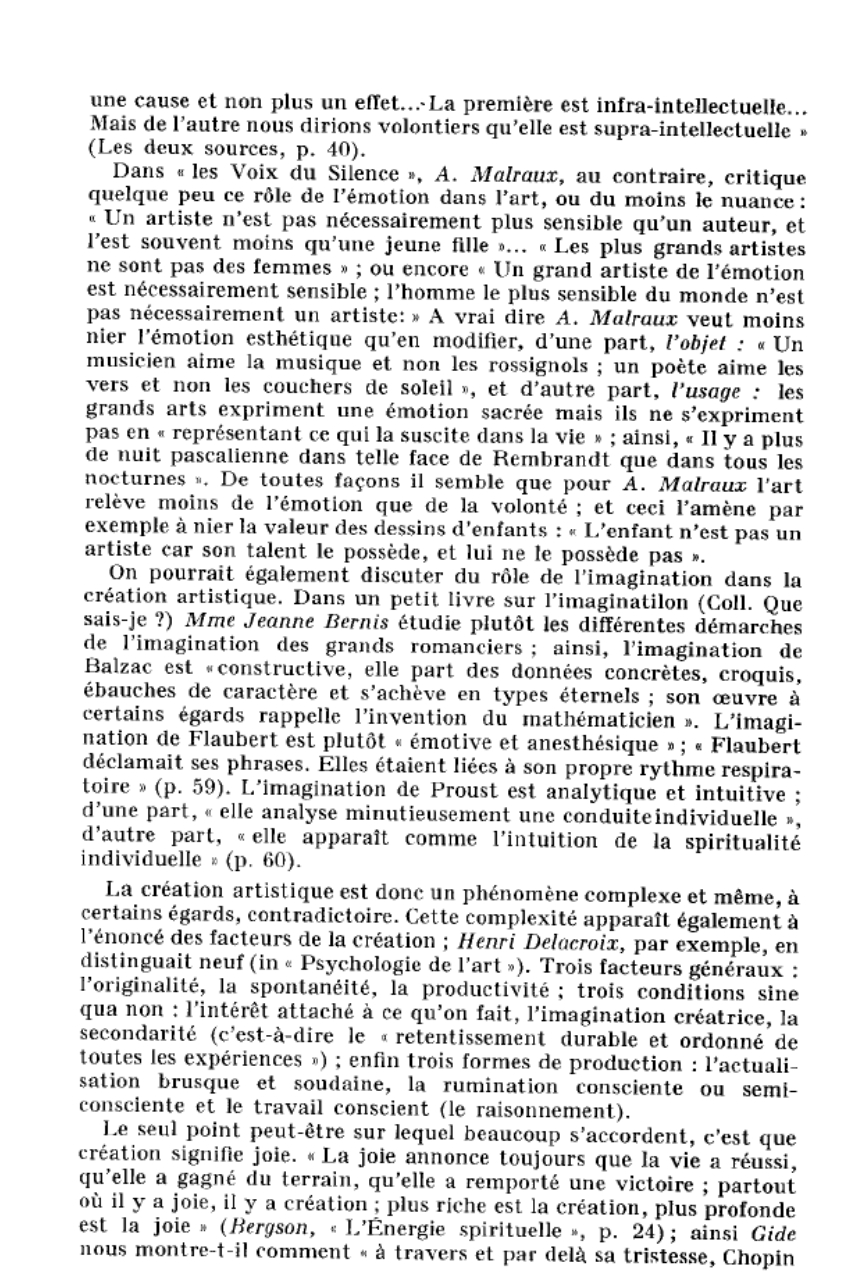L’ART ET LES VALEURS ESTHETIQUES
Publié le 02/11/2016
Extrait du document
L’ART ET LES VALEURS ESTHÉTIQUES
— I — La création artistique.
Nous examinerons tour à tour le rôle de l'inspiration, le rôle de l’émotion, et le rôle de l’imagination créatrice. Puis nous nous interrogerons plus profondément sur les valeurs esthétiques.
1 _ Les descriptions les plus diverses ont été données de
la création artistique. Pour les uns, elle ne s’accomplit que sous l’effet d’une inspiration : » Mol, disait Lamartine, je ne pense jamais, mes idées pensent pour moi » ; George Sand écrit : « Chez Chopin, la création était spontanée, miraculeuse ; il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir, elle venait, complète, soudaine, sublime ». Chateaubriand raconte de même : « Un beau jour, je m’étends, je ferme les yeux complètement. Je ne fais aucun effort. Je laisse se dérouler l’action sur l’écran de mon esprit... Je regarde en moi les choses se faire. C'est un rêve. C’est l’inconscient ». Cette conception romantique de l’inspiration rejoint la conception surréaliste de l’écriture automatique OÙ le poète accueille les images dans l’ordre que lui dicte
l’insconscient.
Pour d’autres, au contraire, la création est moins le fruit cl une inspiration que d’un travail : « La loi suprême de l’invention humaine, c’est qu’on n’invente rien qu'en travaillant » (Alain, « Système des Beaux-Arts », p. 34). C’est la conception classique de la création : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ».
Pour d’autres, enfin, la création résulte d’un mélange d’inspiration et de travail ; Valéry écrit : » Les Dieux gracieusement nous donnent pour rien tel premier vers : mais c’est à nous de façonner le second » (Introduction à la méthode de Léonard de Vinci).
On peut discuter de la même manière du rôle de l'émotion dans la création artistique. Pour Bergson (la création étant élan vital) « création signifie, avant tout, émotion. » (« Les deux sources de la morale et de la religion », p. 41) ; il faut distinguer, en effet, deux espèces d’émotion : « Dans la première, l'émotion est consécutive à une idée ou à une image représentée : l’état sensible résulte bien d’un état intellectuel qui ne lui doit rien, qui se suffit à lui-mème... Mais l’autre émotion n’est pas déterminée par ma représentation dont elle prendrait la suite et dont elle resterait distincte. Bien plutôt serait-elle, par rapport aux états intellectuels qui surviendront,
parvient à la joie ». Le fondement de cette joie ou de ces « pleurs de joie », pour employer l’expression de Pascal, tient peut-être à ce que Delacroix appelle « la parenté de l’extase religieuse et de 1 extase artistique » ; et cette parenté résulte pour lui du mélange du sentiment d’être au cœur de l’être (d’« être tout ») et de « l’évidence de n'être rien ».
2 _ Mais quel est le sens de la création artistique ? Pourquoi
une telle création ? On la définit tantôt comme une activité libre et désintéressée, tantôt comme un trop plein de force, qui se dépense pour le plaisir de se dépenser. Dans les deux cas, écrit Parodi, Inactivité esthétique serait apparentée à l’idée de jeu, et s'opposerait à l’activité utilitaire et intéressée (in « La conduite humaine et les valeurs idéales »). Ce caractère ludique, mis en lumière par Spencer et Schiller, a amené Durkheim à critiquer la valeur de l'art. Il faut alors préciser cette idée de jeu : 1) Dire que l’art est jeu ne signifie pas qu’il soit futile ; il répond à une espèce de nécessité : « tous les organes, écrit Parodi, toutes les facultés manifestent à de certains moments le besoin de s’exercer pour s’exercer, au-delà ou en dehors de leur fonctionnement immédiatement et strictement utile pour l’ensemble ». 2) « Tout jeu n'est pas esthétique » ; le jeu esthétique est celui de nos facultés supérieures, des représentations, des sentiments. 3) Toute l'évolution de l'art nous montre comment « le jeu imaginatif et sentimental se sépare des activités utiles qu’il accompagnait d’abord et acquiert une autonomie de plus en plus entière ». . La musique ou la danse n'accompagnent plus aucune pompe sociale ; la sculpture et la peinture sont détachées du temple ou du palais ». Notons cependant que dans les États tyranniques où la liberté est bannie, y compris celle de l’artiste, l'Art redevient aussitôt un service social ou une fonction politique. 4) L'art n’est pas un jeu pour tout le monde : pour le spectateur sans doute, mais pas pour l’acteur qui gagne sa vie. 5) L’art est un jeu, mais un jeu d’où résultent des œuvres, et, de ce fait, il est très différent du jeu des enfants.
_ Il_ La contemplation esthétique.
On connaît la conception d’A. Schopenhauer du plaisir esthétique . pour lui (dans * Le Monde comme volonté et comme représentation », 1819),l’Art a pour caractéristique de nous «ravir» c’est-à-dire de nous arracher au sentiment de l’existence humaine qui est un sentiment nécessairement tragique. Dans le plaisir esthétique, nous oublions un instant de vivre, c’est-à-dire de souffrir ou d'avoir du souci.
Pour d’autres, l’essentiel de la contemplation, du plaisir esthétique, réside dans une émotion. Suivant la conception romantique de l'art
— et aussi suivant la conception classique de la tragédie - l'art a pour fonction de provoquer en nous des émotions, de nous toucher. L’émotion esthétique est rendue possible par un double mouvement : celui de l’attention qui se concentre, et celui de l’imagination qui
Aux yeux de l’artiste les choses sont d’abord ce qu’elles peuvent devenir dans un domaine privilégié où elles échappent à la mort, mais où, pour cela, elles perdent un de leurs caractères fondamentaux : la vraie profondeur en peinture, le vrai mouvement en sculpture. »
— V — Classification des arts. Les Beaux-Arts.
La classification traditionnelle des arts oppose les trois arts plastiques (architecture, sculpture, peinture) aux trois arts rythmiques (danse, musique, poésie).
Etienne Souriau a critiqué cette conception : les arts plastiques comportent un temps essentiel ; les arts rythmiques un espace. Par exemple, la typographie des « Calligrammes » d'Apollinaire est très importante ; inversement, D. Huisman peut parler de « la rapidité gracile de la sculpture gothique flamboyante \"... du « temps contourné et tarabiscoté du baroque », de « la durée nerveuse de Van Gogh », du « temps nonchalant d’Henri Matisse » (Huisman, Coll. Que sais-je ? « L’Esthétique »).
Mais il est d’autres essais de classification. Alain distinguait « les arts de société et les arts solitaires ». M. Lalo classe ainsi les arts :
1° Structures et suprastructures de l’audition : musique orchestrale, chorale et musique de chambre ;
2° Structures et suprastructures de la vision : peinture, dessin, gravure, estampes ;
3° Structures et suprastructures du mouvement corporel : ballets d’opéras par exemple, ou du mouvement extérieur : jets d’eau, cascades ;
4» Structures et suprastructures de l’action : théâtre, cinéma, opéra, etc. ;
5° Structures et suprastructures de la construction : architecture, sculpture, art des jardins ;
6° Structures du langage : poésie, prose ;
7° Structures et suprastructures de la sensualité : l'art d’aimer, gastronomie, parfumerie.
Et M. Nédoncelle dans son « Introduction à l’Esthétique » classe les arts en cinq groupes correspondant aux cinq sens.
En fait ces classifications, purement intellectuelles, sont une division des œuvres plutôt qu’une mise en ordre des genres d’inspiration ou des recherches esthétiques.
Conclusion. L’art est une victoire de l’esprit contre les lois aveugles de la nature, il est le résultat réussi d’un effort pour jouer avec ces lois sans les nier et en les transcendant — ainsi la grâce est un défi aux lois de l’équilibre, ainsi les flèches des cathédrales sont un défi aux lois des masses et de la pesanteur, etc. On peut donc envisager la classification des arts comme le recensement méthodique de toutes les différentes manières dont se cherche et s’accomplit cette victoire, ou de toutes les différentes réalités physiques ou sociales à partir desquelles elle se produit.
«
une cause el non plu s un etTet ...
·La première est in fra- Intellectuelle .
..
Mais de l' autre nou s dirions volon tiers qu'elle est supr a-intellect uell e • (Les deux so urces, p.
40).
Dans • les Voix du Silence •.
A.
Malraux, au contra ire, criti que quelque peu ce rôle de l'émoti on dans l'art, ou du moins le nuan ce: • Un artiste n'est pas nécessairement plu s sensi ble qu'un auteu r , et l'est souve nt moin s qu'une jeune fille o ••• • Les plu s g rand s arti stes ne sont pas des lemmes • ; ou enco re • Un grand artiste de l'émotion est nécessaire ment sensible; l'h omm e le t>lus sensib le du mond e n'est pas néces sa irement un artiste: • A vrai dire A.
Il1alrau:r; veut moins
nie r l'émotio n est hétique qu'en modifi er, d 'une part, l'ob;et : • Un
mu sicien filme la mu siq ue et non les rossignols ; un poète aime les vers et non les co uch ers de soleil •, e t d'autre part, l'usag e : les grands arts exprim en t une émo tion sacrée mai s ils ne s'expr imen t pas en • représentant cc qui la s u scite dans la vie • ; alnst, • Il y a plus.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'art peut-il créer des valeurs ?
- L'ART ET LES VALEURS ESTHÉTIQUES - La création artistique
- Les valeurs culturelles : la technique, l'art, la science, la religion, l'organisation sociale
- qu'il y ait une histoire de l'art cela signifie-t-il que les valeurs esthétiques sont relatives ?
- L'ART ET LA REFLEXION ESTHETIQUE