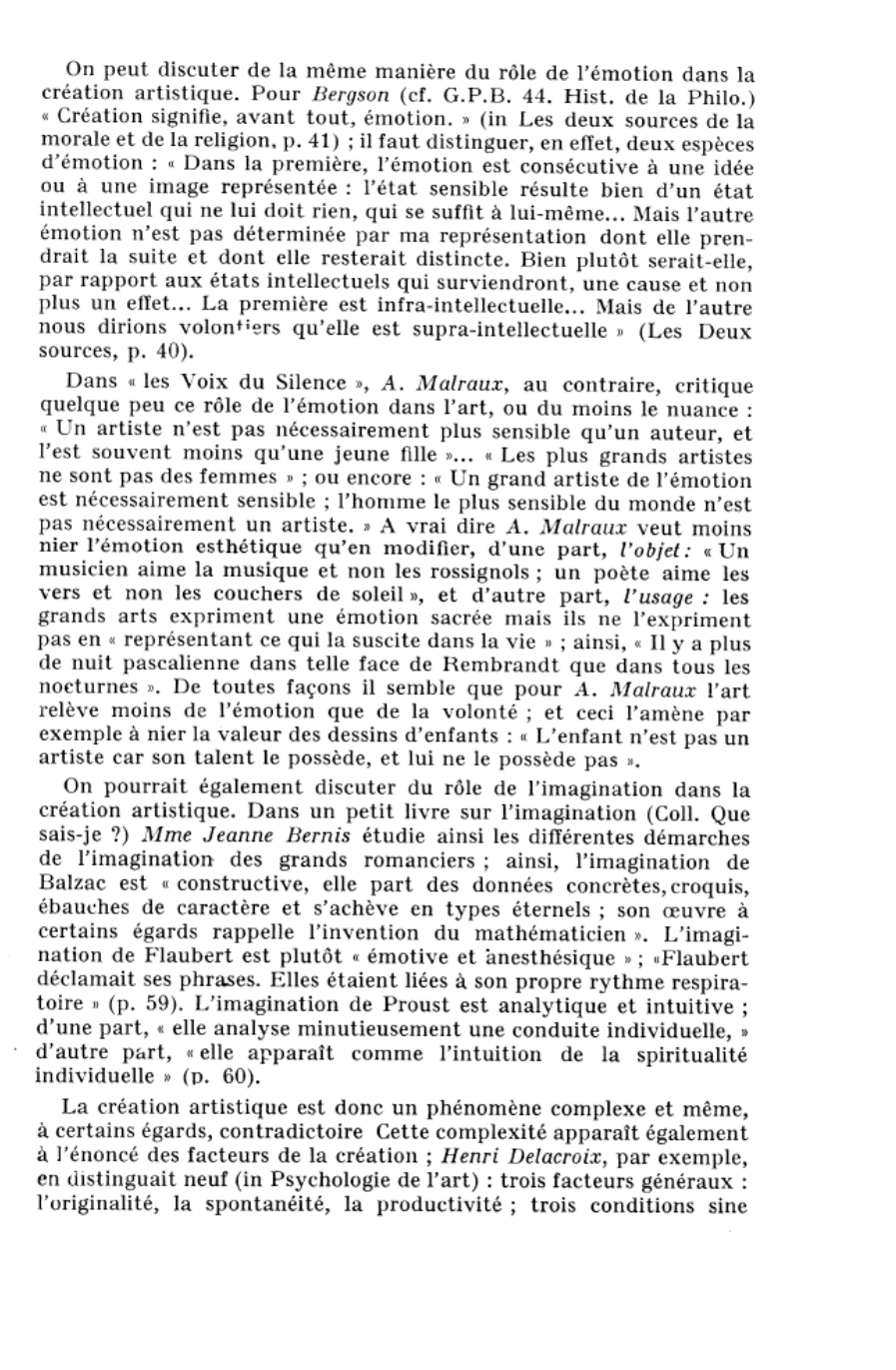L’ART
Publié le 03/11/2016
Extrait du document
L’ART
L’art peut être étudié d’abord d’un point de vue psychologique.
Il faut distinguer deux moments essentiels : la création et la contemplation de l’œuvre d’art.
La création artistique.
Nous examinerons tour à tour le rôle de l’inspiration, le rôle de l’émotion, et le rôle de l’imagination ; nous préciserons aussi comment se déroule la création ; puis nous nous interrogerons plus profondément sur le pourquoi d’une telle création.
I — Les descriptions les plus diverses ont été données de la création artistique. Pour les uns, elle ne s'accomplit que sous l’effet d’une inspiration : « Moi, disait Lamartine, je ne pense jamais, mes idees pensent pour moi » ; Oeorge Sand écrit : . Chez Chopin la création était spontanée, miraculeuse ; il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir elle venait complète, soudaine, sublime ». Chateaubriand raconte de même : « Un beau jour, je m’étends, je ferme les yeux complètement. Je ne fais aucun effort. Je laisse se dérouler l’action sur l’écran de mon esprit... Je regarde en moi les choses se faire. C’est un rêve. C’est l’inconscient ». Cette conception romantique de l'inspiration rejoint la conception surréaliste de l’écriture automatique où le poète accueille les images dans l’ordre que lui dicte l'inconscient.
Pour d’autres, au contraire, la création est moins le fruit d une inspiration que d’un travail : « La loi suprême de l’invention humaine, c’est qu’on invente rien qu’en travaillant » (Alain in Système des Beaux-Arts, p. 34). C’est la conception classique de la création : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ».
Pour d'autres, enfin, la création résulte d’un mélange d’inspiration et de travail ; Valéry écrit ainsi : « Les Dieux gracieusement nous donnent pour rien tel premier vers : mais c’est à nous de façonner le second ». (Introduction à la méthode de Léonard de Vinci).
Dissertations traitées dans ce cours :
La création artistique.
La contemplation esthétique.
Les différentes catégories esthétiques.
La nature et l'art.
La classification des arts.
Dans le Banquet de Platon, le beau est l’objet de l’amour, et le terme d’une ascension de l’âme en quatre étapes nettement marquées : l’amour des formes sensibles, celui des âmes, l’acquisition de la science et l’atteinte de l’idéal, de même dans le Phèdre, cette ascension des âmes vers le beau absolu nous est décrit par un mythe ; ces âmes forment un attelage ailé où chacune possède un cocher, l’Esprit , et deux coursiers; le beau se confond avec le bien car
« impossible qu’en visant le beau on atteigne ce qui n’est pas le bien. »
Kant donne dans la « Critique du Jugement » une quadruple définition du beau : le beau est l’objet d'une satisfaction désintéressée ; le beau est ce qui plaît universellement sans concept : c’est-à-dire qu’on ne peut pas prouver la beauté, mais l’éprouver ; le beau est « la forme de la finalité d’un objet en tant qu’elle y est perçue sans représentation de fin » ; autrement dit, une œuvre ne vise pas une fin utile mais, entre toutes ses parties, il y a un accord interne ; enfin, « est beau ce qui est reconnu sans concept comme l’objet d’une satisfaction nécessaire » ; en un mot, tous les hommes doivent y être sensibles.
D’autres catégories esthétiques que le beau peuvent être analysées : la grâce, par exemple, que Bergson a analysée : « nous croyons démêler dans tout ce qui est gracieux, en outre de la légèreté qui est mobilité, l’indication d’un mouvement possible vers nous, d’une sympathie virtuelle, ou même naissante. » (in « Données immédiates de la conscience », p. 10), le joli aussi peut être analysé, dont Hugo a écrit dans son « Shakespeare » : « le joli est possible. Il est dans Homère, Astyanax en est un type ». Souriau définit ainsi, dans un cours, cette importance du joli : la fragilité de l’objet contemplé fait naître l’idée que la joie est précaire, qu’un rien suffirait à le détruire et qu’il s’offre à nous comme l’effet d’une grâce surprenante de la destinée. Une autre catégorie importante est le sublime : pour Kant, le sublime s'oppose au beau. Le beau provient de l’harmonie de l’entendement et de l’imagination ; le sublime de leur antagonisme, le sentiment du beau porte sur un objet limité ; le sentiment du sublime sur un objet illimité ; les deux aspects du sublime sont « le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi ». Pour Hegel, le sublime résulte d’une disproportion entre l’idée et les signes qui le manifestent ; le beau résulte, au contraire, de leur accord.
La nature et l’art.
La première règle qui régit l’art, surtout pictural, fut d’imiter la nature ; le premier critère fut le critère de la ressemblance. Platon compare la peinture à un miroir ; le peintre, inférieur en cela au philosophe, est l’esclave des apparences.
«
On peut discuter de la mème mani ère du rôle d e l 'ém oti on dans la
création arti stiqu e.
Pour Bergson (cf.
G.P.
B.
44.
Hist.
de la Philo.
) • Créa tion sig nifie , ava nt tout, émotion.
• (in Les d eux sourc es de la
m ora l e e t de la re lig io n.
p.
41); il faut dis tinguer, en ellet, d eux espèces d'émotion : • Dans la prem ière , l 'ém otion es t consé c utiv e à une idée
ou à une image rcpr êse ntée : l'état sensible résulte bie n d'un état int ellec tuel qui ne lui doit rien, qui se suffit à lui-m ême .•.
i\lais l 'autre émotion n'est pas déterminée par ma représen tation dont elle pren drait la suite et don t elle rest erait distincte .
Bien plutôt serai t-elle, par rapport aux états intellectuels qui surviendront, u ne cause et n on
plus un e ffet...
La première est infra - int ell ec tuelle ...
!\lai s de l'autr e
nou s dir io ns volont ;ers qu'elle est supr a-i ntelle ctue lle • (Les Deux sources, p.
40).
Da ns
• les Voix du Silence •, A.
Malraux, au contraire, critiqu e que lq ue peu ce rô le de l'émotion d ans l'art, ou du moins le nuance : • Un artis te n 'es t pas nécessa irement plus sensible qu'u n auteur, et l'est so u vent moins qu 'une jeune fille •··· • Les plus grands artistes ne sont pas des femmes • : ou encore : • Un grand artiste de l'émotion
es t n écessa irement sens ible ; l'homm e le plu s sensible du monde n 'est pas nécess airement un artiste.
• A vrai dire A .
iW alr aux veut moins
ni er l'émo tion esthé tiqu e qu'en modifi er, d'une part, l'obje t: • Un mu sicie n aime la mu sique et non les ro ssignols; un poHe aime les yers ct non les couch ers de soleil •, e t d'autre par t, l'usage : les
grand s arts expriment une émotion sacrée mais ils ne l'expriment pas en • représentant ce qui la su sci te dans la vie • ; ain si, • Il y a plus
de nuit pasca li enne dans telle face de Hcm brandt que dans lous l es nocturnes •.
De tout es façons il sembl e que pour A.
J\1a/rau:r l'art rel ève moins de l 'émotion que de la volonté ; et ceci l 'amène par exemple à nier la val e ur des dessin s d 'enfants : • L'entan t n'est pas un artiste car so n latent le possè de, e t lui ne le possède pas •.
On pourrai t éga leme nt discuter du rôle de l' imagination dans la
créatio n arti stiq ue.
Dans un petit livre sur l'imagination (Coll .
Que
sa is-je ?) Jfm e Jeanne Bernis étudie ai nsi les difJ ére nte s démar ch es de l' imaginatiorl des grands roman ciers ; ain si, l 'imag ination de
Balzac est • con s tru ctive, elle part des données con nè tes, croquis, ébau ches de ca ractè re et s'achève en types éternels ; son œuvre à certains ég ard s rappelle l'invention du mathématicie n • · L'imagi nation de Flaubert est plutôt • ém oti ve el anesthésique •; • Flaubert déclamait ses phrases.
Elles étaient liées à son propre rythme res pira t oire • (p.
59).
L'imagination de Pro ust est anal y tique et intuitive ; d'un e part, • elle analyse minutieusement une conduit e individuelle, • d'autr e par t, • elle apparatt comme l' intuition de la spiritualité
individuelle • (p.
60).
La créa tion arti stique est d o nc un phénomène complexe et mêm e, à certains égards, con tradi ctoire Cette comple xité apparalt égalemen t à l'énoncé des f acteurs de la créa tion ; Henri Delacroix, par exemple,
en ùrs tin g uait neur (in P sychologi e de l'art ) : trois f acteurs généraux: l'originalité, la spontané ité, la produ c tivité ; troi s co nditions sine.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L’art de la vie se rapproche de l’art de la lutte : il faut se tenir prêt sans broncher à répondre aux coups qui fondent sur nous, même s’ils sont imprévus » Marc Aurèle
- Cours sur l'art (références)
- [II n'y a pas d'art d'agrément] - Merleau-Ponty
- L'oeuvre d'art est-elle l'oeuvre d'un génie? (plan)
- [De la vérité universelle de l'art]