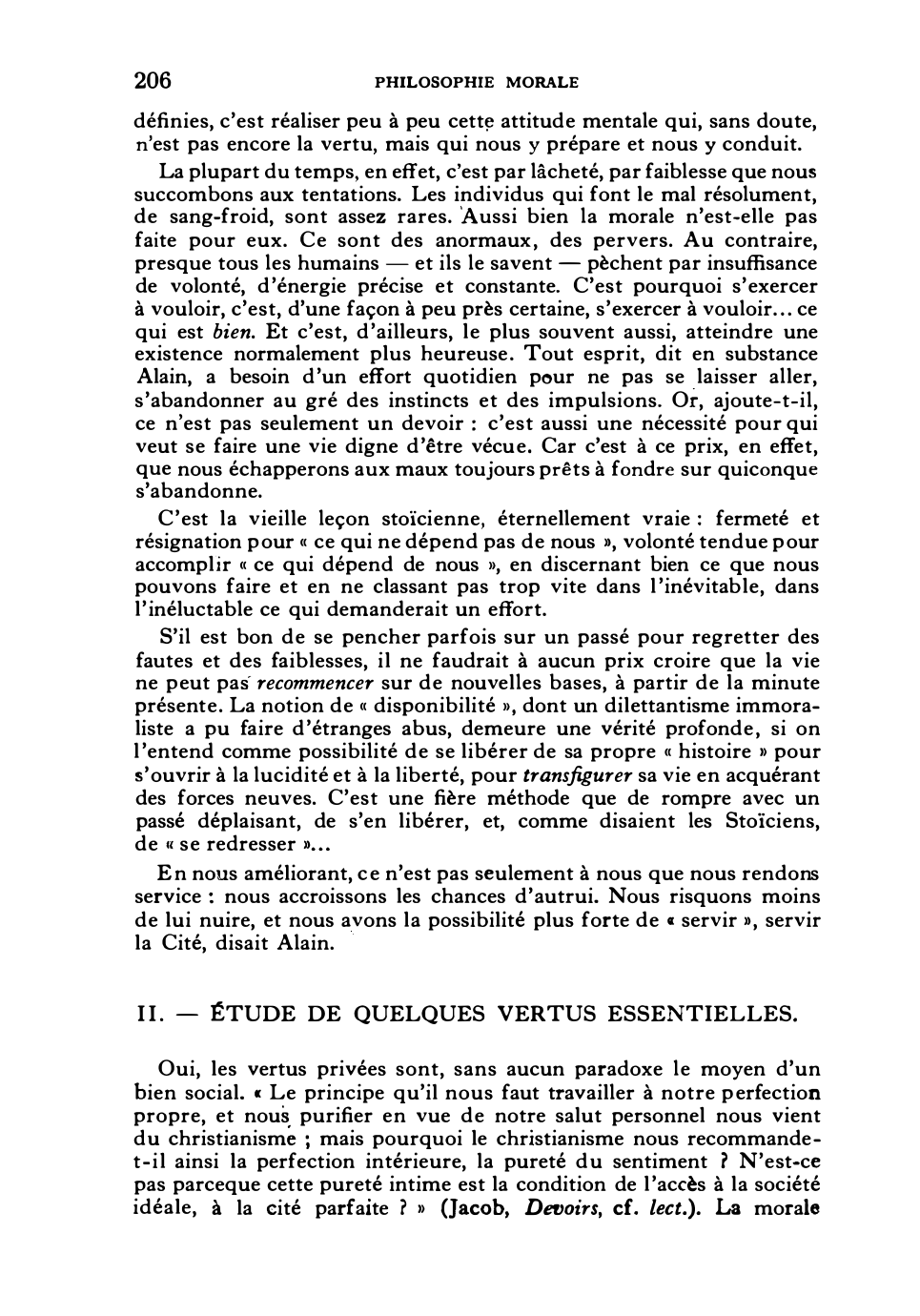La Vertu. — étude de quelques vertus essentielles.
Publié le 12/11/2016
Extrait du document
définies, c’est réaliser peu à peu cette attitude mentale qui, sans doute, n'est pas encore la vertu, mais qui nous y prépare et nous y conduit.
La plupart du temps, en effet, c'est par lâcheté, par faiblesse que nous succombons aux tentations. Les individus qui font le mal résolument, de sang-froid, sont assez rares. Aussi bien la morale n’est-elle pas faite pour eux. Ce sont des anormaux, des pervers. Au contraire, presque tous les humains — et ils le savent — pèchent par insuffisance de volonté, d’énergie précise et constante. C’est pourquoi s’exercer à vouloir, c’est, d’une façon à peu près certaine, s’exercer à vouloir... ce qui est bien. Et c’est, d’ailleurs, le plus souvent aussi, atteindre une existence normalement plus heureuse. Tout esprit, dit en substance Alain, a besoin d’un effort quotidien pour ne pas se laisser aller, s’abandonner au gré des instincts et des impulsions. Or, ajoute-t-il, ce n’est pas seulement un devoir : c’est aussi une nécessité pour qui veut se faire une vie digne d’être vécue. Car c’est à ce prix, en effet, que nous échapperons aux maux toujours prêts à fondre sur quiconque s’abandonne.
C’est la vieille leçon stoïcienne, éternellement vraie : fermeté et résignation pour « ce qui ne dépend pas de nous », volonté tendue pour accomplir « ce qui dépend de nous », en discernant bien ce que nous pouvons faire et en ne classant pas trop vite dans l’inévitable, dans l’inéluctable ce qui demanderait un effort.
S’il est bon de se pencher parfois sur un passé pour regretter des fautes et des faiblesses, il ne faudrait à aucun prix croire que la vie ne peut pas recommencer sur de nouvelles bases, à partir de la minute présente. La notion de « disponibilité », dont un dilettantisme immoraliste a pu faire d’étranges abus, demeure une vérité profonde, si on l’entend comme possibilité de se libérer de sa propre « histoire » pour s’ouvrir à la lucidité et à la liberté, pour transfigurer sa vie en acquérant des forces neuves. C’est une fière méthode que de rompre avec un passé déplaisant, de s’en libérer, et, comme disaient les Stoïciens, de « se redresser »
La Vertu. — Étude de quelques vertus essentielles.
I. — LA VERTU.
Le latin virtus désigne la force, le courage, le propre du vir (l'homme, par excellence. Homo désignant n’importe quel être humain). Vertueux, dans le français du XIIe siècle, a encore le sens de « vigoureux, puissant ». Le sens moral du terme s’est développé ensuite, sous l’influence des idées religieuses.
Moralement, disons-le aussitôt, car c’est essentiel, la vertu est une habitude (du bien). Un acte méritoire ne suffit pas à la constituer. « Une hirondelle », disait Aristote, « ne fait pas le printemps »...
Comment distinguer la vertu du devoir ? Hoffding répond : « La morale fait, entre le devoir et la vertu, une distinction analogue à celle faite par la psychologie entre l’émotion et la passion. Le devoir suppose une concentration du sentiment moral sur un point isolé, tandis que la vertu dépend d’une disposition permanente et d’un état durable » (cf. lect.). A. Lalande (Vocab.) signale que les mots vertu, vertueux, tendent, semble-t-il à disparaître du langage contemporain. La raison de cette demi-désuétude est peut-être l’abus que des écrivains du XVIIIe siècle ont fait de ces mots, employés souvent, chez J.-J. Rousseau, par exemple, dans un sens assez confus. Et puis, au XIXe siècle, il était souvent synonyme de pudeur féminine, d’horreur du grivois, etc...
Quoi qu’il en soit, et puisque notre Programme nous y invite, analysons la notion de vertu, en lui donnant sa pleine valeur de persévérance dans l’action droite.
Ce qui définit et constitue la vertu, c’est donc la stricte ordonnance de la vie morale. C’est une discipline de la conduite. Et cela ne s'accompagne pas forcément de sécheresse formaliste. L’habitude, qui, précisément, rend tout facile, nous accoutume à bien faire, nous rend de moins en moins pénible l’accomplissement de notre tâche, de nos devoirs. La volonté doit s’exercer avec patience et ténacité, commençant, au besoin par de minuscules victoires : habitude du travail, régularité des efforts, ponctualité à exécuter ce que nous avons décidé. Voilà qui nous achemine vers une vie bien ordonnée. Il faut rechercher les plus humbles occasions de réduire notre passivité, de réfréner nos mauvais penchants... Soumettre notre conduite à des obligations
«
206
PHILOSOPHIE
MORALE
définies, c'est réaliser peu à peu cett\') attitud e mentale qui, sans doute,
n'est pas encore la vertu, mais qui nous y prépare et nous y conduit.
La plupart du temps, en effet, c'est par lâcheté, par faibl esse que nous
succombons aux tentations.
Les individus qui font le mal résolume nt,
de sang-froid, sont assez rares.
Aussi bien la morale n'est-elle pas
faite pour eux.
Ce sont des anormaux , des pervers.
Au contraire,
presque tous les humains -et ils le savent -pèchent par insuffisance
de volonté, d'énergie précise et constante.
C'est pourquoi s'exercer
à vouloir, c'est, d'une façon à peu près certaine, s'exercer à vouloir ...
ce
qui est bien.
Et c'est, d'ailleurs, le plus souvent aussi, atteindre une
existence normalement plus heureuse .
Tout esprit, dit en substance
Alain, a besoin d'un effort quotidien pour ne pas se laisser aller,
s' abandonner au gré des instincts et des impulsions.
Or, ajoute -t-il,
ce n'est pas seulement un devoir : c'est aussi une nécessité pour qui
veut se faire une vie digne d'être vécue.
Car c'est à ce prix, en effet,
que nous échapperons aux maux toujours prêts à fondre sur quico nque
s'abandonne.
C'e st la vieille leçon stoïcienne, éternellement vraie : fermeté et
résignation pour « ce qui ne dépend pas de nous », volonté tendue pour
accomp lir « ce qui dépend de nous », en discernant bien ce que nous
pouvons faire et en ne classant pas trop vite dans l'inévita ble, dans
l'i néluctable ce qui demanderait un effort.
S'il est bon de se pencher parfois sur un passé pour regretter des
fa utes et des faiblesses, il ne faudrait à aucun prix croire que la vie
ne peut pas recommencer sur de nouv elles bases, à partir de la minute
présen te.
La notion de « disponibilité », dont un dilettantisme immora
liste a pu faire d'étranges abus, demeure une vérité profond e, si on
l' entend comme possibilité de se libérer de sa propre « histoire " pour
s'o uvrir à la lucidité et à la liberté, pour transfigurer sa vie en acquérant
des forces neuves.
C'est une fière méthode que de rompre avec un
passé déplaisant, de s'en libérer, et, comme disaient les Stoïci ens,
de " se redresser » •••
En nous améliorant, ce n'est pas seulement à nous que nous rendon s
service : nous accroi ssons les chances d'autrui.
Nous risquons moins
de lui nuire, et nous avons la possibilité plus forte de • servir », servir
la Cité, disait Alain.
II.
-ÉTUDE DE QUELQUES VERTUS ESSENTIELLES.
Oui, les vertus privées sont, sans aucun paradoxe le moyen d'un
bien social.
« Le principe qu'il nous faut travailler à notre perfection
propre, et nous purifier en vue de notre salut personnel nous vient
du christianisme ; mais pourquoi le christianisme nous recommande
t-il ainsi la perfection intérieure, la pureté du sentiment ? N'es t-ce
pas parceque cette pureté intime est la condition de l'accès à la société
idéale, à la cité parfaite ? " (Jacob, Devoirs, cf.
lect.).
La morale.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nous disons bonnes les vertus d'un homme, non pas à cause des résultats qu'elles peuvent avoir pour lui, mais à cause des résultats qu'elles peuvent avoir pour nous et pour la société : dans l'éloge de la vertu on n'a jamais été bien « désintéressé », on n'a jamais été bien « altruiste » !
- L'argent est plus vil que l'or, et l'or que la vertu
- vertu et Montaigne texte
- Mémoire sur la vertu
- Microcosme et Délie, objet de plus haute vertu