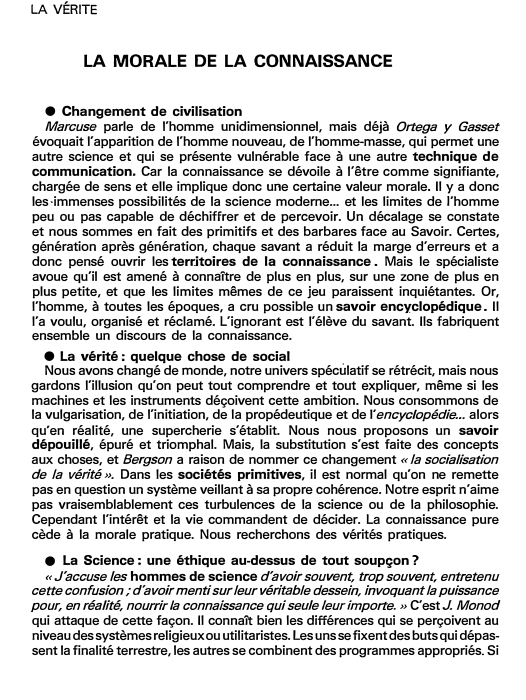LA VÉRITE LA MORALE DE LA CONNAISSANCE • Changement de civilisation Marcuse parle de l'homme unidimensionnel, mais déjà Ortega y...
Extrait du document
«
LA VÉRITE
LA MORALE DE LA CONNAISSANCE
• Changement de civilisation
Marcuse parle de l'homme unidimensionnel, mais déjà Ortega y Gasset
évoquait l'apparition de l'homme nouveau, de l'homme-masse, qui permet une
autre science et qui se présente vulnérable face à une autre technique de
communication.
Car la connaissance se dévoile à l'être comme signifiante,
chargée de sens et elle implique donc une certaine valeur morale.
Il y a donc
les-immenses possibilités de la science moderne...
et les limites de )"homme
peu ou pas capable de déchiffrer et de percevoir.
Un décalage se constate
et nous sommes en fait des primitifs et des barbares face au Savoir.
Certes,
génération après génération, chaque savant a réduit la marge d'erreurs et a
donc pensé ouvrir les terdtoires de la connaissance .
Mais le spécialiste
avoue qu'il est amené à connaître de plus en plus, sur une zone de plus en
plus petite, et que les limites mêmes de ce jeu paraissent inquiétantes.
Or,
l'homme, à toutes les époques, a cru possible un savoir encyclopédique.
Il
l'a voulu, organisé et réclamé.
L'ignorant est l'élève du savant.
Ils fabriquent
ensemble un discours de la connaissance.
• La vérité : quelque chose de social
Nous avons changé de monde, notre univers spéculatif se rétrécit, mais nous
gardons l'illusion qu'on peut tout comprendre et tout expliquer, même si les
machines et les instruments déçoivent cette ambition.
Nous consommons de
la vulgarisation, de l'initiation, de la propédeutique et de l'encyclopédie...
alors
qu·en réalité, une supercherie s'établit.
Nous nous proposons un savoir
dépouillé, épuré et triomphal.
Mais, la substitution s'est faite des concepts
aux choses, et Bergson a raison de nommer ce changement « la socialisation
de la vérité».
Dans les sociétés primitives, il est normal qu'on ne remette
pas en question un système veillant à sa propre cohérence.
Notre esprit n'aime
pas vraisemblablement ces turbulences de la science ou de la philosophie.
Cependant l'intérêt et la vie commandent de décider.
La connaissance pure
cède à la morale pratique.
Nous recherchons des vérités pratiques.
• La Science : une éthique au-dessus de tout soupçon ?
« J'accuse les hommes de science d'avoir souvent, trop souvent, entretenu
cette confusion; d'avoir menti sur leur véritable dessein, invoquant la puissance
pour, en réalité, nourrir la connaissance qui seule leur importe.
» C'est J.
Monod
qui attaque de cette façon.
Il connaît bien les différences qui se perçoivent au
niveau des systèmes religieux ou utilitaristes.
Les uns se fixent des buts qui dépas
sent la finalité terrestre, les autres se combinent des programmes appropriés.
Si
l'on s'élève à une éthique plus élevée de la connaissance, toutes ces mesquine
ries disparaissent.
Mais le savant cherche-t-il vraiment le bonheur de l'homme,
ou n'exerce-t-il que sa capacité d'observation et de désir vers la connaissance
objective ?....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓