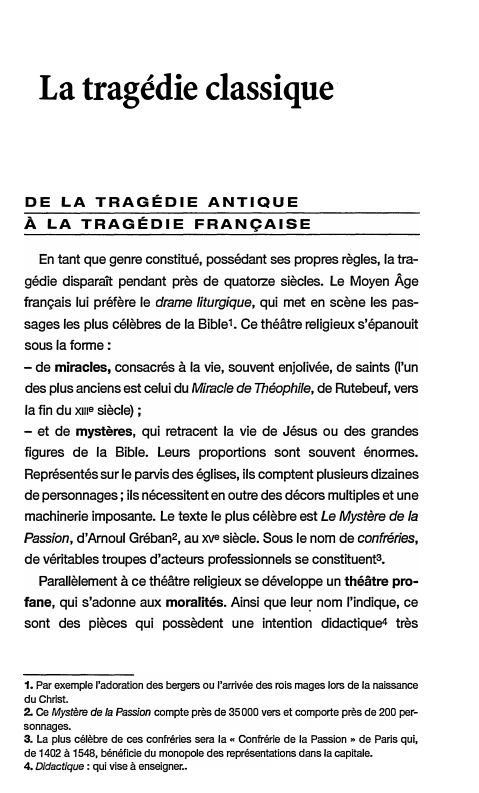La tragédie classique DE LA TRAGÉDIE ANTIQUE À LA TRAGÉDIE FRANÇAISE En tant que genre constitué, possédant ses propres règles,...
Extrait du document
«
La tragédie classique
DE LA TRAGÉDIE ANTIQUE
À LA TRAGÉDIE FRANÇAISE
En tant que genre constitué, possédant ses propres règles, la tra
gédie disparaît pendant près de quatorze siècles.
Le Moyen Âge
français lui préfère le drame liturgique, qui met en scène les pas
sages les plus célèbres de la Bible1.
Ce théâtre religieux s'épanouit
sous la forme :
- de miracles, consacrés à la vie, souvent enjolivée, de saints O'un
des plus anciens est celui du Miracle de Théophile, de Rutebeuf, vers
la fin du xme siècle) ;
- et de mystères, qui retracent la vie de Jésus ou des grandes
figures de la Bible.
Leurs proportions sont souvent énormes.
Représentés sur le parvis des églises, ils comptent plusieurs dizaines
de personnages ; ils nécessitent en outre des décors multiples et une
machinerie imposante.
Le texte le plus célèbre est Le Mystère de la
Passion, d'Arnoul Gréban2, au xve siècle.
Sous le nom de confréries,
de véritables troupes d'acteurs professionnels se constituent3.
Parallèlement à ce théâtre religieux se développe un théâtre pro
fane, qui s'adonne aux moralités.
Ainsi que leu� nom l'indique, ce
sont des pièces qui possèdent une intention didactique4 très
1.
Par exemple l'adoration des bergers ou l'arrivée des rois mages lors de la naissance
du Christ.
2.
Ce Mystère de la Passion compte près de 35 000 vers et comporte près de 200 per
sonnages.
3.
La plus célèbre de ces confréries sera la « Confrérie de la Passion » de Paris qui,
de 1402 à 1548, bénéficie du monopole des représentations dans la capitale.
4.
Didactique : qui vise à enseigner..
marquée.
Mais ces moralités pratiquent le mélange des genres5.
Certaines sont même franchement comiques.
LA TRAGÉDIE HUMANISTE DU XVIe SIÈCLE
Avec la redécouverte, au XVI6 siècle, des œuvres de !'Antiquité naît
la tragédie française.
Cette tragédie humanistes s'étend sur environ
un demi-siècle : de /'Abraham sacrifiant, de Théodore de Bèze
(1550), et de la Cléopâtre captive, d'Étienne Jodelle (1552), jusqu'à
!'Hector, d'Antoine de Montchrestien (1604).
ISes principaux auteurs
Les représentants les plus importants de la tragédie humaniste
sont:
- Étienne Jodelle (vers 1532-1573), avec, notamment, Cléopâtre
captive et Didon se sacrifiant (1564 ?) ;
- Robert Garnier (1544-1590), avec Hippolyte (1574) et Les Juives
(1583);
-Antoine de Montchrestien (1575-1621), avec Sophoniste (1536),
L:Écossaise, David, Hector (1601).
1Ses caractéristiques
La tragédie humaniste est avant tout statique.
Elle comporte très
peu d'événements.
L'issue funeste en est connue d'avance.
Un personnage protatique (chargé de l'exposition de la pièce) enlève d'emblée tout espoir.
Dès le début, le dénouement est connu : c'est la
mort.
Privée de toute action, la tragédie humaniste devient une pure
lamentation et un cérémonial funèbre.
Le pathétique? en est le principal ressort.
Comme l'écrit un théoricien de l'époque, Jean de La
Taille, dans son Art poétique (1572) :
5.
C'est-à-dire qui mélange le comique et le sérieux
6.
L:humanisme est le mouvement de redécouverte des œuvres de !'Antiquité, au
XVI• siècle.
7.
Pathétique : qui crée une émotion forte et pénible, pouvant aller jusqu'aux larmes.
LA TRAGÉDIE
19
Son sujet ne traite que de piteuses [= pitoyables] ruines de 'grands
seigneurs, que des inconstances de la Fortune, que barrissements,
guerres, famines, captivités, exécrables cruautés de tyrans;[ ...] que
larmes et misères extrêmes.
LA TRAGÉDIE EN CRISE (1580-1620)
La tragédie humaniste connaît, à la fin du xv1e siècle, une crise qui
finit par provoquer sa disparition.
D'abord elle subit la concurrence de deux nouveaux genres, qui
recueillent les faveurs du public : la tragi-comédie, chargée d'événements très spectaculaires, et qui souvent se termine biens ; et la
pastorale qui, dans un décor champêtre, met en scène d'émouvantes histoires d'amour.
La tragédie humaniste dépérit ensuite de ses propres excès et
dérives.
Rejetant toute règle, elle finit par mêler au pathétique des
scènes triviales ou comiques.
L'unité de ton est brisée.
L'accumulation de crimes et d'horreurs achève de lasser le public et
de faire disparaître tout intérêt.
Au début du xvue siècle, la tragédie est à repenser et à reconstruire.
LE RENOUVEAU DE LA TRAGÉDIE
(1620-1636)
Le renouveau de la tragédie tient à trois phénomènes.
1De meilleures conditions matérielles et morales
Longtemps Paris ne posséda qu'une seule salle de théâtre : celle
de !'Hôtel de Bourgogne, propriété des Confrères de la Passion.
Or,
à partir de 1630, ce théâtre est rénové, et Louis XIII y installe la
troupe, très professionnelle, des Comédiens du Roi.
En 1634, l'acteur Mondory fonde, de son côté, le théâtre du
Marais.
Durant près de 50 ans, ces deux théâtres se partageront les
8.
La plus célèbre de ces tragi-comédies est, à la fin du xv1• siècle, la Bradamante, de
Garnier (1592), et, au
20
xvn• siècle, Le Cid, de Corneille (1637).
LA TRAGÉDIE
grandes œuvres du répertoire, notamment celles de Corneille et de
Racine.
Par ailleurs, le théâtre bénéficie d'une nouvelle considération
sociale et morale.
Il devient un loisir à la mode.
ILa redécouverte d'Aristote
Théoriciens et dramaturges redécouvrent parallèlement la
Poétique d'Aristote, dont ils méditent les préceptes.
Progressivement s'élabore une tragédie régulière, c'est-à-dire obéissant à
des règles précises.
La tragédie que l'on appelle« classique » est en
train de naître.
1De nouveaux dramaturges de talent
De nouvelles générations de dramaturges apparaissent, avec Jean
Mairet (1604-1686), Georges de Scudéry (1601-1667), Jean Rotrou
(1609-1650).
Mais ce sont surtout Pierre Corneille (1606-1684) et
Jean Racine (1639-1699) qui vont donner à la tragédie du xvne siècle
ses plus beaux visages.
LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA TRAGÉDIE CLASSIQUE
1Une application des théories d'Aristote
Conformément aux préceptes d'Aristote9 , la tragédie classique ne
met en scène que de très hauts personnages, impliqués dans des
aventures soulevant
«
quelque grand intérêt d'État
».
Ses sujets et
personnages appartiennent à !'Histoire ou aux légendes de !'Antiquité.
C'est la condition de sa« dignité».
Car, ainsi que l'écrit Racine
dans sa Seconde Préface de Bajazet :
Les personnages tragiques doivent être regardés d'un autre œil que
nous ne regardons d'ordinaire [...
].
On peut dire que le respect que
l'on a pour les héros augmente à mesure qu'ils s'éloignent de nous.
9.
Voir plus haut p.
15 et 16.
LA TRAGÉDIE
21
La théorie aristotélicienne de l'imitation10 confère en outre à la tragédie classique une fonction de représentation : tout doit être montré sur scène, et non raconté.
En d'autres termes, le spectateur doit
avoir l'illusion qu'il assiste non pas à la représentation d'une œuvre
de fiction, mais au déroulement d'une histoire réelle.
1La règle des trois unités
Parmi les nombreuses règles auxquelles doit se plier la tragédie
classique figure celle des trois unités : l'unité de temps, l'unité de lieu
et l'unité d'action.
L'unité de temps
Découlant de la doctrine de l'imitation, l'unité de temps exige que
la durée de l'action ne dépasse pas vingt-quatre heures.
L'idéal était
qu'elle coïncide avec la durée du spectacle (trois heures environ).
Comme c'était rarement réalisable, on admettait qu'elle s'étende sur
une journée.
Au-delà, pensait-on, se produisait, entre durée de l'action et durée du spectacle, un trop grand décalage, préjudiciable à la
vraisemblance.
Beaucoup plus que Corneille qui prend souvent des libertés avec
cette règle, Racine s'est fait une loi absolue de l'observer.
Dans ses
tragédies, le temps devient un élément constitutif du tragique.
Parce
qu'il est compté, il finit souvent par manquer.
Dans Andromaque, par
exemple, à peine Hermione a-t-elle ordonné l'assassinat de Pyrrhus
qu'elle se rend compte de la monstruosité de sa décision.
Elle hésite,
elle se reprend :
«
Ah ! qu'ai-je fait?
»
(v.
1430).
Comment annuler
l'ordre ? Trop tard.
Oreste revient lui....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓